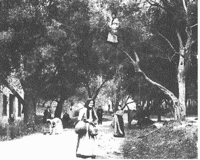03 février 2005
« En ce lieu qui l’enfante » (Andrée Chedid)
Le jour vient juste de se lever. Le soleil va bientôt surgir de derrière la cime des montagnes. Elle le guette tout au long de sa traversée. Bonheur de cette solitude dans l’eau. De ce silence de la nature à son réveil. À peine le clapotement régulier des vaguelettes dont les ondulations s’étirent sur les galets. Elle envie les rares pêcheurs qui sont là depuis l’aube à réparer leurs filets. Elle envie la simplicité ancestrale de leurs gestes. Elle hume à pleins poumons les senteurs du maquis, ranimées par la fraîcheur de la nuit. La nature est là, fidèle. Inchangée. Absorbée en elle-même. La mer est calme et chaude. Qui la lave de son désespoir du matin. Fraîche et vivifiante par endroits. Là où les fonds sont tapissés de sable fin.
Elle s’est allongée sur le dos. Elle nage. À larges brassées. Elle glisse dans le silence lisse et caressant des premières gouttes de soleil. Elle entreprend la traversée jusqu’aux rochers. Là-bas. Là où l’eau se fait sombre. Plus profonde et plus émeraude. Elle se love dans sa couleur. Reprend son souffle en s’agrippant aux anfractuosités de la roche. Un minuscule crabe gris, dérangé dans son sommeil, lui file entre les doigts. Un autre, plus impressionnant, pattes velues et crochues, court se cacher dans un creux moussu. Elle caresse du plat de la main les cônes pointus et vernissés des bigorneaux. Elle voudrait décrocher une arapède. Mais elle résiste! Elle sent ses ventouses redoubler d’efforts pour rester agrippée. Une anémone de mer gonfle sa masse charnue. Puis se rétracte. Dont elle effleure la viscosité du doigt. Vulve vivante et charnelle. Un léger frisson les parcourt l’une et l’autre. Elle plonge pour se réveiller des images qui remontent en elle. Elle s’ébroue dans de nouvelles pirouettes. Puis, agile et souple, escalade le rocher et s’installe à son sommet. Silencieuse. Pareille à « la petite sirène ». De là, elle domine, croit-elle. "En ce lieu qui s'absente". "En ce lieu qui l'enfante". Son regard embrasse la crique entière, la plage déserte, le large animé de quelques voiles claires. Et le petit port. Elle surveille l’arrondi des montagnes. Elle se souvient de cette photo retrouvée dans les tiroirs de la vieille maison. Une photo qui date de la jeunesse de sa mère. Elle y a reconnu toute une bande de jeunes gens, garçons et filles. Aux maillots bouffants, tricotés maison. Elle y a reconnu son oncle F. Carry, bombant le torse pour camoufler sa petite taille et l’insuffisance de ses pectoraux. Elle le reconnaît à son visage de Mésopotamien aux pommettes hautes, héritées de son père, le commandant B. Elle le reconnaît à la beauté fine de ses traits, à ses yeux de braise. Un bruit de moteur l’arrache à sa rêverie. Elle plonge et entreprend la traversée en direction du port. Elle surveille, en fermant à demi les yeux, la montée du dieu Râ encore en partie caché par la montagne, derrière le dernier mamelon. Combien de temps lui faudra-t-il pour apparaître enfin dans tout son éclat ?
Le premier rayon surgit de derrière la montagne. Il glisse sur le dos des vagues. Elle nage dans sa direction. Il est là, à portée de brasse coulée. Elle s’ancre en lui, s’arrime à lui, puis son corps se détend. Elle fait la planche, dans cet espace-là. Dans le rayon de soleil neuf. Elle veille à rester en contact avec lui. Elle se laisse imprégner de sa force. Un sanglot inattendu monte soudain de sa poitrine. Elle crie vers le ciel son nom, elle crie le nom de cette autre femme qu’elle a aimée. Puis perdue. Ses larmes de sel se mêlent aux perles de l’eau qui coulent sur ses joues. Elle pleure, longtemps. La tête cachée sous l’eau. Elle sanglote et s’étouffe. Elle boit la tasse, plusieurs fois, et rageuse, ressurgit, s’ébroue, essore ses cheveux. Elle retrouve son calme et le soleil, haut maintenant. Elle se secoue de son désespoir. Elle guérira. Elle nage vers le petit port, toujours endormi. Peut-être son cri n’a-t-il pas été assez puissant pour tirer de leur torpeur les habitants de la marine. Ou bien est-il resté là, quelque part dans sa gorge, étranglé par l’angoisse et le chagrin.
Le port de Giottani s’éveille, timidement, assoupi dans la lumière naissante. Apaisé pour quelque temps encore des agitations du jour. Rendu à sa pureté d'origine. Un nuage léger voile momentanément la lumière. Une fraîcheur passagère effleure son corps mouillé d’écume, de larmes et de sel. Elle lèche les gouttelettes qui s’attardent sur son épaule. Sur ses joues. La faim la tenaille, qui prend peu à peu le pas sur le chagrin et l’angoisse. Elle a quitté la maison avant l’aurore, sans prendre le temps de déjeuner. Pour ne pas alerter les dormeurs.
Huit heures sonnent au clocher de Conchiglio. Elle prolonge encore ce hors-temps miraculeux qui n’appartient qu’à elle seule. Qui la libère et la lave des affres de sa nuit et de ses pleurs du jour naissant. Le joli hameau de Conchiglio est encore intouché du soleil. Blotti dans son ombre du matin. La montagne, elle, est sombre. Pourtant tout un dégradé de vert ébauche déjà ses contours. Un petit vent coulis la fait frissonner. Le soleil vient de franchir les ultimes bastions de la ligne de crête. La conque qu’elle dessine est baignée de lumière vive.
Elle s’immerge à nouveau dans le rayon vivifiant et rend grâce au soleil. Dans une immobilité qu’elle prolonge. Elle absorbe par tous les pores de sa peau cette caresse qu’elle accueille dans sa plénitude. Ici, dans cette épaisseur de l’eau qui l’enveloppe, elle retrouve un semblant de paix intérieure et de bonheur. Fugaces, l’un et l’autre, car ce bien-être illusoire ne dure pas. Il lui faudra y renoncer à nouveau. Elle ferme les yeux et s’absorbe en elle-même. Les odeurs des griffes de sorcières et des salicornes lui chatouillent les narines. Tout Salaghja remonte instantanément en elle. Ses rochers plats et coupants, aveuglants de blancheur sous la lumière de midi. Les premiers bains matinaux. Ceux qu’elle préfère, avec les bains du soir, au moment où le soleil se perd à l’horizon. La canicule et le repli dans les abris rares de rochers. Salaghja, la féminine, mais rude et dure. Impitoyable et essentielle. De l’autre côté du Merchjone. Salaghja et sa cabane de pêcheurs, blessée, puis arrachée par la dernière tempête. Engloutie dans les eaux.
Et Giottani, la gloutonne, qui avale tous les déchets venus du large. Pour les rejeter pêle-mêle sur la plage. Sous l’oeil indifférent et froid du Mugliarese. « L’épouse du roi », selon l’étymologie que sa mère prête au nom de ce rocher. Elle s’est toujours demandé où pouvait bien se cacher le roi ! Peut-être était-ce, surmonté de sa tour décapitée, le pan de montagne qui abrite le port. Un pan de montagne définitivement meurtri lui aussi ! Pitoyablement raboté par des bennes assassines. Beauté détruite par la main criminelle des hommes ! Elle ferme les yeux pour oublier cette autre blessure. Et rendre au paysage de son enfance sa grandeur virginale !
Texte©angèlepaoli
Rédigé par angèlepaoli le 03 février 2005 à 21:21 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
06 janvier 2005
Lamentu di u castagnu
(Extraits)
« Passemm’ una siratina
‘ Ntorn’ à lu nostre fucone
Cun tutta la famigliola
Cantavanu lazzarone
Nun ti n’arriccordi piune
Di quella bella sirata
Tu pigliasti la paghjola
Da facci una pulintata
L’emmu passatu cusine
Lu restu di la nuttata
La morte di lu castagnu
Ha messu tutti quici in dolu
E troncu lu pulindaghju
Tavvunat’ è lu paghjolu
Sarà prima vistu ΄nlocu
Quistu tamantu flagellu
D’avemmi jucat’à quarti
Cumm’un boiu a lu macellu
Aval si ch’è al riposu
Lu stacciu e lu tavulellu
Ni è calmatu gli è l’orgogliu
Hanu biotu la cassetta
Pà empie u portafogliu
Ripiantate lu castagnu
Pa lu ben ch’eu vi vogliu»
(Version transposée par l'ethnomusicologue Félix Quelici. Archives sonores du département audiovisuel de la BnF).
« Nous avons passé une soirée
Autour de l’âtre
Avec toute la petite famille
On chantait tranquillement
Tu ne te souviens plus
De cette belle soirée
Toi tu as pris le chaudron
Pour faire une polentade
Nous avons passé ainsi
Le reste de la nuit.
La mort du châtaignier
A plongé tout le monde dans le deuil
Le bâton à polenta est cassé
Et le chaudron est troué
A-t-on jamais vu nulle part
Pareille calamité ?
Me jouer au loto
Comme un bœuf à la boucherie !
Maintenant ils sont bien au repos
Le tamis et le plateau à polenta !
La fumée s’est arrêtée
Et l’orgueil s’est tu
On a vidé la caisse
Pour remplir le portefeuille
Replantez le châtaignier
Pour l’amour que je vous porte. »
Ce « lamentu » traditionnel en l’honneur du châtaignier (« lu castagnu ») pourrait être originaire de la Castagniccia, où le châtaignier règne en maître absolu. Selon Felix Quelici, cette complainte provient pourtant d’une toute autre région, située à mi-chemin entre Corte et Ajaccio, et aurait été transférée par la suite dans la région de Tagliu. La région de Guagnu est elle aussi riche en châtaigneraies. Mais en Corse, dès que l’on s’éloigne de la mer et que l’on gagne les premiers versants des collines, l’on entre toujours dans le domaine des châtaigneraies. Les forêts de châtaigniers, encore fort nombreuses malgré les incendies, offrent, l’été, leur ombre bienfaisante et leur fraîcheur. Et l’hiver, le fruit qui nourrit bêtes et hommes depuis l’Antiquité.
Arbres puissants et majestueux, les châtaigniers fournissent leur fruit dès l’automne où commence « a cugliura » (la cueillette). Cette activité familiale se pratique à l’aide « di a ruspalla », petite fourche à trois dents, qui permet de rassembler les fruits en tas. Puis les sacs sont chargés à dos d’ânes et de mulets et vidés dans le « chiostru », petite enceinte où les châtaignes sont momentanément entreposées, à l’écart des villages.
Fin décembre, la récolte s’achève. Mis à sécher sur de vastes pierres ou étalées dans les greniers au-dessus du « fucone » (le foyer) les fruits finissent de sécher. Il faut ensuite procéder à l’écorçage, passer au crible les châtaignes et les trier. Les plus belles d’entre elles sont conservées dans « u cascione », sorte de pétrin (appelé « meria »), en bois de châtaignier, aussi bien sûr ! Les plus dures sont destinées à la fabrication de la fameuse farine de châtaigne. Délicieuse « pulenta » qui agrémente viandes et produits de la chasse: ragoûts de sanglier et gibiers divers. Mais aussi de savoureux desserts : tartes aux pignons, beignets, marrons glacés et miel de châtaigne. Bière et alcools. Quant aux cochons et aux sangliers que l’on croise sur les routes et les sentiers, ils ne se délectent pas seulement de marrons, mais de tout ce que les hommes ont laissé en bord de route.
Il n’y a pas de plus grand bonheur, le soir, que de rêver au coin de la cheminée tout en attisant les braises. Avec les « ferlucci » qui prennent comme de l’amadou et d’écouter crépiter les châtaignes dans « u frissughjolu », la vieille poêle garnie de trous.
Voir aussi sur le site Canzone Passione l’intégralité des paroles du Lamentu di u castagnu (La complainte du châtaignier), dit ici composé par Paoli di Tagliu.
Retour à l' index de mes Topiques de Cap-Corsine
Rédigé par angèlepaoli le 06 janvier 2005 à 00:27 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
31 décembre 2004
La Corse, une lucidité à double tranchant
« Ni le ciel, ni la terre ni la lumière accusant les reliefs et les ombres jusqu’au-dedans de soi, ne sont les mêmes qu’ailleurs. Ma lucidité essentielle dépend beaucoup de cette luminosité insulaire. Que de jugements, d’engagements chimériques ou dangereux ai-je réajustés en moi, après un simple séjour en Corse, comme si elle me ramenait à la réalité de mon être, en effaçant mes délires, sous les risées du vent. Mais elle est aussi le lieu de ma mélancolie, de ma mémoire à vif, des remords lancinants, de tout ce que j’ai perdu…
Lucidité à double tranchant, partagée comme je le suis de ne pouvoir me résoudre à la quitter tout à fait ni à la retrouver définitivement… »
Jeanne et Hélène Bresciani, Deux, rue de la marine, Editions Les Vents contraires, page 215.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé par angèlepaoli le 31 décembre 2004 à 04:41 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (3)
30 décembre 2004
L'asphodèle, plante du salut
Topique : L’asphodèle
Je reprends ci-dessous la citation transmise par Marie.Pool en commentaire le 15 décembre 2004
Asphodèles du Cap Corse
(Canari-Vignale).Ph.©angelepaoli
« L'asphodèle est de tous "les bons passages". Entre ciel et terre, terre et tombe, saison et saison. Veille et sommeil aussi, et ses feuilles douces, soyeuses, gonflent les paillasses des transhumants ou bien des vieux qui vont nous quitter et des enfants qui nous arrivent. [...]
les feuilles d'asphodèles comme celles du hêtre sont imputrescibles et ne gardent pas l'odeur de l'urine. Entre l'obscurité et la lumière, « luminellu »; entre le froid et le chaud, « incendime »; entre l'incult de la forêt ou du maquis et la culture des champs et des jardins, plante de la friche, « san-martinu »...
Est-ce une fleur ? Une plante ? Un arbre ? Il semble relever d'une catégorie impossible [...] nous ignorons tout de la taxinomie populaire corse. On peut cependant penser, à partir de certains indices, qu'il y a un statut intermédiaire n'entrant pas tout à fait dans les catégories de la botanique scientifique. Ceccaldi dans son dictionnaire nous dit qu'« arbucciu » signifie "arburucciu" (petit arbre), ce qui est faux linguistiquement [...]. L'auteur introduit ici un sens tiré sans aucun doute du savoir local et il nous propose une étymologie fantaisiste comme on dit d'une étymologie populaire. Cette "classification" est confirmée par un récit recueilli aujourd'hui même à Ucciani. Il nous raconte l'une des nombreuses aventures de Bartolu, un personnage qui, à la manière de Grossu-Minutu, a l'art de se tirer toujours des mauvais pas.
Condamné à mort par la reine, il va être pendu. Il accepte le verdict mais demande "una grazia" (une dernière faveur). Il souhaite choisir l'arbre auquel il sera pendu, ce qu'on lui accorde. Les bourreaux le conduisent à travers les forêts. Aucun arbre n'est à son goût. Ils parviennent dans un champ couvert d'asphodèles, et désignant un beau "tirlu" : " - voilà mon arbre !". [...] Lié à cette plante moins haute que lui, Bartolu a échappé à la mort. Il a retourné la situation, aboli l'ordre sans passer par la rébellion, acceptant sans la subir, la loi de la reine. Au moment de mourir, il s'est amarré à l'asphodèle qui l'a réancré dans la vie.
Plante du salut, une fois encore. »
Arburi, Arbe, Arbigliule, Savoirs populaires sur les plantes de Corse, Livre édité avec de nombreux collaborateurs pour le compte du Parc Naturel Régional de la Corse, BP 417, 20184 Ajaccio Cedex, 2003 (Quatrième édition), selon une maquette et une mise en page de Jean Garcia. Extrait d'un article de Lucie Dedideri, L’Asphodèle, page 294.
FIN DE CITATION de MARIE.POOL
____________________________________
COMMENTAIRES et CITATIONS :
Voir aussi l'article "Asphodèle" du site nature.jardin.free.fr dans lequel je note tout particulièrement les remarques suivantes concernant la Corse :
« Fleur sacrée dans la mythologie grecque et romaine, emblème de la résurrection, relatée par Homère (l'Odyssée) qui l'associait aux Champs Elyséens où séjournaient les âmes des morts, qui se nourrissaient de leurs racines. Association reprise dans les oeuvres poétiques de Victor Hugo ('parfum d’asphodèle' de Booz endormi) et André Chénier ( «L’Aveugle »). L'asphodèle revêt encore de nos jours une importance symbolique en Corse, Grèce et Italie. En Corse (Asphodelus microcarpus Viviani.), durant les fêtes de la Toussaint, les épis floraux étaient trempés dans de l'huile d'olive, puis allumés et déposés près des tombes. Ce genre comprend une quinzaine d'espèces d'annuelles et de vivaces, originaires des régions méditerranéennes et d'Asie Mineure. En Europe le genre fait partie des plantes protégées. Il a les propriétés de résister au feu. »
Je cite les vers de Hugo et de Chénier :
• « Booz ne savait point qu’une femme était là,
Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d’elle.
Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèle ;
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. »
Victor Hugo, La Légende des siècles, « Booz endormi ».
N.B. Le TLF (Trésor de la langue française) note l’emploi chez Hugo du mot asphodèle au singulier (« comme s’il s’agissait d’une matière »), mais je remarque que Chénier écrit aussi asphodèle au singulier.
• « Puis il ouvrait du Styx la rive criminelle,
Et puis les demi-dieux et les champs d’asphodèle,
Et la foule des morts […] »
André Chénier, «L’Aveugle », vers 189, 190, 191.
• Autre citation fournie par le TLF :
« Parmi les plantes, la mauve rampante avec ses fleurs rayées de pourpre, et l'asphodèle avec sa longue tige garnie de belles fleurs blanches ou jaunes, se plaisent à croître sur les tertres funèbres. La blanche ne vient guère que dans les parties méridionales de la France et de l'Europe, où de tout temps elle s'harmonise, ainsi que la jaune, avec la mauve. »
Bernardin de Saint-Pierre, Harmonies de la nature, 1814, p. 101.
• Voir aussi le poème «Pholoé» de Leconte de Lisle, tiré des Poèmes antiques, où le mot asphodèle est employé au féminin :
« Oublie, ô Pholoé, la lyre et les festins,
les dieux heureux, les nuits si brèves, les bons vins
et les jeunes désirs volant aux lèvres roses.
L' âge vient : il t'effleure en son vol diligent,
et mêle en tes cheveux semés de fils d'argent
la pâle asphodèle à tes roses. »
Ci-dessous le COMMENTAIRE de ymmage rédigé le 19 décembre 2004.
« Hastula Regia, le bâton royal ! Ainsi est encore nommée l'asphodèle. Aucune plante, que je sache, n'est pourvue de tant de noms divers. On l'appelle aussi "bâton de Yâqûb", et le chasseur Orion le porte lorsqu'il chasse. Ainsi désigne-ton son baudrier céleste qu'en la contrée où je me trouve on nomme : I tre Urdinati.
[...]
Ce pays-ci est plein de récits et légendes que je m'efforce de comprendre et dont je m'assure que la cohérence, qui n'est pas immédiatement perceptible, recouvre un monde de savoirs que symbolise l'asphodèle. »
Jacques Lovighi, Le Sultan des asphodèles, Editions Autres Temps, 1995, pages 25-26.
Retour à l' index de mes Topiques de Cap-Corsine
Rédigé par angèlepaoli le 30 décembre 2004 à 00:14 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (0)
29 décembre 2004
Novembre dans le Cap Corse
L’hiver l’a prise au débotté alors même que, à peine quelques jours avant, elle savourait des journées quasi estivales. Finies donc les longues baignades revigorantes dans les criques abandonnées à leur solitude originelle. Les premières neiges ont recouvert les cimes du Cintu et les pluies torrentielles de ces derniers jours ont fait jaillir d’insolites cascades. Le maquis ébroue toutes ses nuances de vert tendre ; les bogues des châtaignes roulent sur les sentes et c’est un bonheur de chaque instant que de redécouvrir la beauté d’une grappe d’arbouses jaunes, orangées ou écarlates, déjà. Ou celle, fragile, de minuscules cyclamens sauvages blottis au creux d’une roche.
Que dire de l’odeur mouillée des champignons tapis sous les feuilles ? Tout ici est rendu à sa dimension vraie ; à sa véritable épaisseur. Et le temps est suspendu dans un hors-temps qui ne peut se comprendre que de l’intérieur. Cette saison - ou plutôt cette hors-saison - est idéale pour renouer avec ce temps de l’enfance qui s’étirait paresseusement sur de longs mois, temps immuable, « toujours renouvelé ». Elle retrouve en ces lieux cet espace-temps dont elle a un besoin viscéral.
La météo incertaine l’a poussée sur les lacets abrupts du haut du Cap, les corniches en à-pic au-dessus de la mer déchaînée. Avec, de loin en loin, un hameau recroquevillé à flanc de montagne, âpre et sauvage dans son silence, sa désolation et sa solitude. De l’autre côté, côté Levant, les îles : l’île d’Elbe, majestueuse et bien ancrée, Capraia, la terrible « île aux chèvres » d’Ugo Betti. Et la perfide Gorgona. Elles sont là, à portée de main, précises dans leur découpe ou leur silhouette en clair-obscur. Elles rappellent que l’Italie déroule sa botte juste en face, à quelques encablures.

Ph.©angelepaoli
Elle a fait halte dans une modeste auberge, rustique à souhait. Elle s’y est régalée d’un repas traditionnel, a cucina nustrale. Assiette de charcuterie : prisuttu, coppa, lonzu, salsiccia ; frittelle au brocciu, stufatu de veau corse, raviolis, fiadone… Un repas qu’elle a laissé se prolonger au rythme lent de la conversation, dans la pénombre naissante d'une fin d’après-midi. La présence d'une jeune et pimpante nonagénaire, une cousine germaine de sa mère, débusquée dans son borgu de Licettu, a grandement contribué à la tenir éblouie autour de la table. Ensemble, ils ont ressuscité les figures du passé et ramené à la lumière des épisodes enfouis de la saga familiale. Qui s’étend jusqu’aux confins des Amériques. Toute une mémoire qu’elle cherche à préserver. Avec une volonté presque désespérée.
Au retour, côté couchant, le ciel était d'encre avec au large une frange de lumière qui balayait l’horizon et incendiait mer et montagnes par-delà Ile-Rousse et Calvi. Elle a fait halte dans le hameau de sa grand-mère Jeanne. Puis, emprunté un sentier frangé d’oliviers pour grimper jusqu’au tombeau de ses aïeules. Cerné de câpriers, de cyprès, de citronniers et de figuiers. Tous ses ancêtres reposent là. Elle a partagé un instant leur silence, dans les paysages sereins et sublimes qu’ils n’ont jamais quittés.
Texte©angelepaoli
Rédigé par angèlepaoli le 29 décembre 2004 à 10:45 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (0)
27 décembre 2004
L'oliu d'uliva in festa è "à l'antica"
Tout récemment, une amie m’a proposé un jeu. Plus qu’un jeu, un travail sur les mots ! À la manière de Francis Ponge ! Mais n’est pas Ponge qui veut. Tant pis, cela ne coûte rien de s’y frotter… même si ça pique un peu !
Soit le mot « huile », puisque c’est le mot qu’elle a choisi : en italien « huile » se dit « olio », en corse « oliu », en anglais « oil » . Et après, mystère ! Comment dit-on « huile » en chinois, en hindi, en ougaritique ou… en araméen ?
Comment aller à l'universel ? Soyons modeste et contentons-nous d’aller voir du côté des racines latines. Tous les mots ont des racines, enfin, je crois ! C’est d’ailleurs une des choses les plus mystérieuses qui soit, à mon sens !
« Huile » vient du latin « oleum » que l’on retrouve dans « oléagineux » ou « oléoduc ». Par exemple. Mais en quoi cela peut-il nous aider ? Je crains fort que, pour le jeu qui nous occupe, les racines latines ne nous soient pas d'une grande utilité.
Comment procéder ? Comment faire le tour de l’huile ? Ces huiles sont si nombreuses, presque aussi nombreuses que les fruits dont elles sont extraites. Huile de noix, huile de soja, huile de tournesol, de pépin de raisin. Huile d'arganier ! Excellente pour la peau ! Huile d’amande douce. Chacune a son odeur. Plus fade, plus âpre, plus nacrée, plus amère ; plus entêtante, plus obstinée ! Chacune a sa teneur particulière. Plus grasse, plus légère, plus fruitée ! Plus translucide ou plus épaisse, plus lourde.
Dans les pays froids, les huiles proviennent d’animaux. Huile de foie de morue, huile de phoques, huiles de baleines. Ce sont des graisses fortes, plus fortes que les huiles végétales ; mais quelle que soit leur provenance, les huiles réchauffent le corps et irriguent la peau, la protègent. Rien n’est plus apaisant pour le corps et pour l’âme qu’un massage aux huiles essentielles.
Comment faire le tour de l’huile ? Aller là où nous porte notre préférence. Pour moi, l’huile, la vraie, l’unique, celle qui est vraiment huileuse, comme la mer étale, sans ride aucune, celle qui est vraiment fruitée, c'est l'huile d’olive. Chacune de ces huiles provient d’une graine et d’un fruit différent (en Corse, variétés Germaine et Sabine). Fruits du soleil pour la plupart.
Qui dit huile, dit donc pour moi olive ! Mais l’olive est modeste et timide. Drupe minuscule, légèrement oblongue, ovoïde, le fruit vert pâle se cache sous les feuilles délicatement argentées de l’olivier. « A cugliera », l'olivaison, se fait à maturité, de décembre à mai, pour le procédé d'élaboration traditionnel : la pulpe est alors légérement colorée. En tendant des filets sous les arbres. En Corse, il était rare que les cugliatori (des femmes pour la plupart d'entre eux) gaulent ou "peignent" les frondaisons, même si les olives déjà tombées à terre donnaient une huile au goût âcre.
Geste ancestral que cette cueillette, que l’on tente de réhabiliter partout où les oliveraies occupent terrasses et restanques. Une fois le précieux trésor mis dans des couffes, les olives sont stockées plusieurs jours, nettoyées, passées au crible et séchées au soleil, puis acheminées, à dos d’ânes ou de mulets, vers le moulin à huile. Ce transport à dos de mulet est ce qu'on appelait autrefois en Corse una mulata.
En Corse, le moulin à huile est appelé u franghju ou bien u fragnu. Ces mots étranges ne le sont pas autant qu’il y paraît. Eux aussi proviennent du latin : « frangere » qui signifie « briser », « concasser ». Dans l’énorme cuve monolithique tronconique du franghju, doublée à l'intérieur de bois (conca), la meule de pierre (macina) tourne sur son axe, actionnée par deux mulets. Pulpe et noyaux d'olives sont alors concassés et broyés (on dit précisément détrités), et la pâte obtenue après le détritage (a franta) est répartie sur des scourtins d'alfa à tresses serrées, des zimbini. Qui sont ensuite empilés sous la presse à vis (parfois à cabestan), jusqu'à une hauteur de presque deux mètres. Les fragnatori recueillent ensuite le liquide mordoré avec une paletta (sorte de pelle plate) pour finalement le verser dans des jarres pansues en terre cuite vernissée. Où l'huile repose plusieurs mois durant avant d'être transvasée et filtrée.
Il en était déjà ainsi aux temps des Bucoliques de Virgile. Aujourd’hui, la Corse a renoué avec ses gestes ancestraux et l’huile de la Balagne a retrouvé sa renommée.
L’huile d’olive, c’est le souvenir des goûters de mon enfance. Le pain humecté d’un filet d’or saupoudré de sel. À quoi s’ajoutait encore le plaisir d’écraser entre les doigts, au-dessus de la tartine, les feuilles de menthe séchée !
Oliviers sur la route de Barrettali (Cap Corse)
Ph.©angelepaoli
Voir aussi le site Blu di Mare qui donne sur ce sujet des explications très détaillées.
Retour à l' index de mes Topiques de Cap-Corsine
Rédigé par angèlepaoli le 27 décembre 2004 à 02:08 dans Kallistè, ma terre de mémoire, La langue ardente (le terroir des mots) | Lien permanent | Commentaires (2)
26 décembre 2004
Ciottoli/Cuticci
Topique : Les cailloux
O-palescents cailloux,
Lucides transcendants de lumière
Pâles de leur patine de verre,
Œil collé rétine sur iris
Rondeurs oblongues fissures et lignes
Anthracites veinées de vert
Clair de mer Yeux d’eau
Cailloux ridés rugueux grimés de sel
Lisses luisants d’algues grises
Roulés de salive inlassable
Laissés lascivement à la rime des vagues
Enfouis dérobés exhumés par les flots
Brisés rompus par les lames d’écume
Bribes du temps
Fragments d’éternité
Fatigués ressassés rassis et rassasiés
Sassi abandonnés
Rebondis au talus de la plage
Temples improvisés par les mains passagères
Cœurs fléchés des amants de l’été
Cercles sacrés des ciottoli
Laissés là pour mémoire
Hiéroglyphes éphémères
Signes moirés
Du temps enfui Abandonné au temps
Fusion dans l’infini
Du ciel et de la mer
Texte©angelepaoli
Voir aussi « L’Homme et le caillou » de Jacques Réda
Retour à l'index de mes Topiques de Cap-Corsine
Rédigé par angèlepaoli le 26 décembre 2004 à 12:18 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (0)
18 décembre 2004
Les brodeuses
(j’emprunte ce poème à Marie-Pool qui vient de me le faire parvenir en commentaire).
« Dominant les forêts
traversant les rivières
l'été aux yeux de raisin mûr
marche vers nous dans le soleil
Jarres d'huile murées
dans le silence de midi
les femmes écoutent battre un coeur
qu'elles ont caché dans cette terre
Jadis elles débusquaient l'été
se baignaient nues dans la rivière
bêtes et flammes les suivaient
et le vent frémissait
dans les sentiers
sous leur regard
Et sous leurs doigts les soies s'emmêlent
capturant sources et rumeurs
destinant cette fièvre
née du feuillage et des couleurs »
Marie-Paule Lavezzi, Le Chant des brodeuses, CRDP de Corse, 1988, page 10.
Voir aussi une petite anthologie poétique de Marie-Paule Lavezzi.
Voir encore les poèmes d'une autre brodeuse corse : Marie-Ange Sebasti.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé par angèlepaoli le 18 décembre 2004 à 16:41 dans Kallistè, ma terre de mémoire, Poésie insulaire (spicilège), Ritratti di donne (portraits de femmes) | Lien permanent | Commentaires (0)
Soliloque de la colline

Désert des Agriates.
Ph.©angelepaoli
Je ne raconte pas d’histoire
l’imagination s’enfuit à la dérobée
tout au plus trois générations d’ancêtres
et au-delà le silence acéré du vent
les goélands d’Audouin
nichés au creux des îles
le gecko du maquis arrimé sur un morceau d’épave
alors commence la rumeur
bruyante des hommes
retour à l’asphodèle et à son chant
au vent chaud qui caresse la chevelure du maquis
au miroir des sirènes
palimpseste de la mémoire
Texte©angelepaoli
Rédigé par angèlepaoli le 18 décembre 2004 à 14:16 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (0)
15 décembre 2004
Marie-Ange Sebasti, la Sartenaise

Marie-Ange Sebasti en août 2004
au restaurant Lavezzi à Bastia.
À la voir si menue et si réservée, on ne saurait imaginer que derrière tant de modestie se cachent à la fois un chercheur et un poète ! Eh bien oui, Marie-Ange Sebasti mène de front ses propres travaux d’écriture et ses activités d’ingénieur au CNRS ! Avec sa formation supérieure de Lettres classiques, elle aurait pu se consacrer à l’enseignement. Elle a préféré mettre à profit sa formation pour fouiller d’autres champs d’investigation… et d’autres lointains.
Marie-Ange a une passion. Une passion qui va bien au-delà des simples savoirs, pourtant très pointus, qu’exige la recherche. Elle se passionne pour l’écriture : écriture épistolaire et écriture oratoire, dont elle décortique la rhétorique et analyse les fonctions. Et cette passion prend corps chez les Pères de l’Eglise. Dans la littérature patristique. Côté épistolaire, les Lettres de Firmus de Césarée, évêque de Cappadoce. Côté discours, le théologien Grégoire de Nazianze, « philosophe » chrétien du IVe siècle de notre ère. L’art oratoire de ce prédicateur, dont elle traduit et commente les Discours (Discours, 6 à 12), Marie-Ange en exhume les clés proprement « littéraires ».
Marie-Ange, yeux pétillants de malice et petit sourire fin au fil des lèvres, est une femme sensible et fière. Fierté sauvage qui est le sceau des femmes insulaires. La terre de Marie-Ange, c’est Kallistè, la Corse. Et le sol de ses ancêtres, Sartène. C’est dans cette sève-là, faite des lumières et des senteurs de son île, que sa plume puise sa source. Délicatement empreinte des nostalgies des montagnes ancestrales, sa poésie regorge d’images bouleversantes. Une écriture des profondeurs, scandée par une rythmique forte, nourrie des alternances de dactyles et spondées. C’est cela, l’écriture poétique de Marie-Ange. Une écriture de chair et d’âme. Car Marie-Ange Sebasti vit dans la poésie et pour la poésie. Une poésie à plein temps qui se nourrit aussi de sa vie de « continentale ». Et de ces échanges nourris et incessants entre l’être-dans-l’île et l’être-hors-de-l’île.
Marie-Ange vit la poésie comme une injonction à vivre et à saisir tous les instants. Avec le temps, ses textes s’amenuisent, se condensent, se densifient. Elle va vers le moins-de-mots avec toujours plus de rythme, toujours plus de souffle. Et dans ce souffle-là, il y a comme une traînée de poudre légère mais volontaire qui court d’un poème à l’autre, comme un trait de révolte qui suit sa trajectoire assurée. La poésie de Marie-Ange, c’est une poésie qui ébranle et dérange, décentre, oblige au déplacement celui qui croise ses textes. Une poésie de la traque, alors ? Oui, c’est cela, une poésie de la traque – dure et tendre à la fois - à laquelle il faut se laisser prendre pour en savourer toutes les traces !
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Marie-Ange Sebasti a notamment publié :
Effleurements, Regain, 1963.
Paroles pour une île, Promotion et Édition, 1967.
Contours apparents, Collection « Les Poètes de Laudes », n°12, Cahier 95, 1989.
Presque une île, La Marge Édition, 1997. Préface de Charles Juliet.
Corse dans le chalut des jours, avec des photos de Monique Pietri, Éditions de l’Envol (2001).
Seuils, poème, avec une gravure de Bernadette Planchenault, Empreintes, Paris juin 2002.
Demain, poème, avec une gravure de Bernadette Planchenault, Empreintes, Paris, juin 2004.
Les Marges arides, in Friches/Cahier de poésie verte n° 85 (hiver 2004).
Ouvrage collectif, Ougarit, la terre, le ciel, La Part des Anges éditions, 2004. Textes réunis par Marie-Ange Sebasti et Joël Vernet.
Texte©angelepaoli
Voir :
- une petite anthologie poétique de Marie-Ange Sebasti.
- une autre petite anthologie de Marie-Paule Lavezzi, originaire de Sartène, tout comme Marie-Ange Sebasti.
Voir aussi un autre poème ("Filigrane") de Marie-Ange Sebasti sur le site Zazieweb.
Voir également le portrait de Marie-Ange Sebasti dans la galerie de Guidu.
Voir encore le portrait de Marie-Ange Sebasti sur le blog LA CAUSE DES CAUSEUSES.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé par angèlepaoli le 15 décembre 2004 à 13:55 dans Kallistè, ma terre de mémoire, Ritratti di donne (portraits de femmes) | Lien permanent | Commentaires (0)
11 décembre 2004
Isula
« Puisatier du verbe, je n’ai de lien qu’avec l’opaque » (Claude Louis-Combet, Le Petit Œuvre poétique, José Corti, page 75).
La vraie culture étant au plus près du flux de l’origine « pas encore avalisée » et gardant toujours « un reflet de l’innocence native » et de l’émerveillement de l’enfance, comme le souligne Philippe Jaccottet dans Paysages avec figures absentes, que vaudrait le réel sans cette figure du désir qu’est l’illusion ?
À la manière de Jaccottet, j’aimerais, « l’esprit assuré », simplement sourire de quiconque s’écrie : « J’ai compris le secret du langage, il n’y a pas deux manières de dire », mais je préfère confier au lecteur ces vers de Mathieu Terence en forme d’envoi de mon île natale :
« Je longe la plage
Ce sable d’accord
Avec son poids si blanc,
Et je m’allonge
Dans une eau
Aux dimensions du monde. » Ph.©angelepaoli
Mathieu Terence, L’Ile, Editions Leo Scheer, 2004, page 22.
Sur le thème de l'île, je conseille la lecture des actes du colloque « L’Île Laboratoire » de l'Université de Corse (19 au 21 juin 1997). Textes réunis par Anne Meistersheim et publés par ailleurs par les éditions Alain Piazzola.
Voir aussi Isula, Insula.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé par angèlepaoli le 11 décembre 2004 à 15:23 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (3)
La Corse est un cosmo-poème
Comme le souligne le nomade intellectuel Kenneth White, la Corse est une terre idéale pour les cheminements de la géopoétique. Car à elle seule, « la Corse est un cosmo-poème ». Dans le courant du XIXe siècle, il a d’ailleurs existé à Bastia une Accademia dei Vagabondi. Elle recrutait ses membres parmi ces « errants » et navigateurs qui partaient suivre leurs études à Pise, à Gênes ou à Padoue, ou, en bons descendants de Ghjacumu de Negroni (cet amiral qui en 1571 partit de Macinaggio pour combattre les Turcs à Lépante avec ses quatre felouques, la Capitana, la Padrona, la Bastarda et la Quarta) s’exilaient un temps aux Amériques.
Pour White, la Corse est « un petit morceau de la Terre, un microcosme ». Il y a rencontré Esprit Requien, le botaniste avignonnais, auteur d’un Catalogue des coquilles de la Corse (1848), James Boswell, l’ami d’un autre herboriste et promeneur solitaire, Jean-Jacques Rousseau, mais aussi de Pascal Paoli (« u babbu di a patria »). Boswell est aussi l’auteur d’un Account of Corsica. The Journal of a Tour to that Island (traduit et édité aux éditions du Rocher). White a aussi croisé le navigateur corse Dominique Cervoni, né et mort à Luri, et qui apprit la navigation à Joseph Conrad, mais encore le philosophe en exil Sénèque qui détestait les montagnes corses : « Barbara praeruptis inclusa est Corsica saxis/ Horrida desertis undique vasta locis » (lire la Lettre de Corse de Sénèque publiée en 1995 aux éditions San Benedetto d’Ajaccio).
Corsica, l’Itinéraire des rives et des monts est tout à la fois « nouvelle (éclatée), livre de voyage (radical), essai (extravagant) ou poème (du monde). » Un cheminement à conseiller à tous ceux qui veulent explorer dans leur propre vie les champs inédits du possible.
Kenneth White, Corsica. L'Itinéraire des rives et des monts, Editions San Benedetto - La Marge éditions, Ajaccio.
EXTRAIT
« Pourquoi avais-je si envie d’aller à U Campu ? Eh bien, c’est ici qu’est né Dominique Cervoni, le marin corse que Joseph Conrad aimait tant et dont il parle dans Le Miroir de la mer. J’y suis finalement arrivé : un petit village plongé dans le silence et l’odeur de la fumée de bois. La maison de Cervoni n’a rien de remarquable. Mais elle porte cette plaque à sa mémoire :
Dans cette maison est né
le 28 août 1834
Dominique André Cervoni
navigateur et grand aventurier
Il y mourut le 27 juillet 1890
Pour Conrad, Cervoni était un « frère ». Ce qui ne voulait pas seulement dire qu’il faisait partie de la grande fraternité de la mer, mais qu’il était en quelque sorte un étranger (un isolato) au milieu de ses semblables, à tel point qu’il pouvait transcender leurs codes, même ceux qu’il respectait le plus, au nom de quelque chose d’autre, n’acceptant comme juge de ses faits et gestes secrets que le ciel vide et l’implacable océan. »
(page 92)
A peu de distance de ce hameau de Luri, qui a beaucoup marqué Kenneth White, trois îles aux oiseaux : la réserve naturelle des îles Finocchiarola (les îlots A Terra, Mazzana et Finocchiarola, au nord-est du Cap Corse, près de Macinaggio), principal site de nidification du goéland d'Audoin en Méditerranée.
« Ici, sur l'île aux oiseaux
[...]
j'ai retrouvé mon être vrai
qui est incandescence
la pensée à peine perceptible
perdue dans l'immanence. »
Kenneth White, Mahamudra [1979], Mercure de France, 1987, page 80.
Retour à l'index des auteurs
Texte©angelepaoli
Rédigé par angèlepaoli le 11 décembre 2004 à 02:09 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (1)
Voceru

Jeanne et Hélène Bresciani,
Deux, rue de la marine.
Dans ce récit à quatre mains, qui est Jeanne, qui est Hélène ? C’est la question que se pose d’emblée le lecteur dès qu’il s’immerge dans le texte. Deux écritures s’entrecroisent, se répondent à deux voix. Thrène autour de la mort du père tant (et trop mal ?) aimé. Déploration aussi autour de la sœur cadette disparue à peine née. Un « chjama è rispondi », mais aussi un long « voceru » venu des montagnes corses de la Casinca.
Très vite, le lecteur s’approprie le récit des deux sœurs, dont l’enfance bastiaise se déroule dans le vieux quartier qui donne d’un côté sur la place du marché, de l’autre sur des venelles, des « carrughju », ruelles escarpées déboulant sur les quais animés et paresseux du Vieux-Port. 2, rue de la Marine. C’est là, dans l’unique immeuble de la rue, que grandissent Hélène et Jeanne. Protégées mais tenues par la figure tutélaire du foyer, le père. Très vite aussi, au-delà de la « marche typographique » qui permet de différencier les deux écritures (caractères avec ou sans empattement), la voix de Jeanne s’inscrit dans un registre différent de celui d’Hélène. Une tonalité mineure sans doute. Dolente, souvent. Hélène l’aînée est plus solaire. C’est pourtant elle qui a vécu la mort de sa cadette, mort suivie de la naissance de la benjamine. Entre les deux bébés pas de différence. Les mêmes interdits précautionneux pèsent sur la joue tiède de la petite dernière et sur la joue déjà froide de celle qui n’a fait que passer. Pour Hélène, la naissance de l’une se superpose presque avec la mort de l’autre. Cette sœur qu’elle attendait avec tant d’impatience pour pouvoir partager avec elle ses jeux d’enfant, voilà qu’elle va se prendre « à l’aimer de loin, avec maladresse et chutes sous la lune, puis la jalouser si fort » qu’elle en oubliera de l’aimer. Jeanne, « l’enfant arc-en-ciel » joue ses jeux en solitaire, des jeux étrangement funèbres, douloureusement ritualisés. Elle est celle qui s’abîme en d’infinis « soliloques sur l’invisible. » Celle qui s’est incarnée dans le chant des pleureuses antiques.
Marquées par les événements familiaux de leur enfance corse, les deux sœurs sont pourtant très différentes. Hélène, même si elle se dit « austère », se laisse étourdir par les « divertissements » de sa vie d’étudiante aixoise. Décidée à s’affranchir coûte que coûte de l’emprise du père. Son écriture est plus distanciée que celle de Jeanne la révoltée, la ténébreuse, la tendre rebelle ! La blessure intérieure de Jeanne serait-elle plus profonde ? Plus indéracinable ? L’écriture de Jeanne est dense et sombre. Et avec elle émergent les vieux démons insulaires. Le rapport au temps et à la mort qui ne font qu’un ! Et, tout d’un coup, le lancinant aveu que « Plus rien jamais ne sera comme avant » ! C’est des rets de cette révélation que se tisse cette insatiable mélancolie. Qui ronge à jamais l’âme de celle qui croit pouvoir échapper à sa terre en la fuyant et accomplit en s’évadant l’inéluctable et indéfectible « parricide ».
Cet ouvrage, qui a obtenu en 2000 le Prix du livre corse de langue française, est aujourd'hui épuisé chez l'éditeur. Qui prendra l'initiative de le rééditer ?
Jeanne et Hélène Bresciani, Deux, rue de la marine, Editions Les Vents contraires, Aix-en-Provence, 1999.
EXTRAIT :
« Sans doute, l’oubli viendra-t-il, paradoxalement, d’avoir remué tant de souvenirs… L’oubli ou une forme de légèreté.
J’ai hérité de toi quelques lambeaux de phrases, quelques maladresses, quelques expressions intérieures que je ne transmettrai, à mon tour à personne. J’ai du mal à écrire là où les mots vont te toucher de près, parce qu’ils rouvrent d’anciennes blessures. J’ai l’impression d’inventer ta vie pour te mettre à mort, une seconde fois, mais le plus important est ce qu’on ne dit pas. Ce silence entre nous - silence de mort ? - comme une respiration entre les phrases. Le non-dit est un vrai garde fou, car si l’écriture peut créer des chimères, elle les défait aussi, nous présentant son verdict implacable.
Tu vois, je suis revenue au plus près de toi, au plus près de moi, pour me souvenir sans cesse de ta vie, même si je sais que mes phrases ne te comprendront jamais tout à fait, toi ou tes raisons, même, si par l’encre me gagne, inexorablement, l’ombre de ton agonie… »
(page 190)
Voir aussi ma contribution sur Les Vestiges de Janvier de Jeanne Bresciani.
Retour à l' index des auteurs
Texte©angelepaoli
Rédigé par angèlepaoli le 11 décembre 2004 à 00:31 dans Kallistè, ma terre de mémoire | Lien permanent | Commentaires (0)