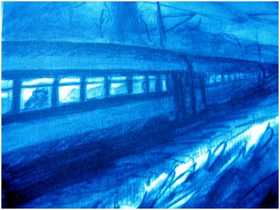Chroniques de femmes - EDITO

Laure Pigeon,
Collections du Musée de l'Art brut, Lausanne
L'ART SPIRITE
Notre siècle sera-t-il celui du spiritisme? Alors que l'on aurait pu penser que l'avènement de l'idéologie capitaliste allait ranger au placard toute considération occultiste ou paranormale, force est de constater qu'il n'en est rien, bien au contraire. Comme si le besoin de chercher ailleurs ce que nous ne trouvons pas dans ce monde que nous nous sommes créé pour notre bien-être matériel se traduisait par un recours à des manifestations longtemps considérées comme relevant de l'obscurantisme.
Michel Thévoz décrit le spiritisme comme une croyance ou une pratique médiumnique spécifique, datée, doctrinale et ritualisée, admettant généralement le principe de la réincarnation. On peut y voir la substitution d'un « paradis réellement terrestre à l'éternité éternellement différée des religions instituées » (Michel Thévoz, Le Règne des revenants, in L'Art spirite, Musée de l'art brut, Lausanne, 2005, page 7).
Ce n'est pas du spiritisme à proprement parler que j'ai envie de m'entretenir ici mais de l'art qui en découle, simplement baptisé « Art spirite ». Un art dont on parle peu et qui fait encore trop souvent défaut dans les anthologies artistiques. Pourquoi donc ? A mes yeux, il relève pourtant entièrement de l'art moderne, qui requiert que l'on travestisse (ou subvertisse) les apparences visuelles, que l'on s'éloigne des sentiers de la représentation classique, au profit d'une réalité répondant à des critères plus symboliques et moins réglementés.
Sur ce point, Michel Thévoz, toujours, évoque le grand rôle joué par le spiritisme, grâce à une entité propre nommée le périsprit, à savoir une enveloppe survivant au trépas de certaines personnes, tantôt visible, tantôt tangible, sorte de figure en souffrance qui se prête volontiers à la création et à la déformation graphique, une figure hautement plastique et malléable, harmonieusement évanescente. Il est permis de tout représenter. La matière et l'esprit ne connaissent plus de limites, les artistes spirites réussissent là où d'autres ont échoué: représenter le vide. En se détachant de toute volonté et pensée consciente, ces œuvres sont le fruit d'un automatisme mental qui repousse naturellement les limites de la création artistique.
Parmi les artistes appartenant à ce mouvement, les plus connus sont Augustin Lesage, Laure Pigeon, Fernand Desmoulin, Jeanne Tripier, Madge Gill, Joseph Crépin, Marguerite Burnat-Provins, Hélène Smith, Josef Kotzian, Léon Petitjean, et d'autres… personnes a priori éloignées de toute activité artistique et qui ont commencé à dessiner, peindre et écrire sous une impulsion dictée de l'extérieur.
Ces artistes affirment être en contact avec un autre monde, celui des défunts, des êtres qui leur donneraient une marche à suivre. En examinant de plus près le parcours de certains de ces artistes spirites, quelques constantes se dégagent: ils affirment entrer en contact avec l'au-delà, ils se lancent dans un processus créatif fébrile, proche dans quelques cas de la transe, ils exécutent leur travail de manière spontanée et rapide, sans jamais hésiter sur le geste à accomplir. Cela donne des résultats étonnants, pour ne pas dire époustouflants. Le trait est sûr, net et précis. L'élégance et le raffinement sont au rendez-vous, la maladresse qui peut apparaître n'est jamais perçue comme un manque de talent. Si, la plupart du temps, ces créations sont abstraites, on y retrouve cependant régulièrement des compositions florales, des animaux ou des humains, occupant tout l'espace soumis à la main de l'artiste.
L'Art spirite s'intègre à merveille dans ce que l'on appelle l'Art brut, un art pratiqué par des personnes ayant échappé pour diverses raisons au conformisme social et au conditionnement culturel, et qui produisent des œuvres sans tenir compte des règles, de la mode ou de la tradition. En y regardant de plus près, on relève assez vite un élément particulier que des historiens d'art cherchent encore à comprendre et expliquer: la féminisation de l'art spirite. Composé et représenté par une majorité de femmes. Un fait à souligner, car étonnant si l'on le replace dans un ensemble plus vaste constitué de tous les courants artistiques à travers le monde.
Quel lien dès lors établir entre spiritisme, art spirite et féminité ? La question reste ouverte et je compte sur votre collaboration pour m'aider à y répondre !
Marielle Lefébure
D.R. Texte Marielle Lefébure
Retour au répertoire de mai 2005