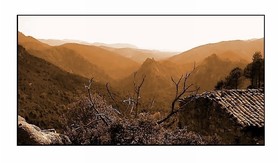Eugène Delacroix par lui-même
Autoportrait,
Eugène Delacroix par lui-même
Autoportrait, vers 1837
Musée du Louvre, Paris
LA CATHÉDRALE DE ROUEN
« Ce jour, sorti tard : vu la cathédrale, qui est à cent lieues de produire l’effet de Saint-Ouen ; j’entends à l’intérieur, car extérieurement, et de tous les côtés, elle est admirable. La façade : entassement magnifique, irrégularité qui plaît, etc. Le « portail des libraires » aussi beau. Ce qui m’a le plus touché, ce sont les deux tombeaux de la chapelle du fond, mais surtout celui de M. de Brézé. Tout est admirable, et en première ligne la statue. Les mérites de l’antique s’y trouvent réunis au je ne sais quoi moderne, à la grâce de la Renaissance : les clavicules, le bras, la jambe, les pieds, tout cela d’un style et d’une exécution au-dessus de tout. L’autre tombeau me plaît beaucoup, mais l’ensemble a quelque chose de singulier ; peut-être est-ce l’effet de ces deux figures posées là comme au hasard. Celle du cardinal en particulier, est de la plus grande beauté, et d’un style qu’on ne peut comparer qu’aux plus belles choses de Raphaël : la draperie, la tête, etc.
À Saint-Maclou ; vitraux superbes, portes sculptées, etc. Le devant sur la rue a gagné à être dégagé. On a fait là depuis quelques années une nouvelle rue à la moderne qui va jusqu’au port […] »
Eugène Delacroix, Journal 1822-1863, Plon 1996, pp. 206-207.
EN GUISE DE COMMENTAIRE :
Dans Madame Bovary de Flaubert, le premier rendez-vous amoureux d’Emma avec Monsieur Léon, son premier amant, a lieu à l’intérieur même de la cathédrale de Rouen, chapelle de la Vierge, où elle l’attend.
« Emma priait, ou plutôt s’efforçait de prier [...] ».
Arrive le garde suisse.
« […] Revenu à la chapelle de la Vierge, le bonhomme étendit les bras dans un geste synthétique de démonstration, et plus orgueilleux qu’un propriétaire campagnard vous montrant ses espaliers :
— Cette simple dalle recouvre Pierre de Brézé, seigneur de la Varenne et de Brissac, grand maréchal de Poitou et gouverneur de Normandie, mort à la bataille de Montlhéry, 16 juillet 1465.
Léon, se mordant les lèvres, trépignait.
— Et, à droite, ce gentilhomme tout bardé de fer, sur un cheval qui se cabre, est son petit-fils, Louis de Brézé, seigneur de Bréval et de Montchauvet, comte de Maulevrier, baron de Mauny, chambellan du roi, chevalier de l’Ordre et pareillement gouverneur de la Normandie, mort le 23 juillet 1531, un dimanche, comme l’inscription porte ; et au-dessous, cet homme prêt à descendre au tombeau vous figure exactement le même. Il n’est point possible, n’est-ce pas, de voir une plus parfaite représentation du néant ?
Madame Bovary prit son lorgnon. Léon, immobile, la regardait, n’essayant même plus de lire un seul mot, de faire un seul geste, tant il se sentait découragé devant ce double parti pris de bavardage et d’indifférence.
L’éternel guide continuait :
— Près de lui, cette femme à genoux qui pleure est son épouse, Diane de Poitiers, comtesse de Brézé, duchesse de Valentinois, née en 1499, morte en 1566 ; et à gauche, celle qui porte un enfant, la sainte Vierge.
[…] Léon fuyait ; car il lui semblait que son amour, qui depuis deux heures bientôt, semblait immobilisé dans l’église, comme les pierres, allait maintenant s’évaporer tel qu’une fumée, par cette espèce de tuyau tronqué*, de cage oblongue, de cheminée à jour, qui se hasarde si grotesquement sur la cathédrale, comme la tentative extravagante de quelque chaudronnier fantaisiste. […] »
____________________
* Le "tuyau tronqué" désigne la flèche de la cathédrale, précédemment décrite.
Gustave Flaubert, Madame Bovary (1857), in Œuvres, Tome I, Bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, 1962, pp. 545-546-547.
______________________
Note d’Angèle : à cet extrait fait suite la célèbre scène du fiacre. Souvenir vibrant des amours de Flaubert et Louise Colet. Autour du même sujet, écouter Le Fiacre, une chanson écrite par Xanrof (1888) et chantée par Yvette Guilbert (1934).