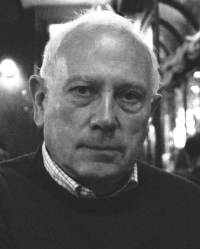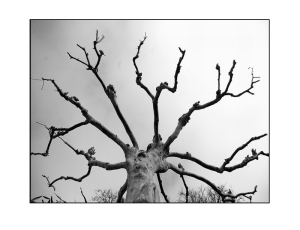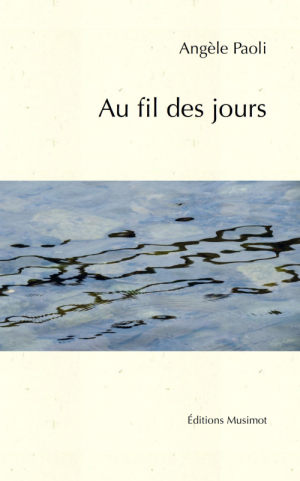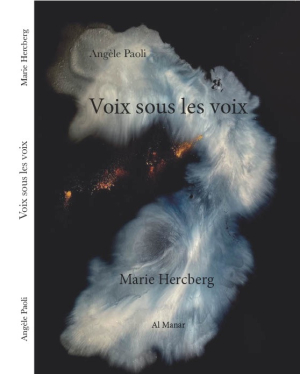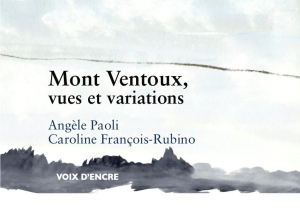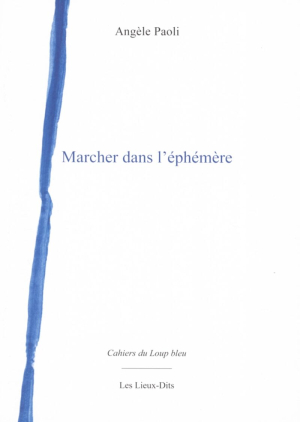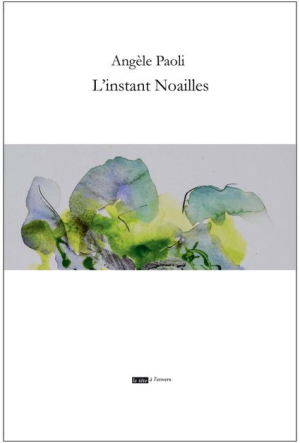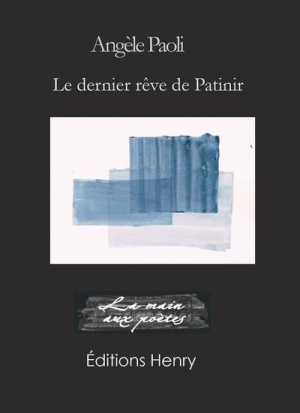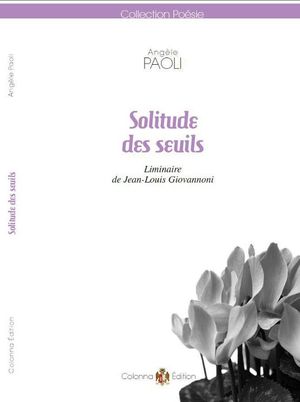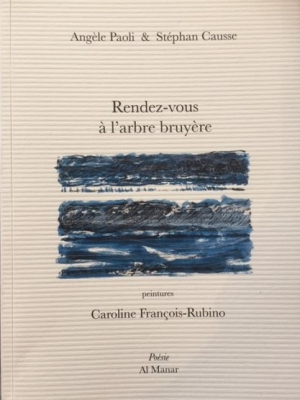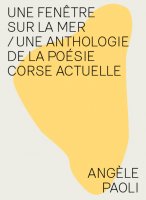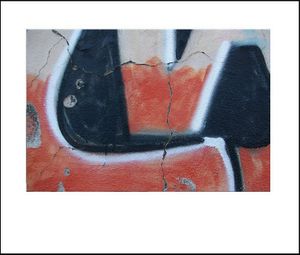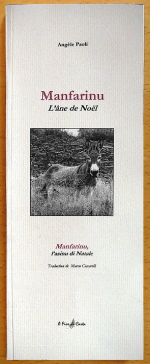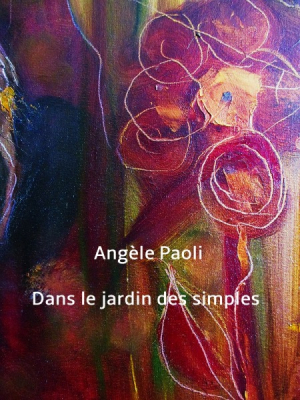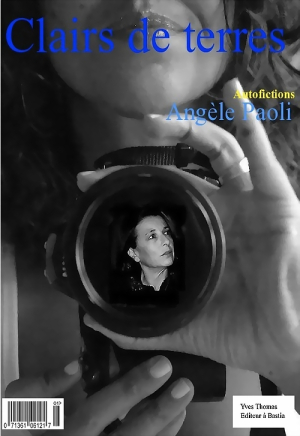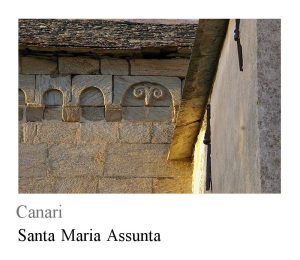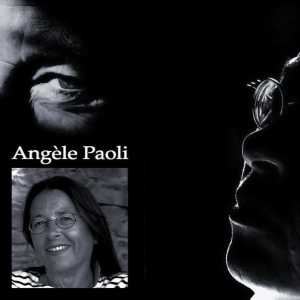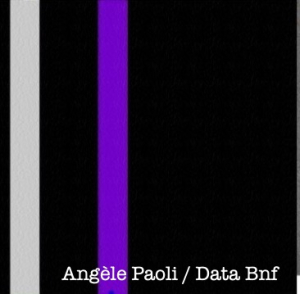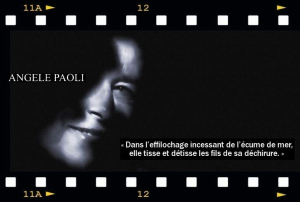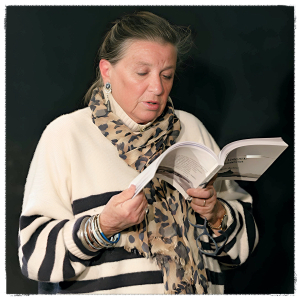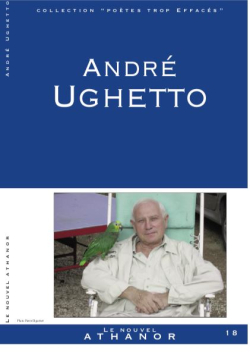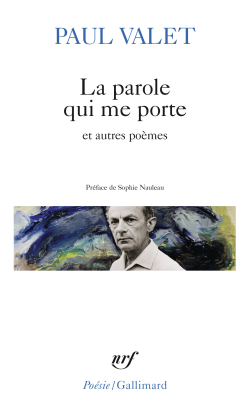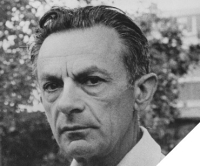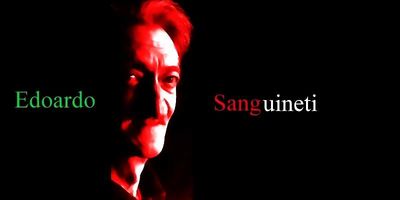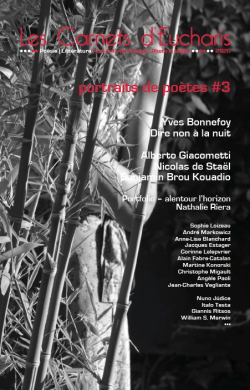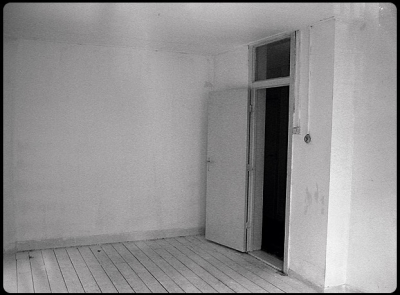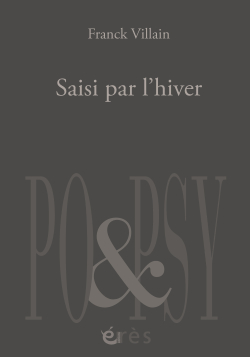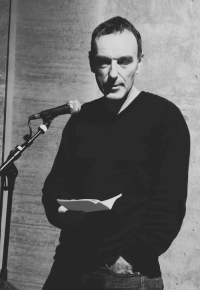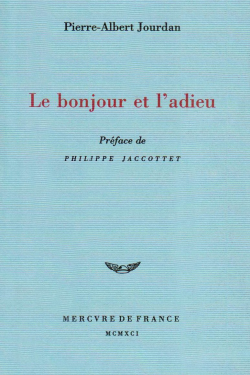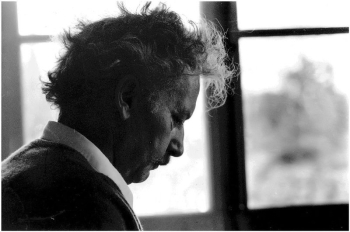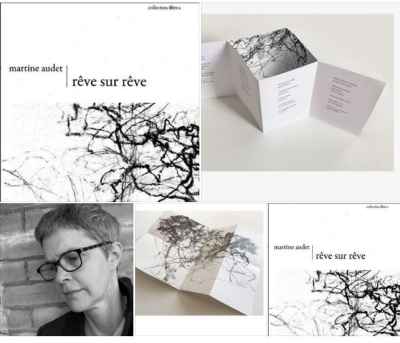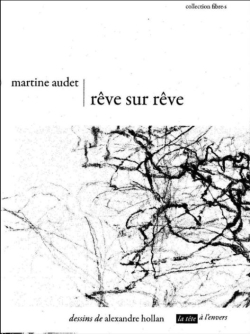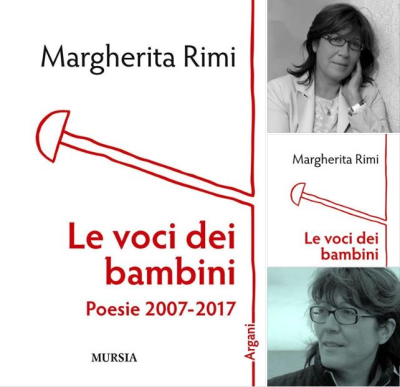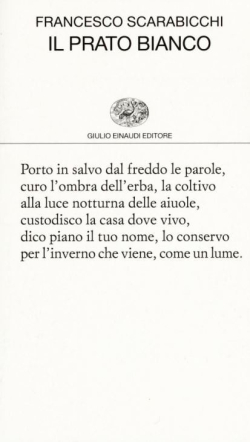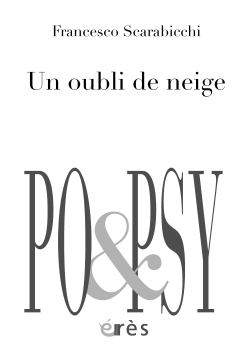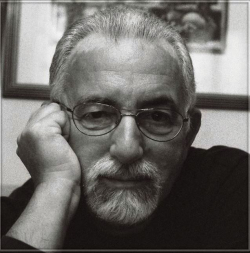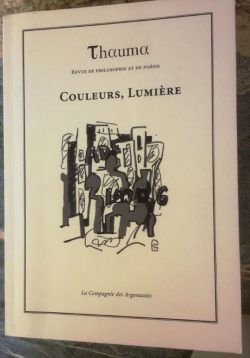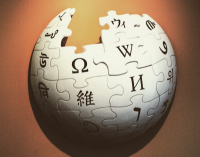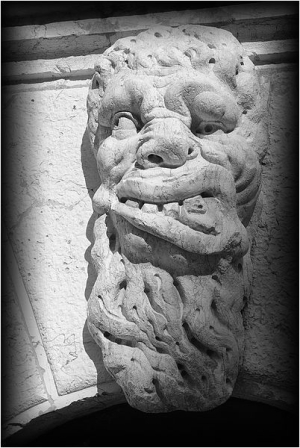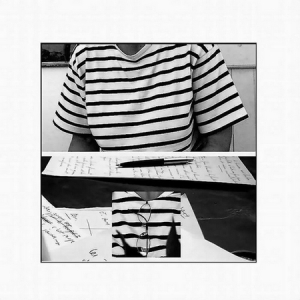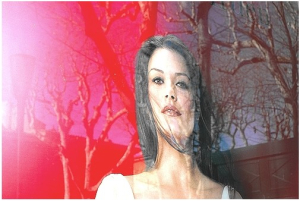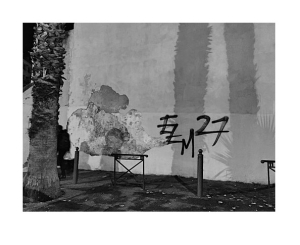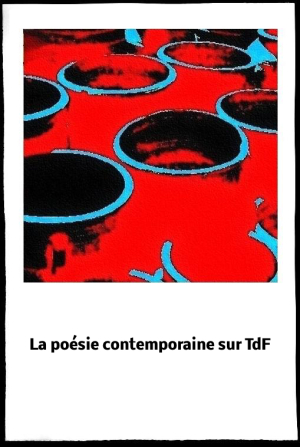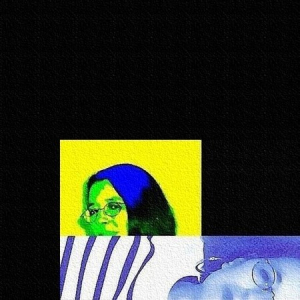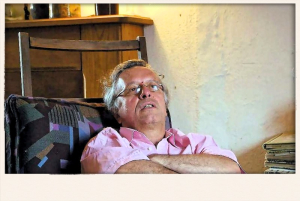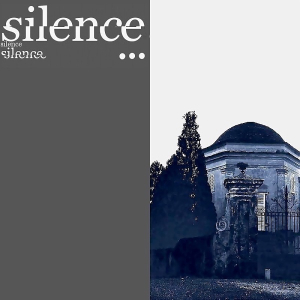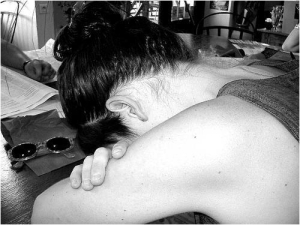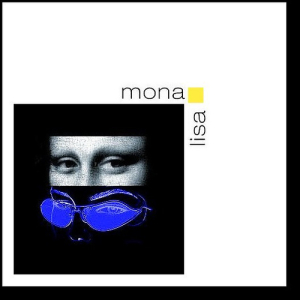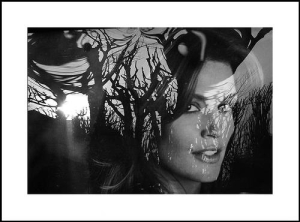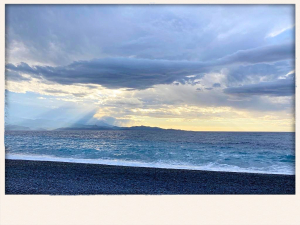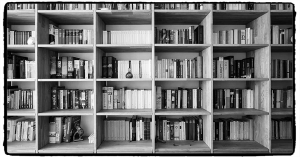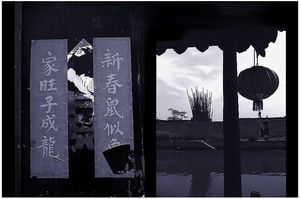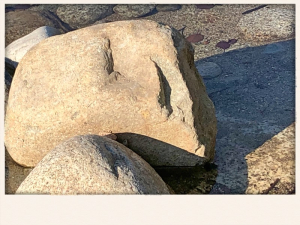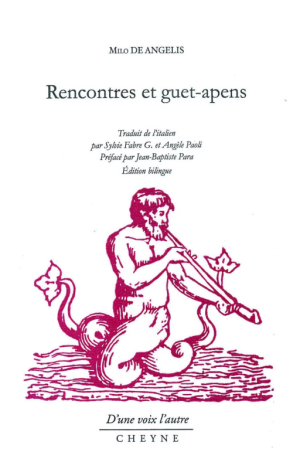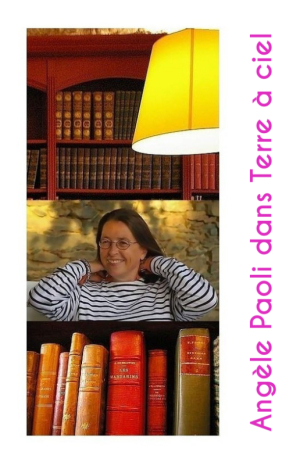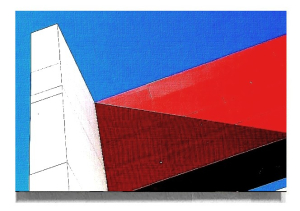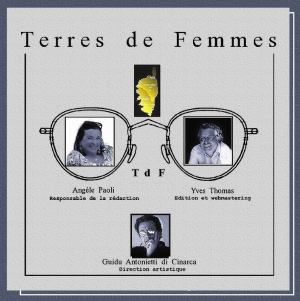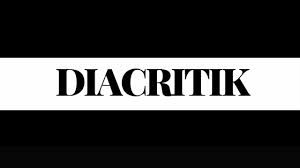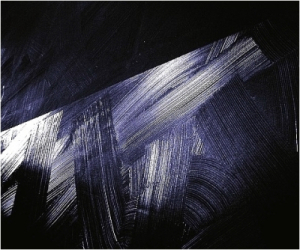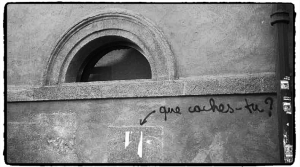Source
LABORINTUS II Source
LABORINTUS II
(estratto)
proprium opus humani generis totaliter accepti
est actuare semper totam potentiam intellectus possibilis:
per prius ad speculandum
et secundario propter hoc ad operandum
per suam extensionem
et quia quemadmodum est in parte sic est in toto
et in homine particulari contingit
quod sedendo et quiescendo
prudentia et sapientia
ipse perficitur
patet quod genus humanum
in quiete sive tranquillitate pacis
ad proprium suum opus
quod fere divinum est
iuxta illud «minuisti eum paulo minus ab angelis»
liberrime atque facillime se habet
unde manifestum est quod pax universalis
est optimum eorum que ad nostram beatitudinem ordinantur
hinc est quod pastoribus de sursum sonuit
non divitiae non voluptates non honores non longitudo vitae non sanitas non robur non pulchritudo
sed pax
LABORINTUS II
(extrait)
l’œuvre propre du genre humain pris dans son ensemble
est de transformer sans cesse en acte toute la puissance possible de l’intellect :
en premier lieu pour spéculer
et en deuxième lieu opérer en conséquence
pour son extension
et puisqu’il en va ainsi du tout comme de ses parties
et qu’il advient à l’homme particulier
qui sait s’asseoir et se reposer
de s’accomplir lui-même
par prudence et sagesse
il est clair que le genre humain
dans le repos c’est-à-dire tranquillité de la paix
trouve très librement et facilement
à se donner à son œuvre propre
laquelle est presque divine
selon la parole « à peine le fis-tu moindre que les anges »
d’où il est évident que la paix universelle
est la meilleure des choses ordonnées pour notre béatitude
d’où vient que des hauteurs retentit aux bergers
non pas richesse ni voluptés ni honneurs ni longueur de vie ni santé ni force ni beauté
mais paix
Edoardo Sanguineti, Laborintus II, Revue littéraire L’Ours Blanc, n° 6, éditions Héros-Limite, 1205 Genève, mars 2015, pp. 14-15. Traduction française de Vincent Barras.
_____________
NOTE DU TRADUCTEUR (extrait) : le poème Laborintus II est constitué d’un montage complexe de passages tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament, des Étymologies d’Isidore de Séville, de la Vita Nova, du Banquet, du traité De la Monarchie et de l’Enfer de Dante, de commentaires médiévaux sur la Divine Comédie de Benvenuto da Imola et de Pietro Alighieri, fils de Dante, des Cantos d’Ezra Pound, des Four Quartets de Thomas S. Eliot, mêlant ces fragments composés en des langues diverses à des extraits de ses propres recueils Laborintus (1954) et Purgatorio de l’Inferno (1963) ainsi qu’à des parties originales.
Loin d’être un simple collage de citations, un banal syncrétisme, ce poème impose le principe d’un décalage et d’une confrontation généralisée : entre les différentes langues utilisées, entre l’emploi du latin, langue « morte » et « liturgique », et celui des langues vivantes, entre la langue de Dante et l’italien contemporain, entre les blocs sémantiques juxtaposés avec leurs inflexions contradictoires, entre les niveaux phonétique et typographique. En résulte une écriture âpre et tendue, instrument organisateur du discours poétique à l’énergie éruptive et chaotique, une écriture servie, qui plus est, par la disposition typographique rigoureuse, entendue comme une prosodie spatiale.

|
Retour au répertoire du numéro de mai 2020
Retour à l’ index des auteurs
Retour à l' index de la catégorie Péninsule (littérature et poésie italiennes)