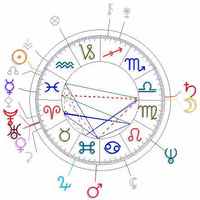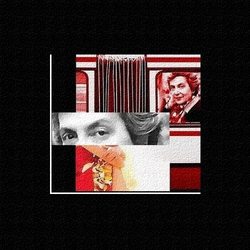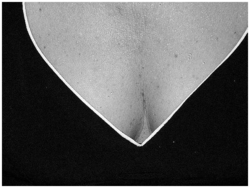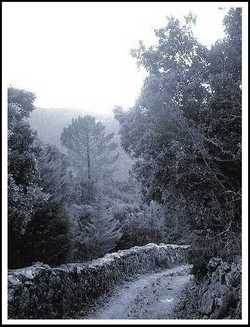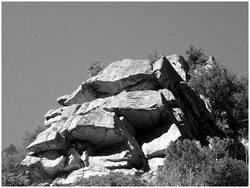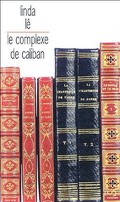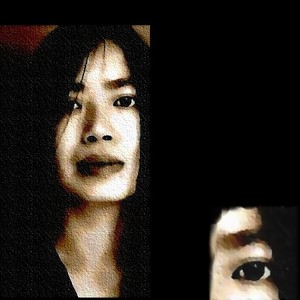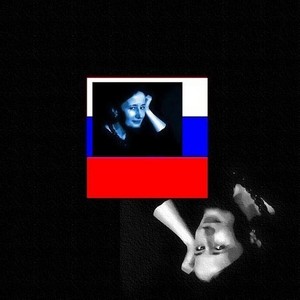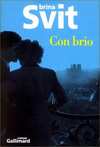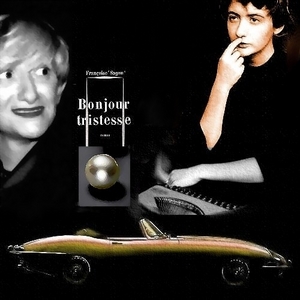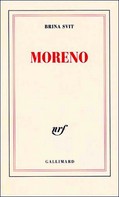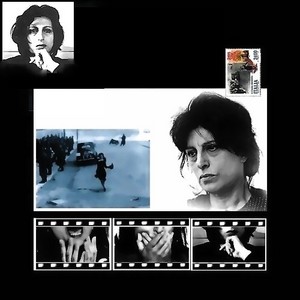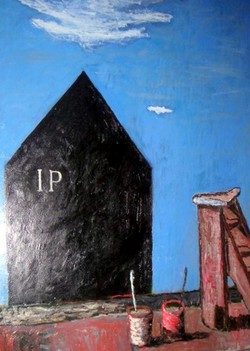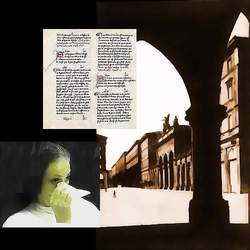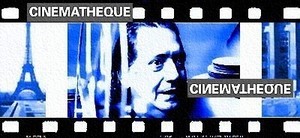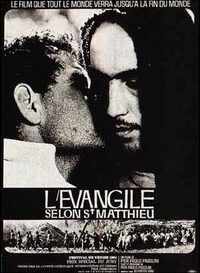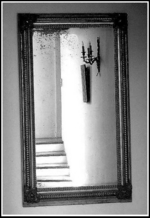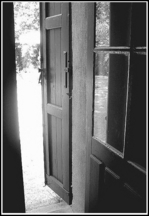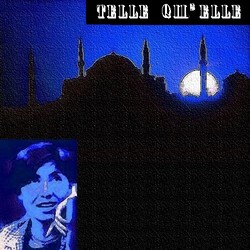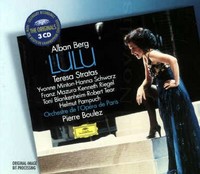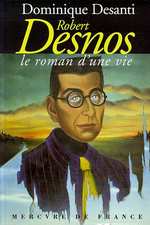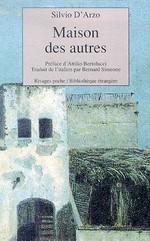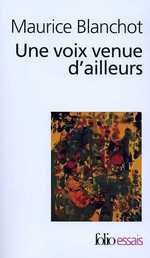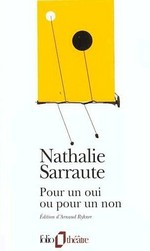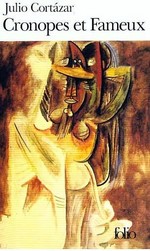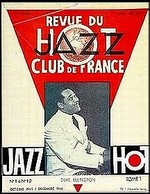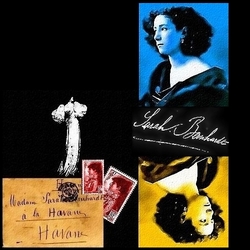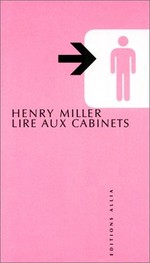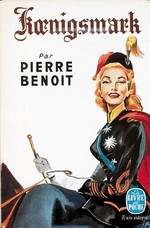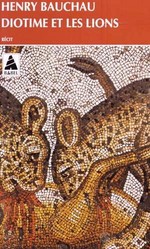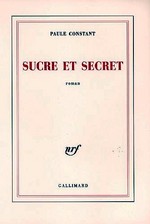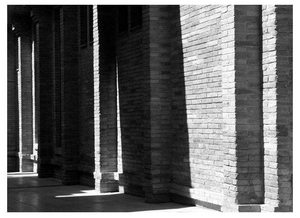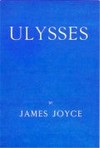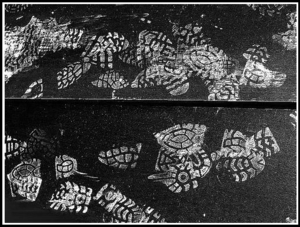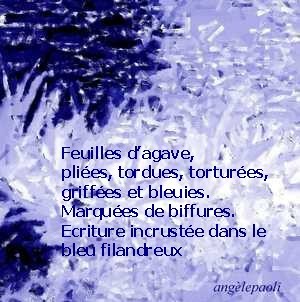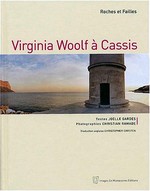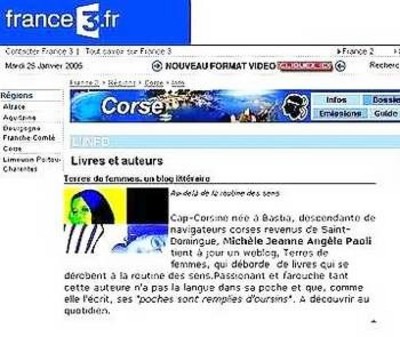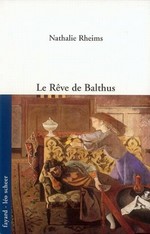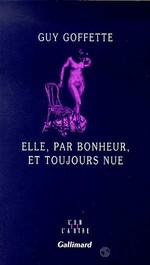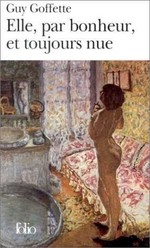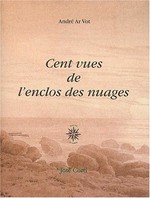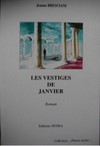28 mai 2005
Cette paix particulière...
« Ti descrivo quello speciale tipo di pace che si trova quando ancora dura la tempesta. Io stessa non l’avrei mai creduto, come forse anche tu non lo crederai. Eppure, una sera, raggiunsi il punto morto delle cose, il momento d’inerzia nel giro della ruota. Cosa aggiungere d’altro ? Un’asse si è spezzata nella mia costruzione, ma questa è una storia privata. Ora tu mi guardi, e vedi il moi sorriso più pulito, la mia mano poggia sulla tua, pacatamente. »
« Je te décris cette paix particulière qu’on trouve quand la tempête dure encore. Moi-même je ne l’aurais jamais cru, comme toi peut-être aussi tu ne le croiras pas. Pourtant, un soir, j’atteignis le point mort des choses, le moment d’inertie dans le mouvement de la roue. Qu’ajouter d’autre ? Une planche s’est brisée dans ma construction, mais c’est là une histoire privée. Maintenant tu me regardes, et tu vois mon sourire plus net, ma main appuie sur la tienne, paisiblement. »
Maria Venezia, Vocalità, Éditions Unes, 1986, pp. 30-31. Traduit de l’italien par l’auteur.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 28 mai 2005 à 14:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
27 mai 2005
C’était, je me rappelle…
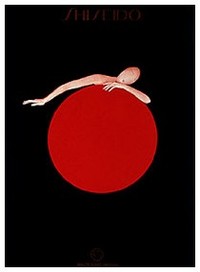
Carte de Serge Lutens
Source
« Je compte les mois par les fleurs qu’ils font éclore…ou par la durée d’un amour : c’était, je me rappelle, la saison des iris noirs du midi, tristes fleurs d’un printemps sans adolescence… ou bien la saison des orchidées bleues, des crocus, des pois de senteur et des gardénias arrivés de Londres… puis celle des pivoines, le jeune été semblant s’être déjà lassé de produire des fleurs subtiles ! et, après, les clématites, et les roses de plein air - comme nées d’un parfum de femmes qui passent - les violettes, les premières violettes de l’automne.
Comme il est lassant d’avoir des ennemis et pas d’adversaires !...
Est-ce vraiment à toi que je parle ? Je ne sais, mais quelqu’un que j’aime m’écoute. »
Natalie Clifford Barney, Éparpillements, Collection les Octaviennes, Édition Geneviève Pastre, 1999, p. 25.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 27 mai 2005 à 14:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
26 mai 2005
26 mai 1648/Mort de Vincent Voiture
Mort à Paris le 26 mai 1648, Vincent Voiture, le « bel esprit » est né à Amiens le 23 février 1598. Fils d’un riche marchand de vin en gros, ce dont il fut souvent raillé, Vincent Voiture possède un réel talent de mondain. Doué pour les intrigues amoureuses, il se met au service des jeunes galants de la Cour à qui il prête son entregent et sa verve.
Très apprécié à L’Hôtel de Rambouillet où il avait été présenté en 1626, il occupe également la charge de « gentilhomme ordinaire » de Monsieur, frère du roi (Gaston d’Orléans), en même temps qu’il accède aux fonctions honorifiques de Maître d’hôtel de Louis XIV. La fréquentation des grands l’entraîne dans de nombreux voyages à travers la France et l’Europe. Pourtant, cet homme de brio, écrivain et poète, ne se préoccupe nullement de faire publier ses œuvres qu’il tient pour un prolongement de la vie mondaine. Outre les ballades, stances et rondeaux, Voiture affectionne les lettres de style « galant » dans lesquelles il excelle. Lettres qui assurent à Voiture un immense succès dans l’art de la « Préciosité ».
Texte©angèlepaoli

Portrait de Vincent Voiture
Huile sur toile,
XVIIe siècle
64 cm x 52 cm
Musée national du château de Versailles
Source : Base Joconde.
Stances écrites de la main gauche
Sur un feuillet des mêmes tablettes, qui regardait un miroir mis devant l’ouverture
« Quand je me plaindrais nuit et jour
De la cruauté de mes peines,
Et quand du pur sang de mes veines
Je vous écrirais mon amour,
Si vous ne voyez à l’instant
Le bel objet qui l’a fait naître,
Vous ne le pourrez reconnaître,
Ni croire que je souffre tant.
En vos yeux, mieux qu’en mes écrits,
Vous verrez l’ardeur de mon âme,
Et les rayons de cette flamme
Dont pour vous je me trouve épris.
Vos beautés vous le feront voir
Bien mieux que je ne le puis dire ;
Et vous ne sauriez bien lire
Que dans la glace d’un miroir. »
Vincent Voiture, Poésies, éditions Henri Lafay, Société des Textes Français Modernes, 1971, in Anthologie de la poésie française du XVIIe siècle, Gallimard, Collection Poésie, page 252.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 26 mai 2005 à 15:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
Je me disais aussi…
Aquatinte numérique originale, G.AdC
« Je me disais aussi : vivre est autre chose
que cet oubli du temps qui passe et des ravages
de l’amour, et de l’usure – ce que nous faisons
du matin à la nuit : fendre la mer,
fendre le ciel, la terre, tour à tour oiseau,
poisson, taupe, enfin : jouant à brasser l’air,
l’eau, les fruits, la poussière ; agissant comme,
brûlant pour, marchant vers, récoltant
quoi ? le ver dans la pomme, le vent dans les blés
puisque tout retombe toujours, puisque tout
recommence et rien n’est jamais pareil
à ce qui fut, ni pire ni meilleur
qui ne cesse de répéter : vivre est autre chose. »
Guy Goffette, Un peu d’or dans la boue, La Vie promise [1991], Gallimard, Collection Poésie, 2000, page 181.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 26 mai 2005 à 14:30 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
21 mai 2005
21 mai 1973/Mort de Carlo Emilio Gadda

Carlo Emilio Gadda
Source
Lorsque Carlo Emilo Gadda (né à Milan en 1893) meurt à Rome le 21 mai 1973, il y a beau temps que l’ingénieur-écrivain a choisi de se retirer dans la solitude et de se tenir à l’écart des mondanités de la vie littéraire romaine. Pour lesquelles il n’éprouve que mépris et hostilité. En dépit de ce choix qui correspond à son désir, les ultimes années de la vie de Gadda sont assombries par des blessures mal cicatrisées qui tiennent en éveil angoisses et amertumes rageuses.
De formation scientifique, Carlo Emilio Gadda, ingénieur en électronique commence sa carrière d’écrivain en rédigeant des articles à caractère technique pour le journal milanais L’Ambrosiano. Mais sa situation financière souvent critique le tient dans un perpétuel désespoir. Pourtant Gadda s’est déjà imposé comme écrivain, notamment avec des romans comme La madonna dei filosofi (1931), Il castello di Udine (1934) ou encore L’Adalgisa (Disegni milanesi) (1944). Mais il lui faudra attendre la publication par Livio Garzanti de Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957) pour voir l’ensemble de son œuvre publié à nouveau et bénéficier d’une large audience. En 1963, la publication de son roman La cognizione del dolore (La Connaissance de la douleur) lui vaut le Prix International de Littérature.
Par leur structure labyrinthique mais aussi par les modalités d'écriture (d'une inventivité féconde et tourmentée), les romans de Carlo Emilio Gadda s’apparentent à l’œuvre de Joyce. Véritable laboratoire de langue, y sont présentes toutes les ressources du langage (dialectes, styles, genres, etc.), rendant compte d'une réalité fragmentée et polymorphe.
Texte©angèlepaoli
Rédigé le 21 mai 2005 à 20:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
11 mai 2005
Mina Loy/L'amour est des corps
« Il n’y a pas d’amour seul
l’amour est un alliage
l’amour n’est pas du corps
l’amour est des corps
L’amour est un chant
des corps qui reposent
dans le rythme musical
avec le duo cosmique
L’amour est du point du jour le diamant
non de pierre
mais de facettes brillantes
qui éveillent les extases »
Mina Loy, La Rose métisse , L’Atelier des Brisants, 2005, page 133.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 11 mai 2005 à 20:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
10 mai 2005
Andrée Chedid/L’Œil
« D’où nous vient cet Œil
Qui capte les géographies
Entrelace océans et pierres
Amasse ombres et soleils
Brasse creux et crêtes
Qui nous accorde cette prunelle
Qui embrasse terres et visages
Qui survole ou s’attarde
Qui est source du regard
Qui nous octroie cette vue
Qui trace amour ou dédain
Désir comme épouvante
D’où émerge cet Œil
Qui nous offre l’univers
Où converge l’autre regard
Qui se détourne du monde ? »
Andrée Chedid, « L’Œil », Rythmes, Gallimard, 2003, pp. 98-99.
Voir aussi (dans le même recueil) : La source des mots.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 10 mai 2005 à 15:44 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack
08 mai 2005
Erotic Sextin
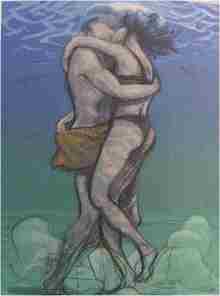
Dessin de Xavier Gorce
Ph. angèlepaoli
La Chapelle Sextine. Que voilà un ouvrage oulipien réjouissant !
Avec illustrations taillées dans le vif des décors, à même la chair des personnages ! Un petit livre d’images à ne pas laisser choir entre toutes les mains ! Oulipien, oui, car fondé sur la complexe combinatoire des couples. Qui se font se défont pour copuler. "Ainsi font, font, font..." Un ouvrage érotique alors ? Oui, terriblement ! Mais répétitif ? Ennuyeux ? Pas du tout. Réjouissant au contraire. Empli d’humour et de plaisir. Un exercice de style, à la fois léger et vertigineux. Sur l’art de la répétition et de la variation.
Treize femmes, treize hommes. Ils sont 26 en tout. Mais les multiples combinaisons aboutissent à 156 échanges. La plupart des partenaires reviennent six fois. Anna, Galata, Katia. Ou Dennis, Johann, Laurent. Chaque fois avec un partenaire différent. Certains, plus désavantagés, ne se livrent que quatre fois. Pauvre Ben, pauvre Irma ! Il faut bien qu’il y ait une inégalité quelque part dans cette machine à combiner les couples.
Ils font l’amour. Parfois avec brio. Parfois la tête ailleurs, en pensant à autre chose. Peu de sentiments, pas d’effusion. De l’improvisation, de la hâte, de l’inconfort. L’ascenseur, la baignoire, la voiture, le parking, la tente, la douche, le train... sans oublier la table de cuisine façon Jessica Lange dans Le facteur sonne toujours deux fois. Et des décalages qui émaillent le texte et font sourire. Et rire, même. Car La Chapelle Sextine est un livre drôle.
Les textes sont brefs, très condensés. Six lignes, dix lignes. Rarement au-delà. Le temps que durent la rencontre, les échanges, le partenariat. Les orgasmes. La roue tourne. Ça valse. Premiers en piste, Anna et Ben. Derniers à fermer le bal, Philippe et Anna. On remarque déjà l’alternance horizontale rigoureuse : une fille, un garçon. Un garçon, une fille. Alternance que chaque texte respecte d’un bout à l’autre du livret. Le chiasme est bouclé.
Comment ça fonctionne ? Toujours en duetto. Mais la valse se fait en trois temps. 25/25/27. Le premier changement s’effectue avec Yolande et Zach/ Zach et Anna. Le second avec Mina et Terence/ Terence et Anna. Anna qui occupe les points stratégiques du livre : début, milieu et fin.
À la fin de chaque sextine érotique, un aparté en italiques. En décalage avec le texte principal. Comme dans la sextine des troubadours, il faut faire vibrer la dernière corde. En la mettant en contact avec ce qui précède. Il faut aussi lire le livre d’un seul tenant, sans s’arrêter pour ne pas perdre le tempo. Et faire résonner le jeu des variantes et des répétitions.
Un ouvrage jubilatoire que cette Chapelle Sextine. Avec schémas cabalistiques à la Michel-Ange pour clore le tout. Qui ne tient qu’en quatre-vingt six pages ! Un record !
Hervé Le Tellier, La Chapelle Sextine, Estuaire. Collection Carnets littéraires, 2005. Dessins de Xavier Gorce.
Texte©angèlepaoli
Voir aussi :
- la bio-bibliographie d'Hervé Le Tellier sur fatrazie.com
- le site officiel de l'OuLiPo
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 08 mai 2005 à 09:40 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack
22 avril 2005
Guy Goffette/Jalousie
« Il lui arrive de plus en plus souvent la nuit
de descendre dans la cuisine
où fument en silence sous la lune
les statues que le jour relègue parmi les meubles
les habits, sous l’amas des choses
rapportées du dehors et vouées à l’oubli.
Il n’allume pas mais s’assied dans sa lumière
comme un habitué au milieu des filles
et leur parle d’une voix triste et douce
de sa femme qui se donne là-haut, dans sa propre
chambre
à de grands cavaliers invisibles et muets
- Et c’est moi qui garde leurs chevaux, dit-il
en montrant l’épais crin d’or enroulé
à son annulaire. »
Guy Goffette, « Jalousie », Les Portes de la mer, in Éloge pour une cuisine de province, Champ Vallon, 1988 ; Gallimard, Collection « Poésie », 2000, page 87.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 22 avril 2005 à 13:57 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
19 avril 2005
Marina Tsvétaiëva/Amazones
« Seins de femmes ! Souffle figé de l’âme
Essence de femmes ! Vague toujours prise
Au dépourvu et qui toujours prend
Au dépourvu - Dieu voit tout !
Lice pour les jeux du délice ou de la joie,
Méprisables et méprisants - Seins de femmes ! -
Armures qui cèdent ! - Je pense à elles…
L’unique sein, - à nos amies !… »
5 décembre 1921
Marina Tsvétaiëva, « Amazones », L’Offense lyrique et autres poèmes,
Éditions Farrago/Éditions Léo Scheer, 2004, page 196.
Voir aussi Tsvétaïeva/Pasternak/Rilke : J’ai soif de toutes les routes
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 19 avril 2005 à 02:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
15 avril 2005
Silvia Baron Supervielle/Le marcheur séparé
« L’endroit de la mémoire est loin. Certains ne connaissent pas cet endroit et, même s’ils le connaissaient, ils ne sauraient pas s’y rendre. Le chemin qui y mène n’est pas signalé dans les livres. Peut-être même ignorent-ils que la mémoire existe. Venir au monde, pour eux, est un mouvement de disparaître. Ils vont revêtus d’une forme sans forme, d’un regard sans yeux. Ils n’ont pas de repère dans l’immensité où ils sont venus. Ils ne savent pas ce que vivre veut dire. Entre eux et la lumière, une maison, la distance est si longue qu’ils ne peuvent pas la franchir. Entre eux et la parole, la solitude s’interpose. Entre eux et eux-mêmes, l’écart est insurmontable. Entre eux et le jour, il y a la nuit. Ils se tendent vers la nuit. Les jours ne témoignent que de la progression en direction de l’incendie du soir.
Plus que manger ou dormir, le marcheur marche pour échapper à une seconde disparition. Il s’évade : la nuit est dégagement. Il ne s’arrête pas une seule fois, sous aucun prétexte, une pause pouvant le faire reculer et se volatiliser. Il a un objectif : atteindre cette obscurité rayonnante, où le repos n’est plus un danger. Il est étonné d’avoir un nom. Entre lui et ce nom: un bizarre espace vide. Si quelqu’un l’appelle, il l’entend résonner. D’un coup le timbre de sa voix l’habille.
Lorsque nul ne le voit, en cachette, il se remet à le lire et à l’écrire comme s’il était celui de quelqu’un d’autre. Tous les noms sont des noms d’emprunt et viennent d’ailleurs, de n’importe quel voyageur qui se hâte en direction de la nuit. Ni sa forme, ni son ombre, ni son nom ne seront jamais lui: le marcheur séparé ne connaît que la lancée régulière de ses jambes. »
Silvia Baron Supervielle, Le Pays de l’écriture, Cahier IV,
Éditions du Seuil, 2002, pp. 175-176.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 15 avril 2005 à 17:42 | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack
14 avril 2005
Claude Louis-Combet/Noyau Central
« Lorsque les mots parviennent à leur sommet
Ils ont déjà brûlé
Le texte s’écrit
Dans les ponces et les basaltes
Je ne sais rien de ce que je suis
Je ne connais que les scories
Où va le doigt sur le chemin des signes
Obstiné à la phrase
Puisatier du verbe
Je n’ai de lien qu’avec l’opaque
Consumée- c’est toi qui portes le feu »
Claude Louis-Combet, Le Petit Œuvre poétique, José Corti, 1998, p. 75.
Voir aussi :
- Celle par qui la ténèbre arrive.
- Hiérophanie du sexe de la femme.
- Isula, insula.
- Mala Lucina.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 14 avril 2005 à 12:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
08 avril 2005
La galerie de Guidu
Blogueurs, blogueuses et passant(e)s, vous êtes tou(te)s invité(e)s à une libre rêverie-promenade dans les couloirs et labyrinthes de la galerie du photographe et architecte Guidu Antonietti di Cinarca. Guidu et moi-même vous y accueillerons avec le plus grand plaisir.
L'exposition « Visages de femmes (Littérature/musique) », ouverte 24 heures sur 24, en est à son soixante-et-unième portrait. Comme vous le savez, une des particularités de cette exposition est d'évoluer au fil des heures sans qu'une date de fermeture soit envisagée.
• Lou Andreas-Salomé
• Antonella Anedda
• Joséphine Baker
• Barbara
• Simone de Beauvoir
• Sarah Bernhardt
• Juliette Binoche
• Claudine Bohi
• Jeanne Bresciani
• Barbara Carlotti
• Catherine de Médicis
• Andrée Chedid
• Christine de Pisan
• Hélène Cixous
• Natalie Clifford Barney
• Camille Claudel
• Colette
• Paule Constant
• Alexandra David-Néel
• Isadora Duncan
• Marguerite Duras
• Rinalda (Renée) Falconetti
• Marie Ferranti
• Kathleen Ferrier
• Anne F. Garréta
• Sylvie Germain
• Juliette Gréco
• Françoise Hardy
• Vénus Khoury-Ghata
• Julia Kristeva
• Louise Labé
• Marie Laurencin
• Linda Lê
• Vivien Leigh
• Tamara de Lempicka
• Mina Loy
• Anna Magnani
• Silvana Mangano
• Katherine Mansfield
• Dacia Maraini
• Marguerite de Navarre
• Marguerite de Valois
• Anaïs Nin
• Vera Pavlova
• Florence Pazzottu
• Edith Piaf
• Sylvia Plath
• Catherine Pozzi
• Nathalie Rheims
• Jacqueline Risset
• Françoise Sagan
• Amina Saïd
• Sappho
• Nathalie Sarraute
• Marie-Ange Sebasti
• Marquise de Sévigné
• Delphine Seyrig
• Susan Sontag
• Gaspara Stampa
• Brina Svit
• Anna Toscano
• Marina Tsvétaïeva
• Zoé Valdés
• Renée Vivien
• Virginia Woolf
• Marguerite Yourcenar
Bonne visite
Angèle et Guidu
Voir aussi la galerie « Portraits de femmes » de Guidu.
Rédigé le 08 avril 2005 à 13:34 | Lien permanent | Commentaires (9) | TrackBack
31 mars 2005
Bernard Noël/L’Encre et l’Eau
« La lumière fait pousser des formes
un corps dans le papier
et pourtant rien
cette énigme va et vient
au bout des yeux
le temps n’est pas égal partout
ni sur toutes les peaux
celles que lave l’encre
retiennent une vie sans vie
l’attente close sur elle-même
une illusion lestée de réalité
ainsi sont faites les images
leur avenir est en nous
leur passé porte pourtant
le présent de leur apparition
le sens et l’instant mêlés
puis emballés dans une peau
voilà le secret des visages
l’âme y vient plus tard
comme une sueur de la mémoire
chaque nom est la prothèse
d’un espoir contre la déception
quelqu’un est là sans être là
il faut s’émouvoir du mystère
l’ombre s’y fait blanche
d’ailleurs les gestes les postures
plombent la ligne du temps
leur perpétuelle répétition
dédouble le passé au présent
l’un sur l’autre devenus transparents »
Bernard Noël, Les Yeux dans la couleur, P.O.L, 2004, page 143.
Sur le site du CipM (Centre international de poésie de Marseille), on peut entendre Bernard Noël disant à haute voix un extrait de La Maladie de la chair : cette lecture a été effectuée le 18 novembre 1995. La Maladie de la chair, lue ici, est la version primitive de La Maladie de la chair, texte publié dans la collection Petite Bibliothèque des éditions Ombres en 1995. Cf. Note de lecture dans la revue Prétexte [format RealPlayer]
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 31 mars 2005 à 10:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
25 mars 2005
Margherita Guidacci/Guado
Guado
« L'anno contiene quest'unico guado verso di te.
Ogni volta lo trovo un poco più sommerso,
l'onda più gonfia, la corrente più minacciosa.
Eppure io t'ho raggiunto ancora,
ed ogni breve istante che trascorro accanto a te
diviene un " sempre "
e se ne nutrirà anche il tempo deserto.
Se una dura legge c'imporrà un " mai ",
noi condannati ed immobili sulle opposte rive
intrecceremo tuttavia i richiami
di un desiderio tramutato in splendore.
Così la Tessitrice ed il Pastore si rispondono:
Vega ed Altair tra cui si snoda
l'alto stellato fiume. »
Margherita Guidacci, Anelli del tempo, Edizioni Città di Vita, 1993.
Gué
« L’an ne contient qu’un seul gué
qui me conduit vers toi. À chaque fois
je le retrouve submergé davantage, les eaux
plus gonflées, le courant
plus menaçant. Et pourtant
pourtant je t’ai rejoint encore, et le moindre instant
passé à tes côtés
devient un « pour toujours ». Le temps désert
en fera son aliment. Et si une dure loi
nous imposait un « jamais », à nous condamnés
immobiles sur des rives opposées,
nous croiserons toutefois
les échos d’un désir transmué en splendeur.
Ainsi la Tisseuse et le Pâtre
se répondent : Vega et Altair
entre eux se dénoue haut perché
le fleuve des étoiles. »
Margherita Guidacci, Les Anneaux du temps, Città di Vita, 1993, traduit et présenté par Martin Rueff, Po&sie, numéro 109, p. 138. Trente ans de poésie italienne, I, Belin, 2004, pp. 138-139.
BIO-BIBLIOGRAPHIE
Née à Scarperia (près de Florence) le 25 avril 1921, Margherita Guidacci est une enfant solitaire, qui grandit parmi les livres. Imprégnée dès son plus jeune âge des classiques grecs et latins, elle construit sa vie de femme loin des mondanités. Et conduit une triple carrière d’universitaire, de traductrice et de poète. Son écriture rigoureuse et sensible est empreinte de mysticisme et d’intériorité. Ses travaux de traductrice la conduisent vers la littérature anglo-saxonne, notamment vers T.S. Eliot pour la prose et Emily Dickinson pour la poésie.
Frappée d’hémiplégie en 1990, elle compose son dernier recueil Anelli del tempo dans la plus grande solitude et meurt à Rome le 19 juin 1992.
Bibliographie en français :
- Neurosuite, Arfuyen, 1977, réédité en 1989, traduction de Gérard Pfister.
- Le Vide et les formes, Arfuyen, 1979, traduction de Gérard Pfister.
- Le Sable et l’ange, Obsidiane, 1986, traduction de Bernard Simeone.
- Le Retable d’Issenheim, Arfuyen, 1987, traduction de Gérard Pfister.
- lles, Arfuyen, 1992, traduction de Gérard Pfister.
- L’Horloge de Bologne, Arfuyen, 2000, traduction de Gérard Pfister.
Voir aussi sur Zazieweb un autre poème (choisi par Escarbille Bis) de Margherita Guidacci, issu du recueil Neurosuite : "I saggi hanno sempre ragione".
Retour à l'index de la catégorie Péninsule (littérature italienne et anthologie poétique)
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 25 mars 2005 à 13:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
24 mars 2005
Linda Lê/La boîte de Pandore
Caliban, Caliban, qui es-tu ? Sors de ta boîte de Pandore ! S’il te plaît, montre-moi ton visage !
Sa mémoire lui fait défaut et elle ignore tout, à l’instant où elle ouvre son livre, du complexe dont elle souffre, elle, ô Caliban ! Mais Linda Lê, l’auteure d’un ouvrage tout récemment publié, Le Complexe de Caliban, ne va pas tarder à lui rafraîchir la mémoire. Pour le moment, elle prolonge délicieusement l’attente. Elle lit, dans l’ordre, sur la première de couverture, pareille à l’écolière Linda Lê de jadis : Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques; Gustave Flaubert, Madame Bovary, tomes 1 et 2 ; La Chartreuse de Parme, tomes 1 et 2; Stendhal, Le Rouge et le Noir. Il ne lui reste plus qu’à caresser avec délicatesse les tranches dorées à l’ancienne, et à entrouvrir du bout des doigts la boîte de Pandore pour qu’elle lui livre son secret.
Il lui faut atte(i)ndre le mitan du livre pour en savoir davantage sur ce titre, qui garde longtemps sa part de mystère. Caliban lui échappe et avec lui tous ceux de sa suite. Pourtant les chapitres qui précèdent celui, central, que l’auteure a intitulé « Le complexe de Caliban » mettent la lectrice qu’elle est sur la voie. Elle refait avec la « grenouille » vietnamienne le parcours livresque de son enfance. La voie des livres s’ouvre. Et la voilà replongée des années en arrière dans le ventre secret de l’éléphant de la Bastille avec Gavroche, son squatter révolutionnaire et son argot aujourd’hui disparu. « Morfilez, les momignards !» Livres interdits par le régime, confisqués, lus en cachette. Dévorés, appris par cœur. Livres-culte, culte des livres. Livres fondateurs puisés dans les « classiques » de la langue française. Elle aussi adulée, vénérée, chérie parce que porteuse de promesses. Livres qui ouvrent à l’adolescente, puis à la jeune adulte, le chemin de l’écriture. Seul moyen pour l’étrangère, ni tout à fait elle-même, ni tout à fait une autre, de survivre. Classée dès son entrée sur le territoire des « Lumières » au rang des immigrés. Marquée du sceau de l’inavouable duplicité. Contrainte d’apprendre à vivre avec la fêlure indélébile de ceux qui ne sont pas d’ici et qui ne savent plus d’où ils sont. Marquée au fer rouge de l’entre-deux-langues, la langue des origines, niée elle aussi, et la langue du savoir, la langue de la culture acquise. Aimée et haïe à la fois, parce que tyrannique.
Et Linda Lê, « écrivain exilé qui choisit d’écrire » en français, sa langue de culture, est pareille au Caliban de La Tempête. Sauvage créature shakespearienne, récalcitrante, infernale. En lutte contre son maître, le roi Prospero. Tout s’éclaire alors. Le complexe dont Linda Lê souffre, c’est celui de sa « dévotion à la langue », une « dévotion mêlée d’hérésie ». Au-delà de ce chapitre déterminant, Linda Lê bascule dans une réflexion sur l’écriture, une écriture nourrie de ses lectures d’adulte et de sa culture. Immense ! Une écriture incisive, « lacérante » qui infiltre l’écriture des auteurs dont elle décortique style et idées. Ses analyses ont une force, une profondeur, une acuité que bien des critiques pourraient lui envier. Le Complexe de Caliban est une invitation à revisiter les grands mythes, Orphée et Antigone bien sûr (mais pas seulement !) et à découvrir/redécouvrir les textes fondateurs de sa pensée. Ceux de Shakespeare, Pessoa, Amiel, Hölderlin, Tolstoï, Stevenson, Musil, Artaud, Steiner, Blanchot, Leiris, Kafka. Pour ne citer que ceux-là. Mais l’essai de Linda Lê ouvre de multiples portes qui donnent elles-mêmes sur nombre d’autres portes. Qu’il faut pousser toujours plus avant pour pénétrer dans l’univers sombre et déchiré de cet écrivain hors pair. Éblouissant vertige que ce voyage labyrinthique en littérature. Périple « minotauréen » dont seul Caliban détient le fil d’Ariane.
Linda Lê, Le Complexe de Caliban, Christian Bourgois Éditeur, 2005.
Lire aussi un extrait du Complexe de Caliban.
Texte©angèlepaoli
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 24 mars 2005 à 11:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
22 mars 2005
Silvia Bré/L’argomento
L’argomento
« […] Un’aquila si tiene nei miei occhi
che se guarda la gente
io vedo i loro corpi cosi soli
a scaldare le soglie della vita
e come stanno buoni nella pena,
quanta paura trema in ciò che vive
e tutte quelle voci di animali che sanno
di morire
sembrano belle ancora nella mente
come comete dalla lunga scia
e se ne sente una anche più debole
venire avanti e diventare mia.
Mai fissare l’aquila allo specchio -
vede solo lontano, abissalmente,
ogni suo sguardo ti scaglia da se stesso
nel paesaggio, al posto tuo :
i deserti dei quali si fa parte
da cui si torna solo col pensiero.
Aquila mia, remota mia figura
con tutto il mondo che le gira intorno
e con il vuoto che vaga intorno al mondo,
centro di me che dentro non resiste,
che nascondo nei nomi che conosco
eccomi ancora qui, la testa china
come una che non riesce e si vergogna -
sento d’essere tua, senza capire
lascio che qualche mia parola ti accontenti,
che tutto questo accada un’altra volta. […]
L’argument
« 1. Il y a un aigle dans mes yeux
et lorsqu’il regarde les hommes
je vois leurs corps si seuls
ranimant les seuils de la vie
et comme dans la peine ils sont radieux,
tant de peur tremble dans ce qui vit.
Et toutes ces voix des animaux qui savent mourir
semblent belles encore dans ma tête
comme des comètes au long sillage
et même lorsqu’on en entend une plus fluette
qui s’avance et devient mienne.
2. Ne jamais mettre l’aigle au miroir -
sa vue est lointaine, abyssale,
chacun de ses regards te jette hors de toi
dans le paysage, à ta place assignée :
ces déserts dont nous sommes une part
et dont on ne revient qu’avec la pensée.
3. Mon aigle, ma figure cachée
avec le monde entier qui tourne autour de lui
et avec tout le vide qui erre autour du monde,
mon centre qui en moi ne résiste pas
et que je cache dans les noms que je sais
c’est encore moi qui, la tête penchée
comme celle qui n’y arrive pas et en a honte -
sens bien que je t’appartiens sans comprendre
et je fais tout pour que mes mots te plaisent, quelques-uns
et que tout cela se produise encore une fois […] »
Silvia Bré, « L’argomento » (texte inédit), Po&sie, numéro 110, Trente ans de poésie italienne, 1975-2004, vol. 2, Belin, pp. 351-352. Traduction de Tiphaine Samoyault.
« Silvia Bré, née à Bergame en 1953, vit aujourd’hui à Rome. Traductrice de textes scientifiques et littéraires, elle est l’auteur d’une traduction de Louise Labé chez Mondadori. Elle a publié deux recueils, à dix ans d’intervalle. I riposi (Rotundo, 1990) et Le Barricate misteriose (Einaudi, 2001) qui a reçu le prix Montale. Elle fait paraître en revue depuis le début des années 1980, dans Braci, Prato pagano, Nuovi Argomenti, Poesia. » (notice de Tiphaine Samoyault).
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 22 mars 2005 à 11:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
21 mars 2005
Cécile Oumhani/Ne craignons pas la nuit
« Ne craignons pas la nuit
Quand elle se repaît de nos corps
Et cerne l’ovale des visages
Poussons notre barque vers l’abîme silencieux
Où le pré suspend son souffle
Sous la ramure des chênes
Défaisons nos amarres
Lisons aux contours de la pénombre
La vaste histoire dont nous ne connaissons
Que le discret ressac à notre berge
Resterons-nous aveugles en la demeure
Où cordes dociles nous vibrons
Des accents de l’énigme primordiale ? »
Cécile Oumhani, Chant d’herbe vive, Voix d’encre, 2003. Dessins de Liliane-Ève Brendel.
BIO-BIBLIOGRAPHIE
Née en 1952, Cécile Oumhani est agrégée d'anglais et a consacré sa thèse de doctorat d'études britanniques à l’écrivain Lawrence Durrell. Elle est actuellement maître de conférences à l'Université de Paris-XII. Ci-après une bibliographie sélective :
- À l’abside des hêtres, Centre Froissart, 1995
- Fibules sur fond de pourpre (nouvelles), Le Bruit des Autres, 1995
- Loin de l’envol de la palombe (poèmes), La Bartavelle, 1996
- Vers Lisbonne, promenade déclive (poèmes), Encres Vives, 1997
- Des sentiers pour l’absence (poèmes), Le Bruit des Autres, 1998
- Une odeur de henné (roman), Paris-Méditerranée, 1999
- Les Racines du mandarinier, Paris-Méditerranée, 2001
- Un jardin à La Marsa (roman), Paris-Méditerranée, 2003
- Un livre d'artiste (poèmes), Philonar. Dessins de Liliane-Eve Brendel.
Pour en savoir plus sur Cécile Oumhani, voir sur le site Babelmed: "Cécile Oumhani, à la croisée des mots et des imaginaires."
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 21 mars 2005 à 09:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
20 mars 2005
Linda Lê/« Les jours fatidiques dans la littérature mondiale »
Mars 2005 : publication chez Christian Bourgois du Complexe de Caliban de Linda Lê.
« Je me souviens d’un calendrier que j’avais établi suivant les jours fatidiques dans la littérature mondiale. Il y avait le « Lundi existentiel » de Benjamin Fondane, le Mardi de Melville - un poème composé d’îles -, le Mercredi des cendres de Schopenhauer, le nommé Jeudi de Chesterton, le miracle du Vendredi de Defoe, le Samedi où Borges croisa le « troisième homme », destinataire secret de La Rose profonde, et le Dimanche de la démence d’Elsa Morante. Ainsi, le lundi était le jour de la France, celui d’un philosophe juif qui fut livré par sa concierge à la Gestapo, et qui mourut gazé à Birkenau. »
Linda Lê, Le Complexe de Caliban, Christian Bourgois Éditeur, mars 2005, p. 96.
VOIR aussiLa boîte de Pandore
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 20 mars 2005 à 12:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
17 mars 2005
Amina Saïd/l’élan le souffle le silence
Cinquantième portrait de la Galerie-Exposition « Visages de femmes » : Amina Saïd
«l'élan le souffle le silence
le rêve de l'âme l'instant d'éternité
l'ombre transfigurée de ma mort
ce qui en moi vainement te cherche
tout commence et meurt avec les racines
calcinées du soleil sur le monde
car de toi me vient une part de lumière
mirage d'île sur l'écume de la mer
ainsi je ne dis pas, je chante
je brise la lumière pour que de toi elle se multiplie
je peins mes paupières aux couleurs de la terre
mes yeux se ferment sur une idée de la beauté
que tu portes comme une pudeur intime
je sème les pierres blanches de ma mort
je vole une minute de vie
à la courbe légère du temps
car de toi me vient une part de lumière
mirage d'île sur l'écume de la mer
je suis au monde comme un fruit
triste et heureux de la bouche qui l'embrasse
la voix de l'aube se mêle à la tienne
ainsi je ne dis pas, je chante
ce qui en moi vainement te cherche
depuis le jour où mes ombres
s'éparpillèrent autour de moi
crépuscule ébloui de la face d'un dieu barbare
le jour où une théorie d'oiseaux innocents
survola le mirage de mon île
rêve pur incisé dans la chair du temps
ainsi libre captive je m'achève et renais
avec la nuit ses miracles lumineux
*
apparu disparu avec l'impétuosité du printemps
comme un corps nu dans la lumière éteinte
une étoile lyrique dans la nuit ensorcelée
tu me gratifias d'une esquisse de sourire
depuis je célèbre le tumulte intérieur
ma folie de femme lentement détruite
puis reconstruite le profil d'un sourire
qui s'étend sur le silence de mon poème
femme de peu de mots qui écrit
qui écrit comme si elle savait comment
mon histoire a la tristesse à fleur de corps
l'aérienne innocence des ténèbres »
Amina Saïd, La Douleur des seuils, Clepsydre/Éditions de la Différence, Paris, 2002, pp. 36-37.
Pour écouter la voix d’Amina Saïd lisant elle-même à voix haute le poème ci-dessus, cliquer ICI. [Source : site berlinois lyrikline. Production du son : M. Mechner, LiteraturWERKstatt, Berlin, 2002.]
BIO-BIBLIOGRAPHIE
Née à Tunis en 1953 d’une mère dauphinoise et d’un père tunisien , Amina Saïd vit à Paris où elle est enseignante. D’expression francophone, Amina Saïd est une des plus grandes voix de la poésie maghrébine. Elle est notamment l’auteur de deux livres de contes tunisiens (Le Secret, Critérion, Paris, 1994, et Demi-coq et compagnie, L'Harmattan, Paris, 1997) et de dix recueils de poésie :
- Paysages, nuit friable, Barbare, Vitry-sur-Seine, 1980.
- Métamorphose de l'île et de la vague, Arcantère, Paris, 1985.
- Sables funambules, coédition Arcantière/Écrits des Forges, Paris-Trois-Rivières (Québec), 1988.
- Feu d'oiseaux, Revue Sud, n° 84, Marseille, 1989. Prix Jean Malrieu.
- Nul autre lieu, Écrits des Forges, Trois-Rivières (Québec), 1992.
- L'une et l'autre nuit, Le Dé Bleu, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 1993, Prix Charles-Vildrac (Société des gens de lettres) en 1994.
- Marcher sur la terre, La Différence, Paris, 1994.
- Gisements de lumière, La Différence, 1998.
- De décembre à la mer, La Différence, 2001
- La Douleur des seuils, Paris, La Différence, 2002.
- L'horizon est toujours étranger, CD, Paris, Artalect, 2003.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 17 mars 2005 à 17:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
Brina Svit/Rue des Illusions perdues
Si j’avais été critique littéraire, Brina, et que j’avais écrit pour un webzine littéraire qui pourrait s'appeler Terres de femmes, j’aurais aimé moi aussi dire que tout avait commencé presque, presque… comme dans la Conscience de Zeno. La fumée dans les yeux. Sans éléphant qui me regarde. Non, simplement la fumée de la première cigarette. L’indispensable cigarette, seule capable de redonner goût à la vie. Celle de cet instant qui précède tout juste le petit matin et où les oiseaux se taisent brusquement. Svit en slovène. Instant d'aurore brouillé d’un zeste persistant d’insomnie « au sortir d’une nuit blanche », « d’una notte bianca », d’une nuit de tango ou d'une nuit de grappa.
J’aurais aussi aimé dire que cela commençait comme dans un scénario, celui qu’aurait voulu écrire l’écrivain – Tibor – qui se met lui-même en scène. Un écrivain qui rêvait d’écrire le scénario d’un film. D’une histoire d’amour. Mais qui ne sait trop comment s’y prendre, parce que « le cinéma contemporain se veut positif, porteur de bonheur » et « veut avant tout croire en l’amour » (page 10).
Pure prétérition, puisque, tout en pensant cela et comme j’y pense à l’instant, Tibor fixe, en gros plan, les mains de son interlocutrice. Un gros plan qui va jusqu’à l’insert des ongles « ronds, gentiment coupés, comme si l’enfance n’en avait pas définitivement pris congé » (page 8). C’est que la caméra-stylo de l’auteur-réalisateur du film qui ne sera pas - mais sera peut-être un roman -, s’attarde longuement, en un « présent éternel », sur ces étranges animalcules qui vivent à leur guise leur vie. Indépendantes, ces mains, volontaires, joueuses. Habiles. Instruments décisifs de la séduction, elles s’animent sur la table, s’appliquent à faire voguer dans un verre de « bourgogne blanc » une note de restaurant pliée en forme de voilier miniature. Mais voilà, je ne suis ni Antonioni, ni Svit, ni Svevo. Pas davantage Tibor. Je ne suis même pas sûre de savoir d’où je parle !
Terrifiant de comprendre que cette cristallisation amoureuse dont dépend l’avenir d’un couple se joue, non sur les yeux, ces faux miroirs de l’âme, mais sur les mains. C’est avec elles que tout se noue. Comme dans une partie de trente et quarante qui s’éternise dans un tripot balzacien du Palais-Royal. Où le trésor, fiévreusement amassé par des doigts avides et experts, se dilue et fond. S’étrécit tout à coup comme peau de chagrin, laissant les doigts racornis se perdre en agitations vaines.
Et pourtant, la vie méticuleuse du Tibor de la rue Balzac, manipulé dès le prégénérique par le lion Farkas, éditeur de profession, cette vie méticuleuse, loin de se rétrécir, va s’enfler comme une montgolfière prête à crever, à « éclater comme la chaudière d’une machine à vapeur » (Balzac, Z. Marcas, journaliste de la rue Corneille). Elle va tourbillonner en un cyclone ravageur. L’appartement de la rue du « Lys-dans-la-Vallée » en devient zone franche, tantôt investie, tantôt désertée par cette fausse passante du sans-souci qu’est Kati.
Pas de répit dans ce roman d’amour conduit à rênes tendues. Si le lecteur, hors d’haleine, est emporté dans la brèche qui s’ouvre à ses pieds, Tibor ne s’engouffre pas moins, pris dans les rets de Kati …et de l’écrivain qui mène le bal avec une diabolique maestria et perverses circonvolutions. Un travelling tournant devenu fou. Désormais, il faudra que Tibor fasse sienne cette blessure. L’apprivoise. La supporte. La vive autant que faire se peut. Comme une imprécation muette ! Définitivement maté et bâté dans son appartement de la « rue des Illusions perdues ».
Brina Svit, Con brio, Gallimard, Collection blanche, 1999.
Texte@angèlepaoli
Voir aussi :
- Belle de mars
- Brina Svit/Turris eburnea
BIO-BIBLIOGRAPHIE
Brina Svigelj Mérat, dite Brina Svit, est née à Ljubljana en 1954.
Brina Svit a fait des études supérieures à l'université de Ljubljana (littérature comparée et français) et s'est installée à Paris en 1980 où elle a poursuivi des études d'audiovisuel au Centre national pour l’action artistique et culturelle (CENAC, Paris, 1985-1987). April, son premier roman, a été publié en 1984, son deuxième roman (un roman épistolaire dans la tradition de Laclos, cosigné par son ami Peter Kolšek), Navadna razmerja (Liaisons ordinaires), étant paru en 1998. Romans encore inédits en français.
Le premier roman publié en France est Con brio (Gallimard, 1998) et le second Mort d'une prima donna slovène (Gallimard, 2001) [Smrt slovenske primadone, 2000]. Le premier essai d’écriture en langue française de Brina Svit remonte à 2001, date à laquelle elle a publié dans le supplément spécial du Monde (juillet 2001) un court récit de 25 pages intitulé « L'été où Marine avait un corps ». En 2003, elle publie chez Gallimard Moreno, écrit en avril-mai 2002 dans la résidence d'écrivains de la « Baronessa » Beatrice Monti della Corte Rezzori, veuve de l’écrivain Gregor von Rezzori. Brina Svit met actuellement la dernière main à son deuxième roman écrit directement en français. Celui-ci paraîtra dans le courant de l’année 2005. Parallèlement à son activité d'écrivain, Brina Svit est la correspondante régulière du quotidien slovène Delo.
Si Brina en italien (et en corse) veut dire « givre », Svit désigne en slovène « cet instant d'avant l'aube où les oiseaux s'arrêtent de chanter », pseudonyme qui est apparu pour la première fois dans le générique du premier court métrage de Brina Svit, Nikola (1989, avec Brigitte Fontaine. Prix du public au Festival de Dunkerque), film qui a été suivi d’un autre court métrage, Le Balcon (1990, avec Anémone. Prix du jury au Festival de Grenoble), et De Jeanne à Zerline (documentaire sur Jeanne Moreau). Brina Svit a aussi écrit deux pièces radiophoniques (en français) : Entré dans ma vie par la fenêtre et L’Institutrice au fond d’un puits.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 17 mars 2005 à 12:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
15 mars 2005
15 mars 1954/Sortie en librairie de
Bonjour tristesse
Avec ce premier roman, Bonjour tristesse (sorti en librairie le 15 mars 1955), Françoise Sagan, jeune fille de bonne famille tout juste âgée de 19 ans, fait une entrée très remarquée sur la scène littéraire.
Fraîchement accueilli par la critique qui lui trouve un parfum de scandale, Bonjour tristesse devient le livre fétiche de toute la génération d’après-guerre, en quête de libération. Quant à François Mauriac, le « gourou » de la critique littéraire de l’époque, il consacre le jeune talent dans une formule restée célèbre: Françoise Sagan, un « charmant petit monstre ».
« La netteté de mes souvenirs à partir de ce moment m’étonne. J’acquérais une conscience plus attentive des autres, de moi-même. La spontanéité, un égoïsme facile avaient toujours été pour moi un luxe naturel. J’avais toujours vécu. Or, voici que ces quelques jours m’avaient assez troublée pour que je sois amenée à réfléchir, à me regarder vivre. Je passais par toutes les affres de l’introspection sans, pour cela, me réconcilier avec moi-même. « Ce sentiment pensais-je, ce sentiment à l’égard d’Anne est bête et pauvre, comme ce désir de la séparer de mon père est féroce .» Mais, après tout, pourquoi me juger ainsi ? Étant simplement moi, n’étais-je pas libre d’éprouver ce qui arrivait ? Pour la première fois de ma vie, ce « moi » semblait se partager et la découverte d’une telle dualité m’étonnait prodigieusement. »
Françoise Sagan, Bonjour tristesse, deuxième partie, chapitre premier,
Pocket, 1991, page 71.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 15 mars 2005 à 00:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
14 mars 2005
14 mars 1950/Édith Piaf fait sa rentrée salle Pleyel
Ce 14 mars 1950, Édith Piaf, « le moineau de Paris », fait sa rentrée musicale salle Pleyel, à Paris, pour trois récitals.
Elle chante « L’hymne à l’amour » composé en hommage à Marcel Cerdan (mort le 27 octobre 1949 dans un accident d’avion). Les paroles de cette chanson d’Édith Piaf ont été mises en musique par Marguerite Monnot.
« Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer
Et la terre peut bien s'écrouler
Peu m'importe si tu m'aimes
Je me fous du monde entier
Tant qu'l'amour inond'ra mes matins
Tant que mon corps frémira sous tes mains
Peu m'importe les problèmes
Mon amour puisque tu m'aimes
J'irais jusqu'au bout du monde
Je me ferais teindre en blonde
Si tu me le demandais
J'irais décrocher la lune
J'irais voler la fortune
Si tu me le demandais
Je renierais ma patrie
Je renierais mes amis
Si tu me le demandais
On peut bien rire de moi
Je ferais n'importe quoi
Si tu me le demandais
Si un jour la vie t'arrache à moi
Si tu meurs que tu sois loin de moi
Peu m'importe si tu m'aimes
Car moi je mourrais aussi
Nous aurons pour nous l'éternité
Dans le bleu de toute l'immensité
Dans le ciel plus de problèmes
Mon amour crois-tu qu'on s'aime
Dieu réunit ceux qui s'aiment »
Pour écouter un extrait de cette chanson, cliquer ICI. (format Windows Media Player]. Source
Rédigé le 14 mars 2005 à 00:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
13 mars 2005
13 mars 1900/Arrivée à Paris de la danseuse américaine Isadora Duncan
13 mars 1900 : Isadora Duncan et sa mère quittent les Etats-Unis pour venir s’installer en Europe. Formée à Chicago dans la tradition dite « classique », Isadora Duncan se détache de sa formation pour la pousser paradoxalement encore plus loin. Inspirée par l’art antique dont elle étudie les poses dans la statuaire grecque, elle évolue, pieds nus, vêtue d’une toge ample pareille à celles des Trois Grâces de Botticelli.
Peu appréciée du grand public de son temps, Isadora Duncan est reconnue aujourd’hui comme l’inspiratrice, la muse, la visionnaire qui a révolutionné l’art de la danse : « Danser c’est vivre, dit-elle. Ce que je veux, c’est une école de la vie ». Une école qu’elle désire en harmonie avec la nature.
Longtemps après sa mort, survenue en 1927, nombreux sont les danseurs qui se sont inspiré de sa philosophie et de son talent. Évoluant librement « par les champs et les grèves ». Dont le danseur François Malkovsky (1889-1982), dit "Malko", inventeur de la « Danse libre », qu’il a enseignée, et notamment pratiquée dans la marine de Pinu (Cap-Corse) où « à quatre-vingt-dix ans, dans la nudité de son corps, chaque matin, il saluait en dansant le lever du soleil. » (Claude Louis-Combet, 2004).
En 1934, Jean Cocteau rend hommage à la célèbre danseuse, qui lui sert de modèle pour le personnage féminin des Enfants Terribles. Tout comme Isadora Duncan, Élizabeth, la grande prêtresse des Enfants Terribles, meurt étranglée par son écharpe. Entortillée autour des roues de sa décapotable.
Rédigé le 13 mars 2005 à 11:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
12 mars 2005
12 mars 1936/Maggie Teyte enregistre
les Chansons de Bilitis de Debussy

Label « NAXOS HISTORIQUES »
Coffret de 2 CD sorti le 07 juin 2004
Le 12 mars 1936, enregistrement « historique » chez HMV (His Master’s Voice) des Fêtes galantes, des Trois Chansons de Bilitis et du Promenoir des deux amants de Claude Debussy par la soprano écossaise Maggie Teyte. Elle est accompagnée au piano par Alfred Cortot. Le disque reçoit un accueil triomphal du public.
Grande voix du siècle, interprète spécialiste de Debussy et du répertoire de mélodies françaises (dont Henri Duparc), Maggie Teyte avait été choisie par le maître pour remplacer Mary Garden dans le rôle de Mélisande lors de la reprise de Pelléas et Mélisande le 12 mars 1908 à l’Opéra-Comique de Paris. Née à Volverhampton le 17 avril 1888, Maggie Teyte est morte à Londres le 26 mai 1976.
Les Trois Chansons de Bilitis, extraites du recueil de Pierre Louÿs (1870-1925), ont été mises en musique par Debussy entre mai 1897 et mars 1898.
Ci-après le poème « La chevelure » :
« Il m'a dit: "Cette nuit, j'ai rêvé.
J'avais ta chevelure autour de mon cou.
J'avais tes cheveux comme un collier noir
Autour de ma nuque et sur ma poitrine.
Je les caressais, et c'étaient les miens;
Et nous étions liés pour toujours ainsi,
Par la même chevelure, la bouche sur la bouche,
Ainsi que deux lauriers n'ont souvent qu'une racine.
Et peu à peu, il m'a semblé.
Tant nos membres étaient confondus,
Que je devenais toi-même,
Ou que tu entrais en moi comme mon songe."
Quand il eut achevé,
Il mit doucement ses mains sur mes épaules,
Et il me regarda d'un regard si tendre,
Que je baissai les yeux avec un frisson. »
Pour en savoir plus sur Maggie Teyte, se reporter au site cantabile-subito (en anglais). Il est possible d’y entendre la voix de Maggie Teyte, dans une mélodie de Duparc (« Phidylé », Leconte de Lisle : « L'herbe est molle au sommeil sous les frais peupliers, /Aux pentes des sources moussues, /Qui dans les prés en fleur germant par mille issues, /Se perdent sous les noirs halliers. [...] »), accompagnée au piano par Gerald Moore [un enregistrement de 4min 45s datant de 1940].
Rédigé le 12 mars 2005 à 10:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
11 mars 2005
11 mars 1931/Mort de Murnau
11 mars 1931 : mort d’un des maîtres de l’expressionnisme allemand, le cinéaste Friedrich Wilhelm Murnau (né en 1888), le réalisateur de Nosferatu le vampire (1922).
Qui n’a en mémoire la longue silhouette noire de Nosferatu se penchant, le visage blême, sur le cou virginal de sa victime endormie ? Un Nosferatu fou d’un amour désespéré. Qui hulule sa mort en étirant son corps décharné et meurtri vers la lumière du jour !
Inspiré du Dracula de Bram Stoker (1887), un incontournable « classique de la littérature fantastique », Nosferatu le vampire est le père d’une longue lignée de descendants. Dont le dernier en date est le très baroque Nosferatu de Francis Ford Coppola (1992).
Rédigé le 11 mars 2005 à 12:25 | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack
10 mars 2005
Zoé Valdés/Paquita Valdès

Zoé Valdés
Image, G.AdC
Zoé Valdés ! Le nom de la romancière cubaine résonne en écho infini dans mon immatérielle mémoire. Un nom aux senteurs de tabac. Un nom de fougueuse habanera. Qui s’enracine dans la vie et plus loin, en moi, « en littérature ». Si j’aime Zoé Valdés, c’est aussi parce que son nom m’évoque son « presque » double féminin antérieur, Paquita Valdès.
Paquita Valdès ? Une héroïne balzacienne méconnue. Héroïne du roman La Fille aux yeux d’or. Un bijou de belle, ciselé à l’or fin. Mais une héroïne de la tragédie amoureuse. La belle Paquita est en effet sous la coupe d’une femme de pouvoir, une marquise redoutable qui la tient entre ses griffes. « La fille aux yeux d’or » ne sort qu’accompagnée de sa duègne espagnole, Concha Marialva, chargée de veiller précautionneusement à la « suave créature ». Mais Paquita est de la race des fulve, une femme de feu. Un feu qui brille dans ses yeux mordorés comme dans les yeux des grands fauves qui somnolent languissamment dans la savane. Un feu qui couve jusque dans ses « formes ardentes et voluptueuses ». Un feu qui mettra Henri de Marsay au supplice. Le « chef des Dévorants », bel Adonis éperdu de passion, ne pourra sauver son amante du drame final.
Ce roman, qui boucle la trilogie de l’Histoire des Treize, évoque avec finesse l’homosexualité féminine au XIXe siècle. Il trouve son miroir inversé dans La Duchesse de Langeais. Du même Honoré de Balzac. La duchesse de Langeais, malmenée par Armand de Montriveau son amant, en même temps que par les extravagances de la jalousie amoureuse, choisit de guerre lasse, la chasteté. Qui la conduit jusque dans un couvent espagnol de carmélites déchaussées. Et jusqu’au désespoir !
Voir aussi Chasteté, chasteté de Zoé Valdés.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 10 mars 2005 à 22:26 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
10 mars 1940/Mort de Mikhaïl Boulgakov
10 mars 1940 : soixante-cinquième anniversaire de la mort de l’écrivain russe Mikhaïl Boulgakov, auteur du roman Le Maître et Marguerite.
Ce n'est qu'en février 1940 que le romancier met un terme à son roman. Quelques jours à peine avant sa mort (Boulgakov avait entrepris la rédaction du roman fin 1928/début 1929). Boulgakov ne verra donc pas la publication de ce chef-d’œuvre qui ouvre à la littérature russe, sans cesse soumise à la censure, un espace de liberté. Un défi que le romancier s’était donné à lui-même, sans espoir aucun de parvenir à le relever.
EXTRAIT
Chapitre vingt-trois : Un grand bal chez Satan
« Minuit approchait, il fallait se hâter. Marguerite distinguait confusément les objets qui l’entouraient. Elle garda le souvenir des bougies, et aussi un grand bassin d’onyx où on la fit descendre. Quand elle y fut, Hella, aidée de Natacha, versa sur elle un liquide chaud, épais et rouge. Marguerite sentit un goût salé sur ses lèvres, et comprit que c’était du sang. Puis cette robe écarlate fit place à une autre, épaisse aussi, mais transparente et d’une teinte rose pâle, et Marguerite fut étourdie par le parfum de l’essence de roses. Ensuite on la fit allonger sur un lit de cristal et, à l’aide de grandes feuilles vertes, on frictionna son corps à le faire briller.
À ce moment le chat vint à la rescousse. »
Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite, Pocket, 1994, page 357.
Le Maître et Marguerite a été adapté pour le théâtre par Jean-Claude Carrière. Création de la Comédie de Picardie en 2000, la pièce, mise en scène par Lisa Wurmser, a été représentée dans treize villes de France. Comédienne, auteur et metteur en scène, Lisa Wurmser a été formée par Tania Balachova et Ariane Mnouchkine.
Retour à la chronologie de l’agenda
Rédigé le 10 mars 2005 à 11:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
Françoise Jones/Transports d'ailes saisies
Verdures au vide appendues
cris
noués
Transports d’ailes saisies
Griffon
Nasse que saturent des silences ouvrés
Françoise Jones, Transports d’ailes saisies, recueil de poèmes,
éditions Laurence Mauguin, 2003.
Françoise Jones est née en 1947 à New York, et vit à Paris. Enseignante en ethnologie et sociologie à la faculté de philosophie et de sciences sociales d'Amiens, poète, peintre et graveur, elle se refuse au mélange des genres. Dans chacun des territoires qu'elle arpente, Françoise Jones crée une oeuvre indépendante et exemplaire, qui vit avec son point fusionnel propre. Pour elle, l’âge d’or est celui de l’enfance préscolaire où elle a découvert « les couleurs, les lignes, les mots ». Depuis lors, « elle peint, elle dessine, elle écrit, et marche à la découverte d’un jardin (le premier) mi-corseté, mi-friche en verger ».
« Couleurs et lignes et mots ne sont pas pour moi "réels", c’est-à-dire présents, en tant qu’eux-mêmes. Tableau ou poème ne sont pas d’abord objet, chose, mais lieu de pertinence et moment opportun entre dicible et lisible, configuration et vision.
Dans ce qui est peint, gravé, écrit, le blanc comme le silence, s’imposent nécessaires à la tension des mots écrits et dits, du noir, des couleurs, du sens qui ne se réduit pas à la signification : s’il y a vide, qu’il soit espace où l’air circule, et non pas néant.
Ainsi au-delà de toute attente d’intelligibilité immédiate, figuration ou abstraction, l’œuvre, qui est surgissement, offre la présence conjointe de l’échelle et de l’énigme. »
Françoise JONES
« Comment aborder une oeuvre, celle de Françoise Jones, qui est simultanément poésie et peinture, issues l'une et l'autre d'une seule et même expérience originelle, de soi et du monde ?
La poésie ici paraît d'abord intimement liée à l'organisation de l'espace, alors qu'elle est un rythme temporel qui, merveilleusement, s'amplifie à travers un nombre restreint de mots, parfois une dizaine, mots pourvus d'un extraordinaire pouvoir d'aimantation, qui s'attirent et se repoussent, pour créer un champ magnétique d'une extrême densité. Le vide y joue un rôle essentiel, permettant la circulation d'une énergie que la voix projette dans une parole à la limite du dicible et qui devient ces signes tracés qui attendent un autre regard, une autre voix pour s'incarner de nouveau. »
Sami Ali, Paris 2004
Mercredi 9 mars 2005 :
dans le cadre du Printemps des poètes,
Françoise Jones lit plusieurs de ses poèmes
devant deux de ses toiles.
Actuellement (jusqu'au 5 avril 2005)
Exposition de peintures
EN SUSPENS
SURGIS
Adresse : Espace Paul-Mayer, Présidence
Université de Picardie Jules-Verne
Chemin du Thil
AMIENS
Tél. : O3 22 82 72 49
Principales expositions de Françoise Jones.
Voir aussi l' index général des auteurs.
Rédigé le 10 mars 2005 à 09:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
09 mars 2005
Brina Svit/Turris eburnea
Moreno, de l’écrivain slovène Brina Svit, aurait pu s’intituler Mohammed. Mohammed, le « casiero » marocain à qui l’auteur dédie ce livre, juste avant le Sarde Walter et l’Albanaise Milika. Eh bien non ! Il s’appelle bien Moreno. Brina Svit en a décidé ainsi ! Ce texte porte le nom d’un homme fugacement rencontré à la terrasse du Rivoire de la Piazza della Signoria à Florence. Un homme passe-murailles qui n’apparaît que pour mieux disparaître. Ne laissant dans son sillage qu’une plume d’ange sur les lambris de la Galerie des Offices.
Brina n’est pas particulièrement à la fête. Pourtant, la gâtée, c’est en Toscane qu’elle séjourne. Dans la luxueuse propriété que la « Baronessa » Beatrice Monti della Corte Rezzori met pendant deux mois à la disposition de ses hôtes écrivains et botanistes. Le temps pour chacun de « pondre » son ouvrage. Tous sont là, dûment sélectionnés par un comité d’auteurs avec grande et perspicace dilection. Convoqués pour écrire. Cinq cent mots par jour. C’est dans le contrat. Une astreinte que Brina a bien du mal à endurer. La « turris eburnea, slonokoščeni stolp, la tour d’ivoire, la Torre en un mot », loin de lui insuffler l’inspiration indispensable, la décourage avant même que d’y être installée ! Pourtant, in fine, malgré les crises de doute et de découragement, le texte est là, avec son titre trisyllabique, qui happe le lecteur vers un personnage masculin. Peut-être une histoire d’amour ! Un roman d’amour, alors ? Eh bien non, ce n’est pas tout à fait un roman. Ou si ce texte est un roman, son héros n’est pas celui que l’on croit. Du reste, le texte est écrit à la première personne. Il tient donc davantage de l’autofiction. Quoique, là aussi, une nuance s’impose ! D’autant plus que Brina Svit dénonce avec un brin d'humour ce « pli des écrivains français qui tournent si volontiers autour de leur personne en autofictionnant ». Le soupçon est grand de croire Brina à son tour prise au piège. Aux prises avec son propre « je ». La voilà qui s’interroge : « Alors que se passe-t-il ? Que m’arrive-t-il ? » Questions qui reprennent en leitmotiv la première interrogation d’Enfance de Nathalie Sarraute : « Alors, tu vas vraiment faire ça ? ». Non, Brina la Slovène ne va pas se lancer elle aussi dans le récit pathétique de ses souvenirs d’enfance. Son projet est bien autre. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Rien moins que d’une écriture en train de naître à une langue qui n’est pas sa langue d’enfance. Une écriture qui cherche ses mots par tâtonnements, une voix qui module ses arpèges en se rebellant. Une écriture qui émerge dans la souffrance et l’incompréhension. L’écriture d’une « extracomunitaria » que seule la tendre présence de déclassés, de « métèques » comme elle, sauve de la désintégration identitaire et de l’échec. Mais Mohammed est là. Qui veille sur elle, attentionné et attentif. La protège malgré le désespoir profond qui est le sien. Il est sa Sainte-Victoire à elle. Celui dont elle n’écrira pas le roman.
Contre l’étiquette et l’autorité tranchante de la « Baronessa », qui clôt son au-revoir par ces mots : « Ne manquez surtout pas de m’envoyer votre rapport », Brina Svit répond par un cadeau tout droit sorti de ses nuits tourmentées à la Torre - nuits d’orage, nuits de « grappa »,… -, un cadeau intitulé Moreno.
Brina Svit, Moreno, Gallimard, 2003.
Voir aussi :
- Belle de mars
- Portrait de  Brina Svit par Guidu Antonietti di Cinarca.
Brina Svit par Guidu Antonietti di Cinarca.
- Rue des illusions perdues.
BIO-BIBLIOGRAPHIE
Brina Svigelj Mérat, dite Brina Svit, est née à Ljubljana en 1954.
Brina Svit a fait des études supérieures à l'université de Ljubljana (littérature comparée et français) et s'est installée à Paris en 1980 où elle a poursuivi des études d'audiovisuel au Centre national pour l’action artistique et culturelle (CENAC, Paris, 1985-1987). April, son premier roman, a été publié en 1984, son deuxième roman (un roman épistolaire dans la tradition de Laclos, cosigné par son ami Peter Kolšek), Navadna razmerja (Liaisons ordinaires), étant paru en 1998. Romans encore inédits en français.
Le premier roman publié en France est Con brio (Gallimard, 1998) et le second Mort d'une prima donna slovène (Gallimard, 2001) [Smrt slovenske primadone, 2000]. Le premier essai d’écriture en langue française de Brina Svit remonte à 2001, date à laquelle elle a publié dans le supplément spécial du Monde (juillet 2001) un court récit de 25 pages intitulé « L'été où Marine avait un corps ». En 2003, elle publie chez Gallimard Moreno, écrit en avril-mai 2002 dans la résidence d'écrivains de la « Baronessa » Beatrice Monti della Corte Rezzori, veuve de l’écrivain Gregor von Rezzori. Brina Svit met actuellement la dernière main à son deuxième roman écrit directement en français. Celui-ci paraîtra dans le courant de l’année 2005. Parallèlement à son activité d'écrivain, Brina Svit est la correspondante régulière du quotidien slovène Delo.
Si Brina en italien (et en corse) veut dire « givre », Svit désigne en slovène « cet instant d'avant l'aube où les oiseaux s'arrêtent de chanter », pseudonyme qui est apparu pour la première fois dans le générique du premier court métrage de Brina Svit, Nikola (1989, avec Brigitte Fontaine. Prix du public au Festival de Dunkerque), film qui a été suivi d’un autre court métrage, Le Balcon (1990, avec Anémone. Prix du jury au Festival de Grenoble), et De Jeanne à Zerline (documentaire sur Jeanne Moreau). Brina Svit a aussi écrit deux pièces radiophoniques (en français) : Entré dans ma vie par la fenêtre et L’institutrice au fond d’un puits.
Pour lire un extrait de Moreno (« la nuit visage »), cliquer ici.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 09 mars 2005 à 12:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
9 mars 1929/Manifeste des écrivains prolétariens de langue française
Un an avant la sortie du Manifeste de la littérature prolétarienne (Nouvel Age littéraire) d’Henry Poulaille (1896-1980), publication, le 9 mars 1929 (n° 4/5 de la revue Tentatives, février/mars 1929), du Manifeste de l'équipe belge des écrivains prolétariens de langue française. Il est signé par l'écrivain-mineur Pierre Hubermont (cf. Treize hommes dans la mine, Labor, 1993; un des plus forts et plus beaux témoignages sur la mine), Albert Ayguesparse et Françis André. Dans l’éditorial, ils déclarent que leur ambition « n’est pas de fonder une chapelle littéraire, mais d’élever en face de la littérature bourgeoise une vigoureuse littérature moderne au rôle humain du prolétariat. »
Lire aussi La Littérature & le peuple (Plein chant, 2003), qui réunit l’ensemble des articles théoriques d’Henry Poulaille sur la question de la littérature prolétarienne (1924-1975).
Rédigé le 09 mars 2005 à 12:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
07 mars 2005
7 mars 1908/Anniversaire de la naissance
d’Anna Magnani
Née le 7 mars 1908 à Alexandrie, l’actrice italienne Anna Magnani décédera le 26 septembre 1973 à Rome. Elle a joué Camilla dans Le Carrosse d’or de Jean Renoir (1952) et Serafina Della Rose dans La Rose tatouée de Daniel Mann (1954), mais est surtout inoubliable dans le rôle de Pina dans Rome, ville ouverte (Roma, città aperta) de Roberto Rossellini (1945) et celui de Mamma Roma dans le film éponyme de Pier Paolo Pasolini (1962).
« Elle parle. Elle jette sa vie sur sa langue. Elle a toujours voulu tout et tout de suite. Elle est une comédienne célèbre. Elle a beaucoup parlé avec les mots des autres. Elle n’avait pas le temps de sa propre vie, mais voilà que son corps l’a rattrapée, l’a même doublée. Elle met du passé dans ce présent trop mortel. Elle appelle ses amis : Fellini, Pasolini, Visconti. Elle sait qu’il est trop tard. Elle ne s’y résigne pas. Elle ne s’est jamais résignée. »
Bernard Noël, La Langue d’Anna, « Quatrième de couverture », POL, 1998.
Ci-après :
- une courte séquence vidéo du film Roma, città aperta [format : RealPlayer]
©Rai Radiotelevisione Italiana
- une fiche biographique (en italien) sur Anna Magnani.
Rédigé le 07 mars 2005 à 07:27 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
06 mars 2005
Contemporain, le Moyen Âge ?
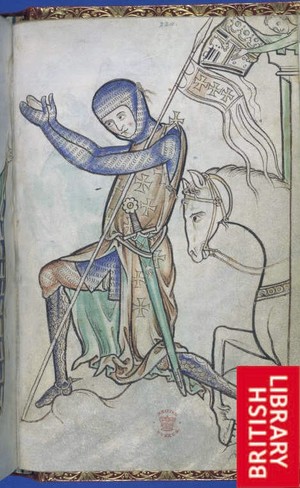
Croisé à genoux en armure.
Psautier de Westminster (vers 1250).
British Library, Londres.
Le dossier Moyen Âge du dernier Figaro Littéraire (lire plus particulièrement l'article « Le Moyen Âge monte au créneau » de Paul-François Paoli, en date du 3 mars 2005) et la sortie tonitruante aux éditions Robert Laffont du premier roman de David Camus, Les Chevaliers du Royaume, en pile dans les librairies et les maisons de la presse (lire, sur ce blog, mon article « Regards croisés d'une femme »), invitent à une plus large réflexion sur le retour du médiéval sur la scène culturelle européenne. Ci-dessous, une amorce d'analyse diachronique de cette montée au créneau. Le débat est ouvert.
Angèle Paoli
Une vague de publications, de films et de festivals sur la période médiévale submerge actuellement l’Europe. Cette réhabilitation de temps tenus encore récemment pour gothiques, et donc barbares, ne répond-elle qu’à un souci de clairvoyance historique ? Qu’est-ce qui, à l’aube du XXIe siècle, explique « ce retour en force du refoulé médiéval » sur la scène culturelle ?
Jusqu’à des temps étonnamment proches, parler de Moyen Âge n’était qu’une façon détournée – imagée ou métaphorique – d’évoquer diverses formes d’obscurantisme. Par opposition aux modèles antiques et à l’harmonieuse lumière de l’environnement platonicien ou épicurien. Par opposition aussi aux temps de la Renaissance.
Ni fin ni mesure
Ces mots de « Moyen Âge » étaient aussi évocateurs de chaos et de barbarie. Pêle-mêle s’y mêlaient les sanglantes conquêtes des Croisades (sac par les armées franques de la Jérusalem céleste), les bûchers de l’Inquisition ou encore ces fléaux qu’étaient les guerres féodales, flanquées de leurs funèbres et impitoyables félons. Qui avaient pour noms famines et épidémies. Butins et disette. « Il y avait tant de morts qu’on n’en pouvait trouver ni fin ni mesure » (Geoffroi de Villehardouin, Conquête de Constantinople, vers 1212).
Cette représentation fantasmatique d’un monde à la fois crépusculaire et hors-la-loi a pris peu à peu racine dans l’imaginaire et dans l’inconscient des peuples. Aujourd’hui encore, nombre de stéréotypes véhiculés par le langage courant continuent d’alimenter cette vision d’apocalypse. Pour qualifier un acte ou un événement d’une indicible et intolérable barbarie, n’est-il pas coutumier de déplorer « un retour au Moyen Âge » ? Clichés contre lesquels la plupart des grands médiévistes (de Georges Duby à Michel Zinc en passant par Philippe Wolff) se sont insurgés de manière solidement argumentée.
Cette perception trouble s’explique en partie par une approximation de repères chronologiques. C’est que les historiens ne sont jamais parvenus à s’entendre pour délimiter précisément la période que recouvre le Moyen Âge. Même si la plupart s’accordent, à quelques ajustements près, à le faire durer mille ans : de la chute de l’Empire romain (476) à la prise de Constantinople par les Turcs (1453), ou encore à la découverte des Amériques par Christophe Colomb (1492).
Un terreau fertile pour les mythes et la philosophie
C’est pourtant dans les quatre derniers siècles de la période médiévale que l’Occident a vu surgir sur son sol, dès le XIe siècle, ses plus sublimes joyaux : les cathédrales. C’est bien à partir de ce même siècle que sont nés les chansons de geste (Chanson de Roland) et les premiers romans de chevalerie (Lancelot ou le Chevalier à la charrette et Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes) ; qu’ont été magnifiés Arthur et Merlin, héros indissociablement gémellaires dans leur quête éperdue du Saint Graal, la coupe dans laquelle Joseph d’Arimathie avait recueilli le sang du Christ ; c’est bien dans la première moitié du XIIe siècle qu’apparaît sur la scène littéraire le mythe de Tristan, qui, aux côtés d’Yseut, incarne un couple aussi indéfectible que celui d’Héloïse et de l’hérétique Abélard. C’est bien au XIIIe siècle que triomphe le prince de la philosophie scolastique, Thomas d’Aquin.
Les médiévistes s’étaient pourtant escrimé à jeter à la trappe les charrettes d’ignominie qui noircissaient notre vision de l’époque (ignominies dont Régine Pernoud a fait l’inventaire dans Pour en finir avec le Moyen Âge [1977], un ouvrage qui fait date dans l’historiographie médiévale). Plus d’un historien était monté à la tribune pour faire le panégyrique d’un patrimoine occulté, voire enfoui, par le soc de l’histoire et de ses remblais Rien n’y faisait. Aucun discours n’était parvenu à infléchir les mentalités.
Naissance du roman policier
Rien n’aurait peut-être véritablement changé sans l’engouement pour le Moyen Âge qui a pris naissance et trouvé son essor sur les terres d’Angleterre. Regain si puissant et novateur qu’il contribua à l’émergence de nouveaux genres littéraires et cinématographiques. Parmi lesquels le roman policier médiéval, dont la paternité revient à la romancière britannique Edith Pargeter (1913-1995). Et à sa trilogie la Pierre de vie, le Rameau vert et la Graine écarlate. Mais c’est avec la mise au monde du premier-né de la chronique médiévale du frère Cadfael, Trafic de reliques, en 1977, qu’Edith Pargeter, alias Ellis Peters (l’un de ses noms de plume), franchit les frontières de la renommée. Moine gallois de l’abbaye de Shrewsbury et herboriste à ses heures, le frère Cadfael est aussi un finaud limier dont le flair n’a rien à envier à celui des détectives des grands thrillers. Si ce n’est que l’action du roman transporte le lecteur dans l’Angleterre féodale du XIIe siècle. Ellis Peters a eu depuis plus d’un émule talentueux, dont Paul C. Doherty, le père de l’enquêteur Hugh Corbett.
Mais c’est avec la publication italienne, en 1980, du best-seller le Nom de la rose, que le sémillant sémiologue bolonais Umberto Eco a apporté un sang littéraire radicalement neuf au roman policier anglo-saxon, tenu jusqu’alors dans les pays latins, dont la France, pour un genre mineur. L’érudition incontestable et l’autorité incontestée de son auteur ainsi que les références aristotéliciennes de ce monument de la littérature théologico-policière animent l’ouvrage de ce supplément d’âme philosophique qui en transcende la lettre et l’esprit. Pour autant, le lecteur y retrouve à tout moment les conventions du genre.
En France a désormais fleuri une littérature policière de même inspiration qui contribue au succès de la collection « Grands Détectives » des Éditions 10/18. En témoignent les Aventures d’Artem (au cœur de la Russie du XIe siècle) de l’auteure franco-russe Elena Arseneva ou les enquêtes d'Erwin le Saxon de Marc Paillet.
Du Seigneur des anneaux au pseudo-médiéval
C’est encore à l’Angleterre que l’on doit l’émergence du roman médiéval fantastique. Le gourou en la matière est Tolkien, un philologue britannique qui est aussi le créateur de l’heroic fantasy, épopée moyenâgeuse où le héros solitaire se voit confronté à toute une série d’épreuves qui ont valeur d’initiation. La trilogie du Seigneur des anneaux en est l’avatar le plus abouti. Si le récit regorge de créatures fantasmagoriques — lutins, phénix, elfes et dragons —, conformément aux lois du genre, l’univers éclaté des héros de la « Terre du milieu » est le reflet fidèle des structures politiques du monde féodal. C’est bien l’Angleterre du VIIIe siècle et ses dialectes oubliés que fait revivre cette saga. La trilogie, récemment portée à l’écran par le metteur en scène américain Peter Jackson (la Communauté de l’anneau, les Deux Tours, le Retour du roi), a remporté le franc succès que l’on sait.
Profitons-en pour souligner que c’est au croisement de l’heroic fantasy et de la science-fiction qu’est également né un genre en vogue, le « médiévofuturisme ». Prenant appui sur une conception cyclique du temps, celui-ci associe et brouille avec habileté passé et futur. À la manière des jeux de rôle consacrés à la période médiévale, dont les héros s’apparentent à des archétypes, à des figures universelles. Miles Christi, créé en 1995 par Benoît Clerc, Arnaud Bailly et Thibaud Béghin, en est un bel exemple.
Cependant, excepté Tolkien ou Paul C. Doherty (professeur d’histoire médiévale), la production fictionnelle policière ou fantastique est loin d’avoir les mêmes prétentions d’historicité. Elle est donc loin de présenter les mêmes garanties. En réalité, ces nouveaux genres, s’ils contribuent à revisiter une époque méconnue, font surtout émerger un « pseudo-médiéval » qui n’a pas l’adoubement des experts patentés. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les deux tomes du Dictionnaire du Moyen Âge de Jean Favier ou le docte Dictionnaire du Moyen Âge de Claude Gauvard, Alain de Libera et Michel Zink (PUF) où ne figurent aucune entrée ni occurrence de termes tels que « médiévofuturisme » ou « heroic fantasy » !
Le Diable et le Bon Dieu
Face au foisonnement de cette littérature, magnifiée par le cinéma, et à son succès, une question s’impose : qu’est-ce qui, à l’aube de ce XXIe siècle, explique le retour en force du médiéval sur la scène culturelle européenne ? Faut-il y voir comme d’aucuns une contre-culture cherchant à compenser l’hégémonie de productions américanisées ou un moyen d’exorciser la peur suscitée par l’arrivée, à nos frontières, d’autres influences ? Ce médiéval pourrait-il être le porte-flambeau de valeurs occidentales idéalisées ? Le succès de plus en plus populaire de manifestations comme, par exemple, (en mai) le Mois médiéval de Champagne-Ardenne, ─ organisé en collaboration avec le très docte Centre d'études médiévales créé en 1996 ─, ne peut-il être interprété comme un rempart idéologique et un exorcisme (au nom de la chrétienté médiévale et de l’orthodoxie qui la sous-tend) contre la montée de certaines barbaries fortement diabolisées et dites incapables du moindre raffinement ? Si l’on s’en tient à la célèbre formule du psychanalyste Daniel Sibony, « plus on refoule l’idée de la mort et plus elle revient nous hanter, sous d’autres formes », la résurrection d’un Moyen Âge fortement idéalisé ne serait-elle pas l’une des réponses manichéennes possibles à cette hantise ?
Texte©angèlepaoli
Voir aussi Regards croisés d'une femme (à propos des Chevaliers du Royaume de David Camus).
Rédigé le 06 mars 2005 à 11:34 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
05 mars 2005
5 mars 1989/Ouverture d’une rétrospective
du peintre Kasimir Malevitch
5 mars 1989 : ouverture au Stedelijk Museum d’Amsterdam de la première grande rétrospective européenne (depuis celle de Berlin : 7 mai 1927-30 septembre 1927) des œuvres du peintre russe Kasimir Severinovitch Malevitch, grande figure de l’avant-garde russe et théoricien du « suprématisme », le mouvement pictural le plus radical de la première moitié du XXe siècle. Cette exposition-rétrospective se tiendra jusqu’au 29 mai 1989. La première a eu lieu à Leningrad (10 novembre 1988-10 décembre 1988). Cette exposition rejoindra ensuite les cimaises de la galerie Tretiakov à Moscou (29 décembre 1988-10 décembre 1989).

Fiche d’identité et source :
Croix (noire), 1915
Huile sur toile
80 x 80 cm
Don de la Scaler Foundation par l’intermédiaire de la Beaubourg Foundation, 1979
AM 1980-1
© Estate Malevitch
Pour en savoir plus sur Malevitch, voir le dossier documentaire du Musée national d’art moderne (Centre Pompidou) consacré à « La naissance de l’art abstrait ».
Voir aussi le site Malevitch on line (hélas plusieurs liens importants sont inactifs).
Autre lien : ici.
Ci-dessous, reproduction d'une huile sur toile du peintre français André Léocat (né en 1949 et ayant appartenu au groupe Finistère). Un très bel hommage au courant suprématiste.
André Léocat, Il est midi, huile sur toile, 1991.
Collection privée. D.R.
Goût et mauvais goût
« La société et la critique entendent par œuvre picturale quelque chose d’inexplicable, un phénomène mystérieux inspiré par un esprit créateur inconcevable et insondable […]. Les centimètres du goût, « plaire » et « déplaire » n’y sont pour rien, d’autant plus qu’ils sont toujours subjectifs, et de plus, le goût n’est pas tout à fait ce qu’on croit. Ce n’est pas l'élément qui a bon goût, tel quel ; toutes les choses, qu’elles aient bon goût ou mauvais goût, créent l’harmonie : le sel, le sucre, le vinaigre, la moutarde ; il faut absolument qu’il y ait un centimètre scientifique que la critique et la société puissent appliquer aux œuvres picturales perçues comme des formules picturales scientifiques. Quand elles recourent au centimètre du goût, la société et la critique rejettent telle ou telle œuvre. Parce qu’elles la trouvent de mauvais goût, parce qu’elle leur déplaît. [Avec] cette mesure, la société aurait pu manquer tout et se limiter aux poires, aux oranges et aux gâteaux qui ont bon goût, que le reste aille au diable ; seulement, comme on le sait, il y a du sel partout et […] il a aussi bon goût […] ; une idée vient, et l’on peint en conséquence, on l’aime et elle a bon goût […]. Aussi la société a-t-elle tort de damner la plupart des peintres [...) »
Kasimir Malevitch, « Dans mon expérience de peintre » [mars 1924] (extrait), Malévitch, artiste et théoricien, Flammarion, 1990, p. 202.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 05 mars 2005 à 13:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
Regards croisés d'une femme
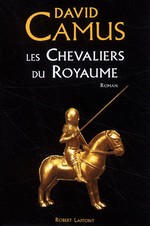
David Camus, Les Chevaliers du Royaume
Regards croisés d’une femme sur Les Chevaliers du Royaume de David Camus
Les Éditions Robert Laffont ont publié le mois dernier un roman tonitruant et flamboyant, Les Chevaliers du Royaume, annoncé tambour battant (sous le titre de Miles Christi) dès l'automne dernier. Roman dont il est attendu un "franc et massif" succès populaire, comme le laissent entendre l'imposante mise en place de l'ouvrage en librairie et la campagne de presse actuelle. Ce roman, vaste fresque politico-religieuse à caractère épique, est le premier roman d’un romancier de trente-cinq ans : David Camus.
Grand amateur de science-fiction, auteur d’une nouvelle parue en 1998 dans la revue Galaxies, sous le titre : « La nuit des petits hommes verts », David Camus, sous ses dehors calmes et sérieux, aime les grands frissons et rêve probablement d'en découdre ! Mais déjà, longtemps avant de se plonger dans l’écriture (mais aussi dans la traduction, l’édition, la réalisation cinématographique... et le référencement de sites), il avait indirectement participé, sous pseudonyme, à la scénarisation de jeux de rôles moyenâgeux. Jeux qui lui ont fourni, quelques années plus tard, la trame toute trouvée de son futur roman. Une épopée tout entière ancrée dans la période qui annonce le début de la troisième croisade. Pour les chrétiens, la plus cruelle des croisades, celle qui a suivi la prise de Jérusalem et qui a marqué la « Terre Sainte » des stigmates de la haine.
Dès les premiers chapitres de cette somme (vingt-cinq chapitres en tout, sans compter le prologue et l'épilogue), le lecteur est plongé tout vif dans le « bruit et la fureur » de la bataille d’Hattīn (près du lac Tibériade, en Galilée), menée par Saladin contre les croisés et les soldats du Christ. Nous sommes au XIIe siècle (4 juillet 1187). Saladin le sunnite sortira vainqueur de ce tumulte qui sème la déroute au cœur des armées franques, entraîne la prise de Jérusalem (le 2 octobre) et provoquera la troisième croisade (proclamée le 29 octobre 1187 par le pape Grégoire VIII).
L’action du roman débute in « medias res ». C'est-à-dire, ici, en pleine bataille. Une bataille décrite avec une joviale maestria par son auteur, dont la devise personnelle est : « N’écris que ce que tu vois ». Avec un réalisme visionnaire (?) qui n’a rien à envier aux descriptions de la bataille d’Eylau dans Le Colonel Chabert de Balzac (dont David Camus est un avide lecteur), ou à la déroute de la Bérézina dans Guerre et paix de Tolstoï.
Voilà donc le lecteur errant, non pas dans Césarée, mais au milieu des cadavres en putréfaction qui jonchent le sable du désert. Sous un soleil de plomb. Enseveli sous les corps mutilés, les armures démantibulées et les cervelles fumantes de ses compagnons d’armes surgit Morgennes, moine hospitalier, blessé à mort. À qui reste pourtant suffisamment de force et de vivacité d’esprit pour s'enquérir auprès du malheureux évêque d’Acre, Rufinus, de la situation des croisés. Le moine hospitalier renaîtra pourtant de ses cendres. Fin prêt à s'engager, gonfanon en avant, dans de nouveaux combats. Avec l’aide de la miraculeuse Crucifère (étymologiquement « la porteuse de croix »), sa redoutable et vaillante épée, héritée de Baudouin IV et du roi Amaury. D'ailleurs fort convoitée. Quant à Rufinus, il ne fera pas long feu, et son chef, transformé en une ricanante relique, sera lui aussi très prisé. Outre l’épée Crucifère et la tête de l’évêque, d’autres objets-signes se relaient allégrement dans le récit, dessinant d'étranges « arabesques » que les aficionados du genre se réjouiront assurément de décrypter.
Les personnages, fort nombreux (il faut, comme dans les romans de Balzac ou les romans russes, se constituer son lot de fiches pour y retrouver ses petits) sont, pour la plupart, historiquement campés. Tant du côté des Sarrasins que du côté des chrétiens. Dans ce champ clos essentiellement viril, les femmes ont parfois leur rôle à jouer. Un rôle majeur, affirme David Camus. En particulier, la belle et noble Cassiopée. Dont les derniers chapitres dévoileront enfin tous les mystères.
On peut imaginer que Les Chevaliers du Royaume, qui baigne tout au long dans une encre scénaristique, donnera prochainement à voir dans les salles obscures une gigantomachie sanglante sur écran panoramique. « Du grand spectacle, en technicolor, du Chrétien de Troyes scénarisé par Hollywood ,» comme le souligne Jean-Claude Perrier dans Livres Hebdo. Un écran sur lequel il sera d'autant plus aisé d'identifier, en plein carnage et étripage, ces hypocrites trognes barbares que sont les méchants chrétiens. Gonflés des certitudes et dogmes sur lesquels ils fondent leurs méfaits et pour lesquels ils guerroient si ardemment.
Car le roman, hors quelques figures chrétiennes emblématiques qui incarnent la voix de la sagesse, celle de Guillaume de Tyr par exemple, est pour l'essentiel assez manichéen. Et donne de surcroît l’entier avantage aux figures sarrasines. On pourra toujours rétorquer que David Camus respecte en cela les faits historiques. Mais, par-delà l’Histoire événementielle, pourquoi faire si peu de cas des données psychologiques et des mentalités propres à une époque ? Et, à lire David Camus, l’impression qui domine est que, dans le contexte précis de la guerre sainte, seuls les Sarrasins sont justes et loyaux. Une simplification qui n’est pas sans entraîner, du moins à la lecture de ce texte, un oppressant malaise. Voire une poussée de révolte ou de fièvre. Car, même si David Camus se déclare profondément athée, on est en droit de s'étonner qu'il tienne pour négligeables - ou du moins non signifiantes - des sensibilités et croyances qui sont pourtant au coeur de son propre héritage culturel. On en vient du coup à imaginer que l’auteur s’ingénie (plus ou moins consciemment) à raviver de vieilles cendres toujours en activité et à jeter de l’huile sur le feu. Brûlot qui ne peut que contribuer à enflammer des conflits larvés. Mais, si je m’en tiens à la seule lecture en filigrane du communiqué éditorial présenté à la dernière Foire du livre de Francfort, la maison d’édition de David Camus privilégie sans doute le pactole qu’elle imagine pouvoir retirer de ce produit (une fresque cinématographique à la Oliver Stone ?), et de ses produits dérivés, outils marketing déclinables à volonté ! Sans trop s'encombrer d'éthique religieuse ni s'inquiéter des joutes qu'un tel roman risquerait de susciter. Business oblige !
Si les recherches historiques, inspirées des travaux du médiéviste Jean Flory (auteur de Guerre sainte, jihad, croisade, violence et religion dans le christianisme et l’islam, Points/Seuil, 2002), ont abondamment nourri le travail de l’auteur, les péripéties romanesques doivent également beaucoup au merveilleux et au fantastique médiéval propres aux romans de Chrétien de Troyes. Et à Perceval, son infatigable héros. Dont les aventures ont pris fin, on le sait, avec la mort de leur auteur. Qu’à cela ne tienne ! David Camus relève le gant et s'engage à fournir une suite au roman de Chrétien de Troyes. Sur le thème de la disparition de « La Vraie Croix ». Un mystère à ce jour non élucidé par les historiens. Encore moins par l’auteur lui-même. Peut-être lui sera-t-il « donné la grâce » de découvrir ce mystère dans les opus prévus pour 2007 et les années suivantes. Car, selon lui, les pistes qu'il reste à explorer sont nombreuses... tout comme les filons à exploiter !
Les Chevaliers du Royaume, que David Camus se défend (ou craint) de présenter comme un roman violent, est indéniablement à mes yeux un roman où prédomine la violence. En première ligne. Même si cette violence est épisodiquement mâtinée de tendresse. Celle que véhiculent amour et amitié. Un roman dont la teneur risque cependant de déborder la pensée et les intentions de son auteur. Et partant, d’alimenter et de raviver des braises incandescentes. Un roman qui pourrait à terme faire couler beaucoup d’encre !
Le jeune écrivain n'hésite pas à s’interroger à voix haute: « Comment peut-on se battre au nom du Christ ? » Un bel aplomb qui relance à lui seul une polémique potentielle, sur laquelle David Camus a très sûrement bien affûté ses arguments !
David Camus, Les Chevaliers du Royaume, Robert Laffont, 2005. ISBN : 2221103173
Texte©angèlepaoli
Depuis le 14 février, il est désormais possible de suivre les aventures de Morgennes et de ses compagnons sur le site officiel Les Chevaliers du royaume.
Voir aussi :
- la fiche de lecture des éditions Robert Laffont et l'incipit du roman.
- l'article Contemporain, le Moyen Âge ?
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 05 mars 2005 à 12:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
04 mars 2005
Christine de Pisan, « Seulete suy
et seulete vueil estre »
Christine de Pisan [ou de Pizan], première femme écrivain française
à s'être affirmée comme auteure et à avoir vécu de son écriture.
Image, G.AdC
« Seulete suy et seulete vueil estre,
Seulete m'a mon doulz ami laissiée,
Seulete suy, sanz compaignon ne maistre,
Seulete suy, dolente et courrouciée,
Seulete suy en languour mesaisiée,
Seulete suy plus que nulle esgarée,
Seulete suy sanz ami demourée.
Seulete suy a huis ou a fenestre,
Seulete suy en un anglet muciée,
Seulete suy pour moy de plours repaistre,
Seulete suy, dolente ou apaisiée,
Seulete suy, riens n'est qui tant me siée,
Seulete suy en ma chambre enserrée,
Seulete suy sanz ami demourée.
Seulete suy partout et en tout estre.
Seulete suy, ou je voise ou je siée,
Seulete suy plus qu'autre riens terrestre,
Seulete suy de chascun delaissiée,
Seulete suy durement abaissiée,
Seulete suy souvent toute esplourée,
Seulete suy sanz ami demourée.
Princes, or est ma doulour commenciée
Seulete suy de tout dueil menaciée,
Seulete suy plus tainte que morée,
Seulete suy sanz ami demourée. »
Christine de Pisan, Balade XI, 1396/1399, édition Miranda Remnek.
Pour en savoir plus sur Christine de Pisan, se reporter au site de la Bibliotheca Augustana.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 04 mars 2005 à 21:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
4 mars 1989/Cinq césars pour le film
« Camille Claudel »
Le premier film de Bruno Nuytten, Camille Claudel, reçoit cinq césars. Isabelle Adjani, qui joue le rôle de Camille Claudel, se voit décerner le prix de la meilleure actrice.
Reine-Marie Paris, petite-nièce de Camille Claudel, conseillère historique du réalisateur et auteure de deux catalogues raisonnés de l’œuvre de Camille Claudel et d’une biographie de référence sur la sculptrice (Gallimard, 1984), déclare à propos du film réalisé par Bruno Nuytten :
« J'aime beaucoup le film, Adjani […] est belle, émouvante, très proche de la réalité, je pense. Adjani s'est complètement investie dans le rôle, elle a compris l'âme de Camille Claudel […] » (propos recueillis par Emilie Godineau).
Reine-Marie Paris a aussi publié en 2004 (en collaboration avec Hélène Pinet) Camille Claudel. Le Génie est comme un miroir (Gallimard, Collection « Découvertes », 2004), un ouvrage destiné au grand public.
Rédigé le 04 mars 2005 à 10:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
03 mars 2005
3 mars 1966/Première de Bérénice montée par Roger Planchon
3 mars 1966 : création par Roger Planchon de Bérénice de Racine pour le Théâtre de la Cité de Villeurbanne. Avec Francine Bergé dans le rôle de Bérénice (une des deux interprétations mythiques de Bérénice, avec celle de Ludmila Mikaël dans la mise en scène de Klaus Michael Grüber [1984] à la Comédie-Française) …et Sami Frey dans le rôle de Titus; et la collaboration de René Allio, pour les costumes et les décors.
N.B. Cette même année 1966, Francine Bergé joue le rôle de soeur Sainte-Christine dans La Religieuse de Jacques Rivette. L'année suivante, elle interprétera le rôle de Marion dans Benjamin ou les Mémoires d'un puceau, de Michel Deville.
Auteur, comédien, metteur en scène, cinéaste, directeur depuis 1957 du Théâtre de la Cité de Villeurbanne (qui deviendra en 1972 le Théâtre National Populaire), Roger Planchon a créé en janvier 2005 son ultime mise en scène au TNP, Le Génie de la forêt d’Anton Tchekhov (pièce qu'il a interprétée aux côtés de Jean-Pierre Darroussin et d'Hélène Fillières et présentée jusqu’au 6 février 2005 au Studio 24 de Villeurbanne). Parallèlement, il a publié chez Plon un livre de mémoires, Apprentissages (voir l'entretien sur L'Express du 29 novembre 2004).
René Allio (1924-1995) a été le collaborateur fidèle de Roger Planchon dès 1957. Artiste aux talents multiples, il est à l’origine de nouvelles conceptions de l’espace scénique. Conceptions largement nourries par sa propre expérience picturale. Il a directement participé à la naissance et aux années de gloire du Théâtre de la Cité de Villeurbanne et, à ce titre, a créé les décors de L’Avare, Tartuffe ou l'Imposteur... et de Bérénice, et a été le scénographe des metteurs en scène européens les plus prestigieux. Ses archives sont actuellement déposées à l’IMEC (Institut mémoires de l’édition contemporaine).
« Dans l'Orient désert quel devint mon ennui !
Je demeurai longtemps errant dans Césarée,
Lieux charmants où mon coeur vous avait adorée.
Je vous redemandais à vos tristes États;
Je cherchais en pleurant les traces de vos pas.
Mais enfin succombant à ma mélancolie,
Mon désespoir tourna mes pas vers l'Italie.
Le sort m'y réservait le dernier de ses coups. »
Racine, Bérénice, Acte premier, scène IV.
A l'affiche du 2 au 30 avril 2005 au Théâtre du Rond-Point (2 bis, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris): la pièce Célébration d’Harold Pinter, montée par Roger Planchon. Avec Sabine Haudepin, Jean-Pol Dubois, Micha Lescot, Carlo Brandt, Hélène Babu, Roger Planchon, Eva Darlan, Thibault de Montalembert, Sophie Barjac, Jacques Frantz et Valérie Stroh.
Voir sur Revue 24 images, n° 93-94, Paris, 1998, pp. 70-74, un entretien avec Roger Planchon.
Voir aussi un entretien de Roger Planchon pour Lyon Capitale (2 février 2005).
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 03 mars 2005 à 14:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
02 mars 2005
Rilke, « Respirer, invisible poème ! »
« Respirer, invisible poème !
Continûment, purement, au prix
de l’être propre, espace inchangé. Contrebalance
au rythme de quoi proprement j’adviens.
Vague unique, dont
je suis à mesure la mer ;
de toutes les mers possibles, toi, la plus épargnante,
acquisition d’espaces.
Ces espaces, combien de leurs points étaient déjà
à l’intérieur de moi. Plus d’un vent
est comme mon fils.
Toi, me reconnais-tu, air, encor plein de lieux qui furent miens ?
Écorce lisse, toi, un jour,
voûte et feuillage de mes paroles. »
Rainer Maria Rilke, « Les Sonnets à Orphée, II, I », Œuvres poétiques et théâtrales, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 600.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 02 mars 2005 à 19:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
2 mars 1956/Proclamation de l’indépendance
du Maroc
À l’occasion de l’anniversaire de la proclamation d’indépendance du Maroc, le 2 mars 1956, j’ai choisi ce poème de la poétesse marocaine Touria [ou Touriya] Madjouline (une enseignante d’Oujda, née en 1960 à Settat), poème extrait d’une anthologie récemment parue aux éditions La Différence : La Poésie marocaine de l’Indépendance à nos jours.
Touria Madjouline sera présente le samedi 19 mars au Riad Denise-Masson de Marrakech, dans le cadre des Deuxièmes Rencontres Internationales de Poésie de Marrakech, qui se tiendront du 16 au 19 mars 2005. Voir le programme de cette rencontre dans l’hebdomadaire marocain La Nouvelle Tribune ou sur le site de L’Institut français de Marrakech.
Femme de roseau
« Il m’a abordée
avec cette arrogance dans les yeux
et m’a juré que j’étais
ce qu’il avait vu en premier dans l’univers
la dernière ombre où il avait trouvé refuge
puis il s’est abattu
cherchant dans mon rêve et ma réalité
un sauf-conduit
pour me détruire
La langue de l’écoute bâille dans ma voix
Comme si tu étais le vent habitant mes profondeurs
comme si j’étais l’arbre emporté par les soupirs
Et je me suis réveillée de toi
Laisse-moi prendre appui sur ma blessure
et m’en aller
Tu ne sais pas encore
que je ne suis plus simplement
l’un de ces signes féminins
ou n’importe quelle autre lettre tordue
C’est une femme de roseau
qui s’habille de tes yeux
de tes mains
et avale calmement tes paroles
Toi
tu prends ce que tu veux des jours
tu sèmes ce que bon te semble d’illusions
Elle
s’écroule à la fin de la nuit
comme l’herbe noire
essuie ses larmes et dort »
Touria Madjouline, Les Accablés (traduit de l’arabe) [Al-Joussour, Oujda, 2000], La Poésie marocaine de l’Indépendance à nos jours, anthologie, La Différence, 2005, p. 172.
Voir aussi Certitude de Widad Benmoussa. Widad [ou Ouidad] Benmoussa sera aux côtés de Touria Madjouline, le 19 mars, à 20h30, pour les Deuxièmes Rencontres Internationales de Poésie de Marrakech.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 02 mars 2005 à 08:38 | Lien permanent | Commentaires (6) | TrackBack
01 mars 2005
1er mars 1972/La Salamandre d’Alain Tanner
1er mars 1972 : La Salamandre d’Alain Tanner obtient le Grand Prix de la Confédération internationale des cinémas d’Art et d’Essai.
C’est aussi avec la projection du film La Salamandre qu’ont été inaugurées, le 27 octobre 1971, les salles du cinéma d’Art et d’Essai « Saint-André-des-Arts » (Paris).
Synopsis : Rosemonde, l’insaisissable Salamandre, gagne sa vie en faisant des « petits boulots ». Soupçonnée d'avoir tenté de tuer l’oncle qui l’héberge, elle fait la « une » des faits divers. Son histoire est confiée à un journaliste et à un écrivain. Pierre (Jean-Luc Bideau) et Paul (Jacques Denis). Chargés d'écrire le scénario d’un téléfilm. Mais la fantaisie de la Salamandre, son goût de vivre et sa définition de la vérité ne répondent en rien aux définitions et aux critères d’une société standardisée. Les investigations des deux jeunes gens n’aboutiront pas et leurs tentatives pour réaliser leur travail resteront lettre morte.
Bulle Ogier, actrice et comédienne égérie des années 1970, et interprète de La Salamandre, est récompensée par la Société des Auteurs de Films qui lui décerne le Prix d’interprétation Suzanne Bianchetti.

Bulle Ogier dans La Salamandre
Source
Voir la biographie et la filmographie de Bulle Ogier sur allocine.com.
Rédigé le 01 mars 2005 à 10:58 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack
1er mars 1853/Traduction du Corbeau par Baudelaire
1er mars 1853 : publication dans la revue L'Artiste de la traduction du Corbeau d'Edgar Allan Poe par Baudelaire.
Voir la biographie chronologique de Baudelaire sur litteratura.com.
Rédigé le 01 mars 2005 à 05:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
28 février 2005
Madame de Sévigné, « Ma bonne, votre commerce est divin »
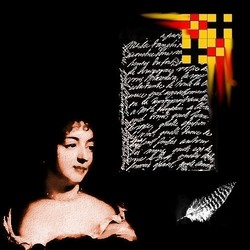
Madame de Sévigné
Image, G.AdC
À Madame de Grignan
À Paris, mercredi 7 août 1675
« Ma bonne, votre commerce est divin ; ce sont des conversations que nos lettres : je vous parle, et vous me répondez ; j’admire votre soin et votre exactitude ; mais, ma-très-chère, ne vous en faites pas une loi ; car si cela vous fait la moindre incommodité et le moindre mal de tête, croyez que c’est me plaire que de vous soulager ; et sans vouloir exagérer, votre intérêt, votre plaisir, votre santé, le soulagement de quelque chose qui vous peine, est au premier rang de ce qui me tient le plus au cœur […]. »
Madame de Sévigné, Lettres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, I, édition de Gérard Gailly, page 793.
Voir aussi :
- 6 février 1671
- 20 juillet 1694
- 17 avril 1696
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 28 février 2005 à 16:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
28 février 1912/Première exposition
de Marie Laurencin
28 février 1912, première exposition de Marie Laurencin, à Paris, galerie Barbazanges.
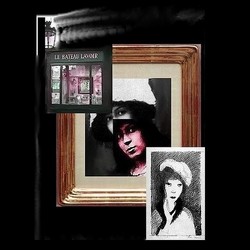
Marie Laurencin.
Image, G.AdC
Marie Laurencin, muse de Guillaume Apollinaire, a commencé de peindre dès 1902, bien avant sa rencontre avec le poète en 1907. Elle fréquente très tôt les habitués du Bateau-Lavoir. Peintres, poètes, critiques, amateurs d’art, marchands de tableaux. Parmi les plus célèbres d’entre eux, Vlaminck, Derain, Picasso, Braque, Matisse, Max Jacob, André Salmon, Gertrude et Léo Stein, Kahnweiler. Tous artistes d’avant-garde. Tout comme Guillaume Apollinaire dans le domaine de l’écriture. Un monde essentiellement masculin dans lequel Marie Laurencin parvient à trouver sa place. Et à charmer. Elle forme avec le poète d’Alcools, ardent défenseur de la peinture « cubiste » et de la « modernité », le couple légendaire du Montmartre d’avant-guerre.
La peinture de Marie Laurencin, toute de poésie et d’élégance vaporeuse, s’attache davantage à la nuance qu’à l’expression. Marie Laurencin consacre son art à exécuter les portraits de ceux qui l’entourent. Essentiellement ses amis, parmi lesquels figurent Sonia et Robert Delaunay.
À la mort de Guillaume Apollinaire, dont elle s’était séparée cette même année 1912, le chagrin de Marie Laurencin est immense. Le 8 juin 1956, elle meurt. Elle emporte dans sa tombe une lettre d’amour écrite par Guillaume Apollinaire : La Chanson du Mal-Aimé.
Sur le site officiel Guillaume Apollinaire, le poème « Marie », un chant d'amour et de douleur, écrit en 1912 (peu après la rupture avec Marie Laurencin) et dit par Apollinaire le 24 décembre 1913 ("Archives de la parole").
« Vous y dansiez petite fille
Y danserez-vous mère-grand
C'est la maclotte qui sautille
Toute les cloches sonneront
Quand donc reviendrez-vous Marie
Les masques sont silencieux
Et la musique est si lointaine
Qu'elle semble venir des cieux
Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine
Et mon mal est délicieux
Les brebis s'en vont dans la neige
Flocons de laine et ceux d'argent
Des soldats passent et que n'ai-je
Un cœur à moi ce cœur changeant
Changeant et puis encor que sais-je
Sais-je où s'en iront tes cheveux
Crépus comme mer qui moutonne
Sais-je où s'en iront tes cheveux
Et tes mains feuilles de l'automne
Que jonchent aussi nos aveux
Je passais au bord de la Seine
Un livre ancien sous le bras
Le fleuve est pareil à ma peine
Il s'écoule et ne tarit pas
Quand donc finira la semaine »
Guillaume Apollinaire, « Marie », Alcools, Gallimard, Collection Poésie, page 55.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 28 février 2005 à 00:29 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
27 février 2005
27 février 2005/ Ultime projection à la salle Chaillot de la Cinémathèque française
27 février 2005 : coup de blues pour les cinéphiles et les amateurs de salles de cinéma d’art et essai. Le lendemain, lundi 28 février, ferment définitivement la mythique salle de projection de la Cinémathèque française (installée depuis 1963 au Palais de Chaillot) en même temps que celle des Grands Boulevards. Les aficionados de la salle du Palais de Chaillot devront migrer, à l’automne, rue de Bercy, dans le nouveau bâtiment édifié par Frank Gehry, où seront sises les nouvelles salles. Pour signer l’événement, la salle de Chaillot projette ce dimanche soir 27 février son ultime film : Histoire (s) de Cinéma, de Jean-Luc Godard.
Dans ma mémoire, la Cinémathèque française, à laquelle j’étais abonnée, c’est le rituel de l'attente fiévreuse des week-ends parisiens où il m’arrivait parfois de voir trois films dans un même après-midi. L’attente de l’ouverture des grilles dans l’humidité grelottante et le froid. La sage queue au guichet. Cette atmosphère très intimiste, toute d’intériorité, de convivialité et de complicité silencieuse, et que « j’ai tant aimée » (bonsoir Ettore Scola !). Suivie de si grands moments d’émotion et de pure beauté. C’est beaucoup, en 2003, l’intégrale de la rétrospective de l’œuvre cinématographique de Pier Paolo Pasolini. Je revois encore les séquences de L’Évangile selon Saint Matthieu, tourné à Matera dans les Pouilles, avec, dans le rôle de la mère du Christ, la propre mère de Pier Paolo Pasolini. Bouleversant. Inoubliable.
Mais cette salle de la Cinémathèque, c’est bien évidemment d’abord le souvenir du personnage du créateur de la Cinémathèque française, Henri Langlois, limogé le 9 février 1968, et les manifestations qui ont suivi. C’est aussi la première scène d’Innocents de Bernardo Bertolucci et la harangue de Jean-Pierre Léaud sur la musique des Quatre cent coups de Truffaut, c’est encore le poème de Jacques Prévert « Mai 68 » chanté par Catherine Ribeiro dans le disque « Jacqueries ».
Cri du coeur des gardiens du musée homme usé
Cri du coeur à greffer
à rafistoler
Cri d'un coeur exténué
On ferme !
On ferme la Cinémathèque et la Sorbonne avec
On ferme !
On verrouille l'espoir
On cloître les idées
On ferme !
O.R.T.F. bouclée
Vérités séquestrées
Jeunesse bâillonnée
On ferme !
Et si la jeunesse ouvre la bouche
par la force des choses
par les forces de l'ordre
on la lui fait fermer
On ferme !
Mais la jeunesse à terre
matraquée piétinée
gazée et aveuglée
se relève pour forcer les grandes portes ouvertes
les portes d'un passé mensonger
périmé
On ouvre !
On ouvre sur la vie
la solidarité
et sur la liberté de la lucidité.
Jacques Prévert
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 27 février 2005 à 11:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
26 février 2005
26 février 1901/ Lettre de rupture de Lou Andreas-Salomé à Rilke
Schmargendorf, mardi 26 février 1901
« […] ta silhouette – encore si tendrement, si précisément consistante pour moi à Waltershausen – s’est perdue progressivement à mes yeux comme un petit détail dans l’ensemble d’un paysage – pareil aux vastes paysages de la Volga, et où la petite isba visible n’était plus la tienne.[…]
Correspondance R.M. Rilke/Lou Andreas-Salomé, Gallimard, Collection du Monde entier, 1979. Texte établi par Ernest Pfeiffer. Traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet.

Lou Andreas-Salomé.
Image, G.AdC
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 26 février 2005 à 02:17 | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack
25 février 2005
25 février 1983/Poème de Claude Roy à Jacques Roubaud
Va-et-vient
J’entends en moi ouvrir fermer claquer
des portes des bruits de pas dans un escalier
parler à voix basse dans un corridor
quelqu’un tousse puis étouffe sa toux
quelqu’un vient hésite s’arrête
fait demi-tour un long silence
On entend seulement une tuyauterie se plaindre
Puis de nouveau des pas On approche
Il y a quelqu’un derrière la porte
Quelqu’un retient son souffle puis respire à nouveau
J’entends de l’autre côté craquer le plancher
On frappe enfin Deux coups très nets
Je vais ouvrir Ce n’est que moi
Une fois encore quitte pour la peur
ou la déception J’attendais donc quelqu’un
Que je n’attendais pas ?
25 février 1983
Claude Roy, « Va-et-vient », L’Entre-deux. Hiver 1983 [1987], À la lisière du temps, Gallimard, Collection Poésie, 1990, page 84.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 25 février 2005 à 12:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
24 février 2005
Julia Kristeva/Au risque de la pensée
« L’être humain a besoin de contestation, de révolte. […] Cette révolte concerne notre appareil psychique, la vie psychique, le psychisme comme vie. Si l’enfant ne se révolte pas contre le père ou la mère, si l’adolescent ne crée pas quelque chose contre ses parents, contre l’école ou contre l’État, il est tout simplement mort. Il est sans possibilité d’innovation et de création, il devient un robot. »
Julia Kristeva, Au risque de la pensée, éditions de l’aube/France Culture, 2001, p. 39. Entretien avec Marie-Christine Navarro.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 24 février 2005 à 18:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
24 février 1979 /Création à l’Opéra de Paris de la version intégrale de Lulu
24 février 1979 : l’opéra Lulu du compositeur Alban Berg, opéra créé à Zurich en 1937, est repris dans sa version intégrale par l’Opéra de Paris. Dans une mise en scène de Patrice Chéreau et des décors de Richard Peduzzi. La direction musicale est assurée par Pierre Boulez et le rôle de Lulu est interprété par Teresa Stratas.
Lulu, héroïne de deux drames de Frank Wedekind (L’Esprit de la Terre, 1895 ; La Boite de Pandore, 1902), incarne au théâtre la première femme fatale, toute de sensualité, à qui aucun homme ne résiste. Ses conquêtes se soldent par des suicides et conduisent l’héroïne à la mort. Au cinéma, la figure féminine de Lulu a été immortalisée par le film de Georg Wilhelm Pabst (1928), le rôle de Lulu étant incarné par Louise Brooks.
Rédigé le 24 février 2005 à 10:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
23 février 2005
Rappelle-toi Barbara
Ce récit de Marie Ferranti s’ouvre sur un portrait. Le portrait de Barbara de Brandebourg, princesse de Mantoue. Un portrait réalisé en 1470 par le peintre Mantegna pour la « Camera depicta » (Chambre des époux), et qui n’est pas vraiment du goût de la princesse, alors âgée de cinquante ans. Un portrait sans concession qui révèle à Barbara tout ce que le peintre a saisi d’elle. Toutes les facettes d’un visage « aux yeux las et jaunes, étirés vers les tempes comme ceux des chats », et d’une âme dure. Implacable parfois.
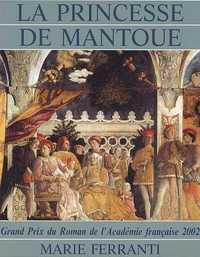
Ci-dessus, Mantegna, Cour de Ludovic Gonzague (1470),
fresque du mur nord de la Chambre des époux,
Mantoue, château de San Giorgio
(détail de la première de couverture de l'édition Feryane, 2003)
Il faut dire, pour sa défense, que la princesse mantouane n’a pas été épargnée. Elle est à peine âgée de dix ans qu’elle doit quitter son Allemagne natale pour rejoindre l’époux qui lui a été destiné. L’aîné des Gonzague, Louis. Fils de François et de Paola Malatesta, la bossue. À peine marié, le jeune garçon, malingre, chétif, pas davantage taillé pour la castagne que pour la noce (sa jeune épouse est encore impubère et le mariage n’est pas consommé), s’enfuit de Lombardie. Il rejoint en secret le duc de Milan auquel il fait allégeance, et fait à ses côtés ses armes. Pendant cette absence de sept ans, qui ne la taraude pas trop, Barbara grandit et reçoit l’éducation due à son rang. Une éducation soignée. Celle des lettrés de son temps, du temps du Rinascimento. Parallèlement, la jeune demoiselle entretient avec sa chère cousine, Maria de Hohenzollern, qui lui manque cruellement, une correspondance fiévreuse. Dans laquelle Barbara confie ses chagrins, ses déceptions, ses attentes. Et aussi ses joies. Correspondance à travers laquelle nous découvrons peu à peu la vie de Barbara.
Le temps passe …et la vie. Ludovic revient à Mantoue en vainqueur, rude gaillard, aguerri, sûr de lui. Méconnaissable. Avec son retour prend fin le temps de l’insouciance. Dans la nuit même, la jeune fille est prise par son époux. Bestialement. Il faudra bien qu’elle s’y fasse. La poésie courtoise dont elle est friande n’a rien de commun avec les mœurs maritales. Elle s’y fera. Elle est de bonne composition, la petite princesse. Une composition teutonne, malgré tout, qui lui est probablement d’un sérieux secours.
Le « roman de formation » de la jeune femme, car c’est bien de cela qu’il s’agit, ne s’arrête pas là. Les naissances se succèdent. Qui demandent à Barbara de s’initier à d’autres devoirs. Et puis, il y a la vie de cour, qui occupe espace et temps. Mantegna, désormais parfaitement intégré à la famille mantouane, est chargé par la princesse Barbara de réaliser les fresques de la future chambre dite « des époux » : la « Camera depicta ». Barbara continue de se livrer à son époux, à qui elle ne refuse rien … tout en lui prodiguant d’habiles conseils. Et de livrer ses confidences à sa cousine à qui elle écrit continûment. Elle ne se plaint pas de sa vie, riche en événements épicés qu’elle apprécie. Elle aime les siens, Ludovic compris. Mais elle déteste Paola, sa fille cadette, contrefaite et bossue, comme bon nombre de Malatesta. Un désamour dont la princesse affirme ne pas parvenir à s’expliquer les causes. L’enfant souffre du mépris cruel dans lequel la tient sa mère. Barbara reste sourde aux appels de sa fille et, pour s’en débarrasser, la marie au plus vite, peu après le décès de Louis, son époux. Sans festivité aucune dans Mantoue en deuil, Paola épouse le comte de Gorizia, de vingt ans son aîné. Une brute illettrée. Auquel Paola, férue de musique et tout imprégnée de la poésie de son cher Pétrarque, ne se résigne pas. Paola se meurt. Paola meurt. Du chagrin d’avoir perdu sa chère Mantoue. Et de n’avoir pas revu sa mère. Ni la fratrie à laquelle elle est restée très attachée.
Après la mort de Louis, Barbara devient aigrie, mauvaise, inflexible. Sa méchanceté la tue. Elle décline. Et s’enferme de longues heures durant dans la fameuse « camera depicta », achevée selon ses vœux. Sentant la mort la gagner, Barbara s’y fait transporter sur son lit d’apparat. La dernière vision qu’elle emporte avec elle est celle des angelots rieurs dont Mantegna a ceint l’oculus de la pièce. Une vision aérienne, céleste. Mâtinée de malice. Toute en trompe l’œil. Ainsi prend fin – du moins, presque fin - ce récit de vie. La vie bien remplie d’une femme toute en contrastes. Comme l’époque à laquelle elle appartient. Partagée entre résurgences de dureté médiévale et raffinements de cour. Une vie rude, dans laquelle pourtant les arts jouent un rôle majeur et contribuent à peaufiner et adoucir les rudesses masculines.
Il resterait sans doute beaucoup à dire sur ce récit bien mené. Précis en dates et riche en détails historiques. Écrit dans un style sobre et efficace. Celui d’une historienne qui veille à ne pas trahir la lettre et l’esprit des documents et des diverses correspondances sur lesquels elle s’appuie pour reconstituer la biographie de la princesse mantouane. Si j’osais, je dirais que le personnage de Barbara est attachant. Dans sa prime jeunesse surtout. Émouvante et tendre également, la relation épistolaire que Barbara entretient fidèlement avec sa cousine Maria de Hohenzollern. Qui mourra avant elle, sans qu’elles aient eu le loisir de se revoir. On pourrait reprocher à la princesse d’avoir fait endurer à sa fille Paola les insoutenables sévices qu’elle aurait pu elle-même subir si elle n’avait eu un caractère aussi trempé. Mais le plus surprenant, le plus inattendu ne réside pas là. Et ne peut se dire sans déflorer l’intrigue. Une intrigue qu’il faut se laisser à lire d’une traite. Du début jusqu’à la fin. D’une peinture à l’autre. Du portrait initial sur lequel s’ouvre le récit (portrait dans lequel Barbara se découvre avec lucidité, telle que l’a perçue et percée Mantegna) jusqu’à la fresque finale de la voûte. Dans laquelle Barbara, allongée sur son lit de mort, aspire à se fondre. Derniers échanges de regards. Avec les angelots rieurs et narquois qui bravent la mourante, puis chuchotent au-dessus du cadavre encore tiède. Du haut de l’oculus en trompe l’œil de la « Chambre des époux » décorée « a fresca » par Mantegna. Sans aucun doute le personnage-clé du récit de Marie Ferranti. Celui qui détient le maître-mot !
Marie Ferranti, La Princesse de Mantoue, Gallimard, Collection blanche, 2002, ISBN 2070766756; Collection Folio, 2004, ISBN 2070313875.
Texte©angèlepaoli
BIO-BIBLIOGRAPHIE
(d’après la notice bio-bibliographique de l’éditeur)
Marie Ferranti vit actuellement à Saint-Florent (Haute-Corse). Avant de se consacrer à la littérature, elle a enseigné comme professeur de lettres. Son premier roman, Les Femmes de San Stefano (1995), a été couronné par l'Académie Française. Elle est également l'auteur de La Chambre des défunts (1996), de La Fuite aux Agriates (2000), de La Chasse de nuit (2004) et d’un essai sur l'œuvre romanesque de Michel Mohrt : Le Paradoxe de l'ordre (2002). La Princesse de Mantoue (2002) a été couronné par le Grand Prix du Roman de l'Académie française.
Voir aussi les Portraits photographiques de Marie Ferranti sur le site d'Olivier Roller.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 23 février 2005 à 23:42 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
23 février 1903/Mort du Communard Jean-Baptiste Clément
Le 23 février 1903 : mort à Paris du poète révolutionnaire et chansonnier Jean-Baptiste Clément (né à Boulogne-sur-Seine le 31 mai 1836).
Jean-Baptiste Clément est l’auteur de la romance (et hymne) fétiche de la Commune de Paris : « Le temps des cerises » (musique d’Antoine Renard), écrite en 1866 et dédiée "à la vaillante citoyenne Louise, l'ambulancière de la rue Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871". Le 26 février, près de 5000 personnes accompagnent la dépouille de Jean-Baptiste Clément au Cimetière du Père-Lachaise. Il est inhumé face au Mur des Fédérés.
« Quand nous chanterons le temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête...
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux, du soleil au cœur!
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur! »
[...]
Pour écouter Le Temps des cerises, chanté par Yves Montand, cliquer ici.
Rédigé le 23 février 2005 à 11:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
22 février 2005
Drago Jancar/Le Christ est ressuscité
Par cette fiche de lecture, j’aimerais en tout premier lieu rendre un hommage particulier à deux femmes, Andrée Lück-Gaye et Zdenka Štimac, les deux traductrices qui ont le plus contribué à faire découvrir la littérature slovène aux lecteurs français, la première comme traductrice d’Aleš Debeljak, de Drago Jancar (Jančar),
On trouvera en fin de notule une bibliographie de Drago Jancar (Jančar)
Deuxième ouvrage de l’écrivain slovène Drago Jancar (Jančar)
Slovénie. 1er janvier 1938. Josef Erdman, citoyen autrichien et ingénieur, a passé la nuit de la Saint-Sylvestre dans le train. Il descend en gare de Maribor pour y chercher un hôtel. Sa première rencontre est celle d’une silhouette vacillante qui lance un cri halluciné dans la ville déserte et grise de neige : Hristos voskres. Le Christ est ressuscité. Erdman, plongé dans de titubantes pensées, poursuit son chemin vers son hôtel. Un hôtel miteux. Où il attend Jaroslav. Celui à qui il a fixé rendez-vous. L’homme d’affaires avec lequel il doit se rendre à Zagreb puis filer vers le sud. Commence alors pour Erdman une longue attente. Ponctuée de beuveries et de rencontres. Pour la plupart inquiétantes. Entouré de personnages douteux et peu engageants, Erdman se lie pourtant à Margerita, épouse de l’ingénieur Samsa. Dans cette ville étrange et inconfortable, Erdman profite de ses instants de liberté pour tenter de retrouver dans Maribor les images lointaines et mystérieuses d’une enfance perdue. Dont l’image de la "boule bleue" qui hante sa mémoire et guide ses errances dans les églises de la ville. Et la recherche de l’improbable statue qui continue, par-delà les années, de nourrir ses rêves. Ou encore la poursuite du jardinet aux "haricots", jadis cultivé par son père.
Par-delà ces échappées infructueuses, Erdman sent progressivement se refermer sur lui les rouages invisibles du piège qui le guette. Sommé par l’administration, puis par la police, de s’expliquer, au cours d’interminables interrogatoires, sur les raisons de son séjour dans la ville, sur ses fréquentations et sur l’objet de ses recherches, Erdman est confronté à l’absurdité redoutable d’un monde aux accents kafkaïens (le nom même de l’ingénieur Samsa est directement apparenté à celui de Grégoire Samsa, héros de La Métamorphose), dont il est le réceptacle. L’implacable machine répressive est en marche, contre laquelle l’individu, livré à lui-même, ne peut rien. Au dehors, dans la ville en effervescence, mouvements de foule, manifestations et meetings se multiplient, et leur spirale de révoltes et de répressions. Erdman, confronté à une attente sans issue en même temps qu’à sa propre déraison, ne peut échapper à la folie ordinaire des hommes.
La prophétie salvatrice sur laquelle s’ouvre le roman n’était que l’annonce de l’aurore boréale du 25 janvier 1938. Une aurore sanglante. Dans laquelle l’Europe est sur le point de sombrer. Une aurore boréale lourde de menaces, qu’obscurcit l’image satanique du mal. Dont Erdman, victime "choisie", endosse, à son corps défendant, la force symbolique.
"Bien des années plus tard, Erdman est assis à Lienz […]. Encore une fois, il raconte une longue et curieuse histoire que sa mère connaît et qu’elle aime écouter. En réalité, elle n’entend pas car elle est très vieille et dure d’oreille. Mais elle connaît par cœur l’histoire de son fils […]." (p. 292)
Texte©angèlepaoli
Drago Jancar (Jančar)
Titre original : Severni Sij. Traduit par Andrée Lück-Gaye. Sortie en librairie : février 2005 (office du 24 février).
Voir aussi la fiche que l'éditeur a consacrée à cet ouvrage.
BIOGRAPHIE DE DRAGO JANCAR [JANČAR]
Drago Jancar (écrire Jančar et prononcer Iantchar)
Après des études de droit, Drago Jancar a été tour à tour journaliste, éditeur et rédacteur en free lance. En 1985, il a séjourné aux Etats-Unis comme « Fulbright fellow », puis, en 1988, en Allemagne. Opposant farouche à toute forme de totalitarisme, il s'est personnellement engagé pour le rétablissement de la démocratie en Slovénie et en Yougoslavie (rappelons que sous le régime de Tito, il a été condamné à la prison pour « propagande en faveur de l'ennemi»).
Ses romans (Galiot, 1978; Severni Sij, 1984 ; Posmehljivo Poželenje, 1994; Zvenenje v Glavi, 1998), récits ou nouvelles ont été traduits dans la plupart des pays d'Europe et aux Etats-Unis. Ses pièces théâtrales, produites également à l'étranger, sont le plus souvent les têtes d'affiche des saisons théâtrales de son pays. En 1993, Drago Jancar a obtenu le prix Preseren, la distinction littéraire la plus prestigieuse de Slovénie. En 1994, il a reçu à Arnsberg (Allemagne) le Prix de la nouvelle européenne. Il vit actuellement à Ljubljana.
BIBLIOGRAPHIE DE DRAGO JANCAR [JANČAR]
ROMANS
GALJOT, roman, 1978.
- Galijot. Traduit par Marija Mitrović. Beograd, Narodna knjiga, 1980.
- Galernik. Traduit par Leonid Simonovič. Moscow, Raduga, 1982.
- Galiot. Traduit par Tome Arsovski. Skopje, Makedonska knjiga, 1984.
- Agályarab. Traduit par Orsolya Gállos. Budapest, Európa, 1985.
- Kaškjin. Traduit par Bekbolat Zdetov. Alma Ata, Žazuši, 1987.
- Galernik. Traduit par Joanna Pomorska. Warsaw, Państwowy Instytut Wydawnyczy, 1988.
- Galejník. Traduit par František Benhart. Prague, Odeon, 1990.
- Galernik. Traduit par Ivan Čarotji. Minsk, Mastackaja literatura, 1990.
- Der Galeot. Traduit par Klaus Detlef Olof. Klagenfurt–Salzburg, Wieser Verlag, 1991.
- De galeislaaf. Traduit par Roel Schuyt. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1995.
SEVERNI SIJ, roman, 1984.
- Polarna svjetlost. Traduit par Vlado Gotovac. Zagreb, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1987.
- Nordlicht. Traduit par Peter Wieser. Klagenfurt–Salzburg, Wieser Verlag, 1990.
- Severnoe sijanie. Traduit par Leonid Simonovič. Moscow, Raduga, 1990.
- Noorderlicht. Traduit par Roel Schuijt. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1994.
- Polárna žiara. Traduit par Anežka Kočalková. Bratislava, Kalligram, 2001.
- Northern Lights. Traduit par Michael Biggins. Evanston, Northwestern University Press, 2001.
-
POSMEHLJIVO POŽELENJE, roman, 1993.
- Luzifers Lächeln. Traduit par Klaus Detlef Olof. Klagenfurt–Salzburg, Wieser Verlag, 1995.
- Kajánvágyak. Traduit par Orsolja Gállos. Budapest, Osiris Kiadó , 1997.
- Drwiace ż adze. Traduit par Joanna Pomorska. Warsaw, Niezale ż na Oficyna Wydawnicza, 1997.
- Mocking Desire. Traduit par Michael Biggins. Evanston, Nortwestern University Press, 1998.
- Chtíč chtíc nechtíc. Traduit par František Benhart. Praga, Volvox Globator, 1999.
- El deseo burlón. Traduit par Marjeta Drobnič. Madrid, Metafora, 2002.
ZVENENJE V GLAVI, roman, 1998.
- Rauschen im Kopf. Traduit par Klaus Detlef Olof. Wien, Zsolnay Verlag, 1999.
- Zujanje u glavi. Traduit par Mirjana Hećimović. Zagreb, Durieux, 2000.
- Zájgas a fejben. Traduit par Orsolya Gállos. Pecs, Jelenkor Kiado, 2001.
- Rauschen im Kopf. Traduit par Klaus Detlef Olof. dtv München, 2003.
PIÈCES THEÂTRALES
DISIDENT ARNOŽ IN NJEGOVI, 1982.
- Disident Arnožinjegovi. Traduit par Gojko Janjušević. Novi Sad, Sterijino pozorje, 1982.
- Profesor Arnož a ti jeho. Traduit par František Benhart. Prague, Svetova literatura, 1986.
VELIKI BRILJANTNI VALČEK, 1985.
- Velky brilantni valčik. Traduit par František Benhart. Paris, 1988.
- A Nagy Brili á ns Valcer. Traduit par Gállos Orsolya. Budapest, Európa könyvkiadó, 1989.
ZALEZUJOČ GODOTA, 1988.
- Godot-ra-lesve. Traduit par Gallos Orsolya. Novi Sad, Hid, 1989.
- Špiclovani Godota. Traduit par František Benhart. Prague, Svet a divadlo, 1989.
- Stakeout at Godot’s. Traduit par Anne Čeh and Peter Perhonis. Washington D.C., SCENA Press, 1997.
RÉCITS ou NOUVELLES
- Snovi i nasilja. Traduit par Josip Osti. Sarajevo, Veselin Masleša, 1984.
- Der Sprung von der Liburnia. Traduit par Astrid Philippsen, Fabjan Hafner and Klaus Detlef Olof. Klagenfurt – Salzburg, Wieser Verlag, 1993.
- Pohled and ě la. Traduit par František Benhart. Prague, Volvox Globator, 1995.
- Avestina - Eine Legende. Traduit par Klaus Detlef Olof. Ottensheim an der Dona, Edition Thanh ä user, 1996.
- Skok s Liburnije. Traduit par Mirjana Hećimović. Zagreb, Durieux, 1996.
- Azangyal pillantasa. Traduit par Gallos Orsolya. Pecs, Jelenkor, 1997.
- Sonntag in Mitterau. Traduit par Klaus Detlef Olof. Ottensheim an der Donau, Edition Thannh ä user, 1997.
- Prikaza iz Rovenske. Traduit par Mirjana Hečimović. Zagreb, Durieux, 2002.
- L’Elève de Joyce. Traduit par Andrée Lück-Gaye. Paris, L’Esprit des péninsules, 2003.
ESSAIS
- Erinnerungen an Jugoslawien. Traduit par Horst Ogris and others. Klagenfurt, Verlag Hermagoras-Mohorjeva, 1991.
- Im Disput : Disput Adam Michnik/Drago Jančar. Traduit par Franci Zwitter jun. Klagenfurt-Salzburg, Wieser Verlag, 1992.
- Terra incognita. Traduit par Joanna Pomorska. Warsaw, Niezale ż na Oficyna Wydawnicza, 1993.
- Izvješće iz devete zemlje. Traduit par Branko Čegec. Zagreb, Durieux, 1993.
- Izbrojen, vagnut, razdijeljen. Traduit par Mirjana Hećimović. Zagreb, Durieux, 1996.
- Kurzer Bericht ü ber eine lange belagerte Stadt - Gerechtigkeit f ü r Sarajevo. Klagenfurt, Verlag Hermagoras, 1996.
- Krátkázprávaz dlouho obléhan é homěsta. Traduit par František Benhart. Prague, Votobia, 1997.
- Kratki izvještaj iz dugo opsjednutog grada. Traduit par Juraj Martinovič. Sarajevo, PEN Bosne in Hercegovine, 1999.
- Prodloužen á minulost. Traduit par František Benhart. Prague, Lidov é Noviny, 1998.
- Eseje. Traduit par František Benhart. Pogranicze, Sejny, 1999.
- Brioni. Traduit par Klaus Detlef Olof. Wien, Folio Verlag, 2002.
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE D’OUVRAGES DE LITTÉRATURE SLOVÈNE CONTEMPORAINE TRADUITS EN FRANÇAIS
PROSE
• Vladimir BARTOL (1903-1967)
- Alamut [1938]. Traduit par Claude Vincenot. Texte revu par Jean-Pierre Sicre. Phébus, collection Libretto, 2001.
• France BEVK (1890-1970) [L’écrivain France Bevk a été le vice-président de la République de Slovénie en 1947]
- La Langue intime. Traduit par Zdenka Štimac. Préface de Evgen Bavčar, Editions du Cerf, 1993 [ouvrage portant sur la question de l'interdiction de la langue slovène sous l'occupation italienne].
• Andrej BLATNIK (né en 1963 à Ljubljana)
- La Loi du désir, AlterEdit, Collection « Ailleurs est ici », 2005. Recueil de nouvelles traduit par Andrée Lück-Gaye.
• Branko HOFMAN (1929-1991)
- La Nuit jusqu’au matin, Phébus, 1998. Traduit par Alain Cappon. Ce roman, rédigé entre 1968 et 1974, n’a vu le jour qu’en 1981 et a été publié en France en 1998. Il est tenu pour un classique de la littérature de l’Est. Le sujet : une enquête policière dans un village de la Slovénie des années 1970. La version française n’a pas été traduite à partir de l’original en langue slovène, mais à partir du texte en serbo-croate. Le texte a cependant été établi du vivant de l’auteur et revu par ses soins. La bibliographie de Branko Hofman ne compte à ce jour que trois romans, beaucoup de ses écrits étant restés inédits.
• Dušan JOVANOVIĆ (né à Belgrade en 1939)
- La Libération de Skopje [OSVOBODITEV SKOPJA, pièce de théâtre, 1981].Traduit par Dušan Jovanović et Mireille Robin avec le concours de la Maison Antoine-Vitez. Préface de Dragan Klaic. [Dušan Jovanović est l’ancien directeur du Théâtre de la jeunesse de Ljubljana ; metteur en scène indépendant, il est aussi journaliste et professeur de théâtre et de cinéma à Ljubljana. La Libération de Skopje, qui l'a fait connaître dans le monde entier, a été lue en 2001 au Théâtre ouvert à Paris]. Editions L'Espace d'un Instant, 2003.
• Ciril KOSMAC
- La Ballade de trompette et du nuage (BALATA O TROBENTI IN OBLAKU). Traduit par Jean Durand-Monti, Aurillac, POF-Publications orientalistes de France, 1977 ; rééd. Paris, Le Serpent à Plumes, 1999.
- Une journée de printemps. Traduit par Jean Durand-Monti, Aurillac, POF-Publications orientalistes de France, 1982.
• Kajetan KOVIČ (né à Maribor en 1931)
- Le Professeur de rêve [PROFESOR DOMIŠLJIJE, roman, 1996]. Traduit par Jean-Charles Lombard. Charlieu, La Bartavelle Éditeur, 2000. Nouvelle édition, 2002.
• Florjan LIPUŠ (né en 1937, écrivain de langue slovène vivant en Autriche. Traduit en Allemagne par Peter Handke. Rédacteur en chef du magazine littéraire Mladje de 1960 à 1981; enseignant dans des écoles bilingues de Carinthie jusqu'à sa retraite en 1998).
-L'Élève Tjaz [ZMOTE DIJAKA TJAŽA, roman, 1972], d'après la version allemande de Peter Handke et H. Mracnikar. Traduit par Anne Gaudu, Gallimard, Collection blanche, 1987.
• Boris PAHOR
- Pèlerin parmi les ombres [1966], traduit du slovène par Andrée Lück-Gaye, La Table Ronde, Paris, 1971.[Né en 1913 à Trieste où il vit encore, Boris Pahor a mené toute sa carrière littéraire en langue slovène].
- Printemps difficile [premier volet de la Trilogie triestine, 1958], traduit du slovène par Andrée Lück-Gaye, Phébus, Paris, 1995.
- La Maison sur le Lac [1955], traduit de l’italien par Benito Merlino, Bartillat, Paris, 1998 [hélas traduit à partir de la version italienne et non pas à partir de la langue d’origine, le slovène][ouvrage emblématique de la déchirure italo-slovène].
- Arrêt sur le Ponte Vecchio, traduit du slovène par Andrée Lück-Gaye et Claude Vincenot, Editions des Syrtes, Paris, 1999.
- Jours obscurs [deuxième volet de la Trilogie triestine], traduit du slovène par Antonia Bernard, Phébus, Paris, 2001.
- La Porte dorée, traduit du slovène par Andrée Lück-Gaye, Editions du Rocher, Paris, 2002.
- Dans le Labyrinthe [volet trois de la Trilogie triestine], traduit du slovène par Antonia Bernard, Phébus, Paris, 2003.
• Alojz REBULA (né à Šempolaj, Italie, en 1924. A soutenu à l'Université de Rome une thèse de doctorat sur les différentes traductions de la Divine Comédie de Dante en langue slovène)
- Demain, le Jourdain (roman). Traduit par Zdenka Štimac. Paris, Editions du Cerf, 1997. Cet ouvrage n'est plus disponible actuellement chez l'éditeur.
• Brina SVIT (née à Ljubljana en 1954), écrivain de langue slovène vivant à Paris depuis 1980
- Con Brio [roman,1998], Traduit par Zdenka Štimac. Paris, Gallimard, 1999.
- Mort d'une prima donna slovène [SMRT SLOVENSKE PRIMADONE, roman, 2000]. Traduit par Zdenka Štimac. Paris, Gallimard, 2001.
- Moreno, Gallimard, 2003. Premier texte écrit en français.
• Ivan TAVČAR
- La Chronique de Vissoko. Traduit par Jean Durand-Monti. Aurillac, POF-Publications orientalistes de France, 1975 ; rééd. 2003.
POÉSIE
• Aleš DEBELJAK (né à Ljubljana en 1961. A déjà publié dans son pays six recueils de poésie et une dizaine d’essais. Une poésie empreinte de nostalgie et de mélancolie)
- Minutes de la peur [Minute strahu], recueil de poèmes). Traduit du slovène par Andrée Lück-Gaye. Préface de Yvan Mécif. Pézenas, éditions Domens, 2001.
• Janko MESSNER (né en 1921 en Autriche, en Carinthie du Sud [à Dob/Aich, près de Bleiburg/Pliberk] dans une famille de paysans de la minorité slovène), Poèmes, Strasbourg, bf éditions, 1999. Traduit du slovène par Vladimir Claude Fišera et Viktor Jesenik.
• Brane MOZETIČ (né en 1958 à Ljubljana : il a fait une partie de ses études supérieures à Paris).
- Obsession [Obsedenost], Paris, Aleph et Editions Geneviève Pastre, 1991.
- Obsession, édition enrichie. Recueil traduit par Mojca Medvedsek, William Cliff, Jean-Paul Daoust et autres, Trois Rivieres, Ecrits des Forges, 2002.
• Boris A. NOVAK (né en 1953. Poète et essayiste. Traducteur de Mallarmé, Valéry et Verlaine. Professeur de littérature comparée à l'université de Ljubljana. Il a publié plus de cinquante ouvrages. En 2001, il a publié en Slovénie une anthologie de la poésie française)
- La Poésie slovène (histoire littéraire). Traduit en français par l'auteur et Elza Jereb. In Poésie slovène contemporaine. Marseille, Editions Autres Temps, 1994.
- Poèmes choisis. Traduit par Viktor Jesenik avec la collaboration de Pierre-Yves Soucy. Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais, 1996.
• Tomaž ŠALAMUN (né à Zagreb en 1941. A publié plus de trente recueils de poésie en Slovénie)
- Poèmes choisis. Retour en Europe centrale. Paris, Publications de l'Unesco, 1995.
- Poèmes choisis. Traduit par Mireille Robin and Zdenka Štimac. Paris, Editions Est-Ouest Internationales, 1995, seconde édition 2001.
- Livre pour mon frère (poésie) [Knjiga za mojega brata]. Ouvrage bilingue. Traduit par Zdenka Štimac. Saint-Nazaire, M.E.E.T. [Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire], La collection des bilingues, 1999. Tomaž ŠALAMUN est avec Ales BERGER l'un des deux écrivains slovènes accueillis par la M.E.E.T. de Saint-Nazaire.
• Dane ZAJC (né en 1929)
- Le Chaton blanc. Traduit par F. Mirti. Paris, Hachette, 1971. Ouvrage non disponible.
- Des poèmes de Dane Zajc : « Le grand taureau noir », « Boule de cendre », « Asskalla », « Blanc » et « Scorpions » ont été publiés dans le n° 104 (février 2001) de la revue poétique Estuaire. Voir ci-dessous.
• COLLECTIF (Tomaž Šalamun, Jure Potokar, Brane Mozetič, Aleš Debeljak, Alojz Ihan, Uroš Zupan), Poésie slovène contemporaine. Marseille, Autres Temps Editions, Collection Temps-Poétique, 1994.
• N° SPECIAL «POÉSIE SLOVÈNE», Revue Estuaire n° 104 (février 2001), revue québécoise trimestrielle fondée en 1976 : C.P. 48774, Outremont (Québec) H2V 4V1 CANADA. Diffusion et distribution en France : Écrits des Forges, 6, rue Édouard Vaillant, 93500 Pantin. Téléphone: 01 49 42 99 11.
- Dane Zajc (« Le grand taureau noir », « Boule de cendre », « Asskalla », « Blanc », « Scorpions » );
- Veno Taufer (« Orphée », « Os cadavérique », « Mythes et écrits apocryphes des hommes des eaux », « L'eau a emporté » );
- Svetlana Makarovič (« Aujourd'hui », « La nuit de la Saint-Jean », « L'image », « sur l'autel », « La rose »);
- Tomaž Šalamun (« La frontière », « À Metka », « Cetinje », « Petit lapin Oaxaqueño », « Où êtes-vous, multitudes excitées » );
- Boris A. Novak (« Le phare tient la chandelle... », « Hiver », « Ultime nuit », « Frontières » );
- Brane Mozetič (« je ne sais pas résister... », « qu'est-ce qui t'attire ailleurs... », « les guérisseurs silencieux... », « tu es la petite pluie..., » « quand tu te lèves... » ).
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 22 février 2005 à 11:45 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
22 février 1944/Arrestation de Robert Desnos
Le 22 février 1944, le poète Robert Desnos est arrêté par la Gestapo. À Paris, rue des Saussaies, à 10 heures du matin.
D’abord incarcéré à la prison de Fresnes, Robert Desnos (de son vrai nom Pierre Aubier) est ensuite interné au camp de Royallieu (Compiègne) du 20 mars au 27 avril 1944. Le 30 avril 1944, il est acheminé à Auschwitz dans un convoi de 1700 hommes. Il est déporté successivement vers le camp de Buchenwald, puis vers celui de Flossenburg. Et enfin vers le Kommando de Flöha en Saxe où il travaille pour les usines Messerschmitt.
Au moment de la Libération, Robert Desnos est provisoirement transféré dans le camp de Theresienstadt (Térézin), en Tchécoslovaquie. Il meurt du typhus le 8 juin 1945.
« Vaincre le jour, vaincre la nuit,
Vaincre le temps qui colle à moi,
Tout ce silence, tout ce bruit,
Ma faim, mon destin, mon horrible froid.
Vaincre ce coeur, le mettre à nu,
Écraser ce corps plein de fables
Pour le plonger dans l'inconnu,
Dans l'insensible, dans l'impénétrable.
Briser enfin, jeter au noir
Des égouts ces vieilles idoles,
Convertir la haine en espoir,
En de saintes les mauvaises paroles.
Mais mon temps n'est-il pas perdu ?
Tu m'as pris tout le sang, Paris.
À ton cou je suis ce pendu,
Ce libertaire qui pleure et qui rit. »
Robert Desnos, « Ce cœur qui haïssait la guerre », Destinée arbitraire, Gallimard, Collection Poésie, 1975, page 235.
Pour en savoir plus sur Robert Desnos, lire la biographie que lui a consacrée la philosophe et historienne Dominique Desanti : Robert Desnos, le roman d'une vie (1900-1945), Mercure de France, 1999.
Voir aussi le site Robert Desnos.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 22 février 2005 à 09:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
21 février 2005
« Imperceptiblement le lichen tétanise l’espace »
« Le poids de notre existence creuse jusqu’à la fibre les chemins
que nous empruntons.
Au fond de la pierre, les racines du cœur.
Le chaos
La blessure
L’irréversible
La pluie est engourdie
Les mains s’arc-boutent aux palissades du froid
De la fronde des arbres s’échappent des oiseaux gris
Imperceptiblement le lichen tétanise l’espace. »
Annie Le Brun, Annulaire de lune, in Ombre pour ombre, Gallimard, Collection blanche, 2004, page 117.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 21 février 2005 à 14:57 | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack
21 février 1908/Ouverture d’un cinéma dans la salle du Cirque de Paris
1 février 1908 : la société Pathé ouvre à Paris (dans la salle du Cirque de Paris, ancien cirque Métropole, à l’angle de la rue Duvivier et de l’avenue de la Motte-Picquet, dans le XVe arrondissement) un cinématographe surnommé « le plus grand écran du monde ». Chacune des projections est accompagnée par un orchestre de soixante musiciens. Cinq jours plus tard sont projetés au Palace Theatre, à Londres, les premiers films en Kinemacolor. Le 28 février est créée à Neuilly la Société du film d'Art, qui entreprend l'édification d'un studio au 14 de la rue Chauveau. Ce même mois de février 1908 est projeté sur les écrans parisiens le film La Vestale du réalisateur français Albert Capellani (1874-1931).
Rédigé le 21 février 2005 à 10:11 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
Une vie de chèvre
« Ecco cosa faccio io : una vita da capra »
« J’ai une chèvre que j’emmène toujours avec moi : et ma vie, c’est exactement la sienne. Elle vient au fond de la vallée, elle remonte à midi, elle s’arrête avec moi au bord du fossé, et puis je l’emmène au canal et quand je vais dormir, il n’y a pas grande différence, parce qu’elle mange de l’herbe et moi de la chicorée et de la salade, et la seule différence c’est le pain. Et dans quelque temps, je ne pourrai même plus en manger… Comme moi… comme moi. Voilà la vie que je mène : une vie de chèvre. Une vie de chèvre et rien d’autre. »
Silvio D’Arzo, Maison des autres, Rivages poche/Bibliothèque étrangère, pp. 74-75. Préface d'Attilio Bertolucci. Traduction de Bernard Simeone.
Pour en savoir plus sur Silvio D’Arzo et sur Casa d'altri, se reporter à la biographie et la fiche-livre des Editions Verdier, et au très beau commentaire de Didier A. Hénique sur le blog Périples.
Retour à l'index de la catégorie Péninsule (littérature italienne et anthologie poétique)
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 21 février 2005 à 00:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
20 février 2005
20 février 2003/Mort de Maurice Blanchot
20 février 2003 : mort de Maurice Blanchot.
« Que Maurice Blanchot vers qui va notre pensée n'y voie pas », s'il l'entend, « une atteinte à sa volonté maintes fois exprimée d'effacement […], mais le témoignage de notre reconnaissance pour le don incommensurable qu'il nous a fait : celui de son œuvre tout entière et, non moins généreusement, celui de sa présence amicale, une présence toujours si proche en son retrait et qui a le sens d'une veille. »
Louis-René des Forêts, « Hommage à Maurice Blanchot à l'occasion de ses 90 ans, » Maison des écrivains, Paris, 22 septembre 1997.
« Quand la parole emprunte à l'oracle sa voix où ne parle rien d'actuel, mais qui force celui qui l'écoute à s'arracher à son présent pour en venir à lui-même comme à ce qui n'est pas encore, cette parole est souvent intolérante, d'une violence hautaine qui, dans sa rigueur et par sa sentence indiscutable, nous enlève à nous-mêmes en nous ignorant. […]
C'est la chance du poème que de pouvoir échapper à l'intolérance prophétique, et c'est cette chance qu'avec une pureté dont nous nous rendons mal compte, l'œuvre de René Char nous offre, elle qui nous parle de si loin, mais avec une intime compréhension qui nous le rend si proche, - qui a la force de l'impersonnel, mais c'est à la fidélité d'un destin propre qu'elle nous appelle, œuvre tendue mais patiente, orageuse et plane, énergique, concentrant en elle, dans la brièveté explosive de l'instant, une puissance d'image et d'affirmation qui « pulvérise » le poème et pourtant gardant la lenteur, la continuité et l'entente de l'ininterrompu.
D'où vient cela ? C'est qu'elle dit le commencement, mais par la longue, patiente, silencieuse approche de l'origine et dans la vie profonde du tout, en donnant accueil au tout. »
Maurice Blanchot, « La Bête de Lascaux, » Une voix venue d'ailleurs, Gallimard, Folio Essais, 2002, pages 62-63.
A écouter, sur le site de France Culture, une série d'émissions autour de la mort de Maurice Blanchot.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 20 février 2005 à 11:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
19 février 2005
Catherine Pozzi/Nyx
« Ô vous mes nuits, ô noires attendues
Ô pays fier, ô secrets obstinés
Ô longs regards, ô foudroyantes nues
Ô vol permis outre les cieux fermés.
Ô grand désir, ô surprise épandue
Ô beau parcours de l’esprit enchanté
Ô pire mal, ô grâce descendue
Ô porte ouverte où nul n’avait passé
Je ne sais pas pourquoi je meurs et noie
Avant d’entrer à l’éternel séjour.
Je ne sais pas de qui je suis la proie.
Je ne sais pas de qui je suis l’amour. »
Catherine Pozzi, Très haut amour, Gallimard, Collection Poésie, 2002, page 31.
Ce poème écrit « d’un trait » (comme le souligne Catherine Pozzi dans son Journal, éditions Phébus libretto, 2005, page 699) est le dernier texte qu’elle a composé (5 novembre 1934). Un mois avant sa mort (3 décembre 1934, à l’âge de cinquante-deux ans), six ans après sa rupture avec Paul Valéry. Ce poème est directement inspiré du sonnet II de Louise Labé : « Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés […] Ô noires nuits vainement attendues […] ». Le caractère autobiographique du poème « Nyx » (« nuit » en grec) est pour partie attesté par la dédicace elle-même (Catherine Pozzi étant née Catherine-Marthe-Louise Pozzi).
Pour en savoir plus sur Catherine Pozzi, voir le site de l'association Esprits nomades.
Voir encore un très émouvant commentaire (à propos du Journal de Catherine Pozzi) sur le blog Quitter la terre.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 19 février 2005 à 22:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
19 février 1988/Mort de René Char
19 février 1988 : mort à Paris de René Char.
Post-merci
« Nous sommes des météores à gueule de planète. Notre ciel est une veille, notre course une chasse, et notre gibier est une goutte de clarté.
Ensemble nous remettrons la Nuit sur ses rails ; et nous irons, tour à tour nous détestant et nous aimant, jusqu’aux étoiles de l’aurore.
J’ai cherché dans mon encre ce qui ne pouvait être quêté : la tache pure au-delà de l’écriture souillée.
En poésie, devenir c’est réconcilier. Le poète ne dit pas la vérité ; il la vit ; et la vivant, il devient mensonger. Paradoxe des Muses : justesse du poème.
Dans le tissu du poème doit se retrouver un nombre égal de tunnels dérobés, de chambres d’harmonie, en même temps que d’éléments futurs, de havres au soleil, de pistes captieuses et d’existants s’entr’appelant. Le poète est le passeur de tout cela qui forme un ordre. Et un ordre insurgé. »
René Char, IV. À une sérénité crispée, Œuvres complètes, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, pages 759-760.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 19 février 2005 à 01:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
18 février 2005
18 février 2001/Mort de Balthus
18 février 2001 : mort de Balthus au Grand Chalet de Rossinière (Suisse).
Voir l'éphéméride culturel du 15 février 1961.
Rédigé le 18 février 2005 à 09:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
17 février 2005
Nathalie Sarraute/ Portrait d’un inconnu
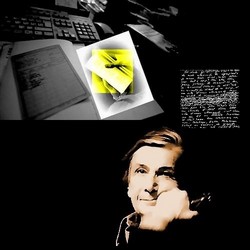
Nathalie Sarraute
Image, G.AdC
« Cette fois, comme cela m’arrive presque toujours quand c’est allé un peu trop loin, j’ai eu l’impression « d’avoir touché le fond » - c’est une expression dont je me sers assez souvent, j’en ai ainsi un certain nombre, des points de repère comme en ont tous ceux qui errent comme moi, craintifs, dans la pénombre de ce qu’on nomme poétiquement « le paysage intérieur » - « j’ai touché le fond », cela m’apaise toujours un peu sur le moment, me force à me redresser, il me semble toujours, quand je me suis dit cela, que maintenant je repousse des deux pieds avec ce qui me reste de forces et remonte… »
Nathalie Sarraute, Portrait d’un inconnu, Gallimard [1956], Collection Folio, 1985, page 26.
Voir aussi : 17 février 1986
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 17 février 2005 à 13:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
17 février 1986/Création de Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute
17 février 1986 : création au théâtre du Rond-Point-Renaud-Barrault, à Paris, de Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, dans une mise en scène de Simone Benmussa. Avec Sami Frey et Jean-François Balmer. Cette pièce a été publiée chez Gallimard en 1982.
« C’est bien...ça! ».
« Oh pardon, je ne l’ai pas prononcé comme il le fallait : " C’est biiiien… ça… " »
Le même mois de février 1986 sort en librairie Paul Valéry et l’Enfant d’Éléphant de Nathalie Sarraute.
Voir le site de Francis Drapeau.
Rédigé le 17 février 2005 à 01:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
17 février 1967/Ouverture de l’exposition Toutankhamon
17 février 1967 : ouverture de l’exposition « Toutankhamon et son temps », qui se tiendra au Petit Palais, à Paris, jusqu’au mois de juillet. Les recettes de cette exposition serviront à la sauvegarde des monuments de l’ancienne Nubie (temples d’Abou Simbel).
Rédigé le 17 février 2005 à 01:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
16 février 2005
Ligne de mire
« D’une lettre jetée sur la table s’échappe une ligne qui court sur la veine d’une planche et descend le long d’un pied. Si l’on regarde attentivement, on s’aperçoit qu’à terre la ligne suit les lames du parquet, remonte le long du mur, entre dans une gravure de Boucher, dessine l’épaule d’une femme allongée sur un divan et enfin s’échappe de la pièce par le toit pour redescendre dans la rue par le câble du paratonnerre. Là il est difficile de la suivre à cause du trafic mais si l’on s’en donne la peine, on la verra remonter sur la roue d’un autobus arrêté qui va au port… Elle monte sur le bateau aux sonores turbines, glisse sur les planches du pont de première classe, franchit avec difficulté la grande écoutille et, dans une cabine où un homme triste boit du cognac, elle remonte la couture de son pantalon, gagne son pull-over, se glisse jusqu’au coude et, dans un dernier effort, se blottit dans la paume de sa main droite qui juste à cet instant saisit un revolver. »
Julio Cortazar, Cronopes et fameux, Gallimard, Collection du Monde entier, 1977, pp. 114-115.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 16 février 2005 à 20:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
16 février 1988/Mort de Charles Delaunay
16 février 1988 : mort à Chantilly du fondateur de la revue Jazz Hot : Charles Delaunay, fils des peintres Robert et Sonia Delaunay. Fondée en mars 1935, la revue Jazz Hot a été animée par une équipe de collaborateurs comprenant Hugues Panassié et Boris Vian. Elle est la doyenne des revues de jazz.
Rédigé le 16 février 2005 à 02:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
15 février 2005
15 février 1961/Balthus, directeur de la Villa Médicis à Rome
Le 15 février 1961, Balthasar Klosssowski de Rola (Balthus) est nommé directeur de la Villa Médicis à Rome, en remplacement de Jacques Ibert. Balthus meurt quarante ans plus tard, le 18 février 2001, au Grand Chalet de Rossinière.
Venise, novembre 2001, rétrospective Balthus au Palazzo Grassi :
Rien de plus explicitement suggestif que les scènes d’intérieur de Balthus. Rien de moins érotiquement éloquent que ces pucelles aux jupes troussées ! Abandonnées à leurs rêveries envoûtantes ! Que ces femmes nubiles aux regards perdus et aux seins négligemment dénudés ! Que ces duos d’enfants impubères livrés à leurs jeux pervers! Balthazar Klossowski de Rola ! Voilà bien à mes yeux l’un des peintres les plus troublants de la peinture contemporaine! Encore bien souvent voué aux gémonies, tout comme le sont d’ailleurs les ouvrages de son frère Pierre Klossowski, dont Roberte ce soir. Même si la rétrospective du Palazzo Grassi consacrée à Balthus était paradoxalement « bon teint ».
Je me souviens, lors de la visite de cette exposition vénitienne, avoir été viscéralement bouleversée par une incontrôlable émotion ! Mais éclairée en moi-même et sur moi-même, comme par le faisceau imprévu d’une lumière fulgurante, jaillissant dans les méandres obscurs de mes labyrinthes intérieurs. Particulièrement devant La Leçon de guitare ! Une révélation sur le moment aveuglante comme toutes les transgressions mises en pleine lumière par « la fonction exorcisante du simulacre » (plus fascinante encore – dans l’acception de Quignard - que les fresques de la Villa des Mystères de Pompéi). Une scène de gynécée qui traite (sourdement) des rituels initiatiques qui, dans la tradition d’Éleusis, accompagnent les jeux de totémisation de l’enfance. Loin, vraiment très loin, de l’ellipse, on est là en plein coeur du fantasme et des hiérogamies secrètes. Toutes choses qui me tiennent particulièrement à cœur, et comme en suspens au-dessus de l’abîme.
Texte©angèlepaoli
Voir aussi :
- une galerie Web de trente toiles de Balthus.
- Le Rêve de Balthus de Nathalie Rheims.
Rédigé le 15 février 2005 à 01:04 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
14 février 2005
René Char/Souvent Isabelle d’Égypte
« Ton partir est un secret. Ne le divulgue pas. Durant
que roule le gai tonneau du vent, chante-le.
Affronte Estropios tant qu’il sue.
Fine pluie mouche l’escargot.
La source a rendu l’ajonc défensif en le tenant éloigné
du jonc. Ne fais pas le fier, rapproche le premier du second.
Lit le matin affermit tes desseins. Lit le soir cajole ton espoir, s’il fuit.
Ne brode pas dans le brouillard.
L’angle de l’oreiller se moque de la tête.
Compte huit bracelets à l’araignée, et une calotte en or. »
René Char, Chants de la Balandrane (1975-1977), La Flûte et le Billot I. Œuvres complètes, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1983, page 551.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 14 février 2005 à 02:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
14 février 1907/Sarah Bernhardt professeur au Conservatoire
14 février 1907 : Sarah Bernhardt « la divine » est nommée professeur au Conservatoire national de musique et de déclamation. Elle est la première femme à occuper une chaire au Conservatoire.
Rédigé le 14 février 2005 à 01:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
13 février 2005
Claude Louis-Combet/« J’écris du désir comme du désert »
« J’écris du désir comme du désert : où l’on s’enfonce sans avancer, où l’on contourne sans approcher, où l’espace vous traverse sans que vous puissiez le retenir, où le temps se précipite en vous qui vous précipitez sans lui - et claquent ces lambeaux de néant que sont les mots, dont la trace s’efface et dont le bruit s’éteint. La page est tournée contre le sol et rien n’a été conquis. »
Claude Louis-Combet, « Vacuoles », Le Petit Œuvre poétique, José Corti, 1998, page 2.
Voir aussi :
- Celle par qui la ténèbre arrive.
- Hiérophanie du sexe de la femme.
- Mala Lucina;
- Noyau central
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 13 février 2005 à 08:00 | Lien permanent | Commentaires (5) | TrackBack
13 février 1966/Mort de Marguerite Long
13 février 1966 : mort à Paris de la pianiste française Marguerite Long.
« Une prêtresse, une servante du dieu. Et c'est sous ce signe que je la salue » (Jean Cocteau).

CD audio Cascavelle (13 octobre 2003)
ASIN : B0000DBKH6
Rédigé le 13 février 2005 à 01:33 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack
12 février 2005
12 février 1947/Dior lance la collection « New Look »
12 février 1947 : le jeune couturier Christian Dior lance sa première collection, « la Ligne Carolle », très vite baptisée collection « New Look » par les magazines de mode américains.
« Nous sortions d'une époque de guerre, d'uniformes, de femmes soldats aux carrures de boxers, je dessinais des femmes fleurs, épaules douces, bustes épanouis, tailles fines comme lianes et jupes en corolles. » (Christian Dior)
Rédigé le 12 février 2005 à 01:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
Victor Hugo/En bateau à vapeur sur les bords de Somme
Arras, 13 août 1837, 6 heures du soir
Lettre de Victor Hugo à Adèle
« […] Hier matin, j’ai suivi en bateau à vapeur les bords de Somme d’Amiens à Abbeville. Au moment où je m’embarquais, le soleil se levait dans une brume épaisse au milieu de laquelle se détachait la silhouette immense de la cathédrale, sans aucun détail dans la masse, par le profil seulement. C’était superbe.
Rien de plus joli que les bords de la Somme. Ce n’est qu’arbres, prés, herbages, et villages charmants. Mes yeux ont pris là un bain de verdure. Rien de grand, rien de sévère ; mais une multitude de petits tableaux flamands qui se suivent et se ressemblent ; l’eau coulant à rase-bord entre les deux berges de roseaux et de fleurs, des îles exquises, la rivière gracieusement tordue au milieu d’elles, et partout de petites prairies heureuses à herbe épaisse avec de belles vaches pensives sur lesquelles un chaud rayon de soleil tombe entre les grands peupliers. De temps en temps on s’arrête aux écluses ; et, pendant que ce petit travail se fait, la machine à vapeur geint comme une bête fatiguée.
On côtoie ainsi Picquigny qui a un beau clocher et le grand château presque royal à façade de brique et de pierre qui appartient à M.de Boubers. Il y a aussi à droite en descendant, dans une île, des ruines qui m’ont paru remarquables, quoique ruinées un peu trop bas pour le voyageur qui passe en bateau derrière les hautes herbes. Ces herbes et ces roseaux, du reste, font un effet charmant. Quand le sillage du bateau vient les secouer en touchant le bord, elles se mettent à saluer les passants de la façon la plus gracieuse du monde et le plus empressée. J’ai revu Abbeville avec grand plaisir ; et à quatre heures je suis partie pour Doullens où j’arrivais à neuf heures du soir.
Une belle surprise pour qui ne connaît pas bien cette route c’est Saint-Riquier, merveilleuse abbaye du quinzième siècle, presque en ruine, qui vous apparaît tout à coup à trois lieues d’Abbeville. J’ai mis pied à terre, bien entendu, et j’ai passé une heure à tourner dans les nefs, autour des statues qui sont très nombreuses et la plupart admirables. Quelques-unes sont encore peintes de leur enluminure du seizième siècle. Dans la chapelle de la Vierge, il y a une Maris Stella sculptée en console que j’aurais voulu pouvoir dessiner. […] La Vierge dans une étoile, les autres astres à l’entour, le vaisseau brisé, la mer furieuse, le port dans le fond, tout cela est ravissant. […] »
Victor Hugo, Récits et dessins de voyage, La Renaissance du Livre, 2002, pp. 32-35.
N.B. On peut lire d'autres extraits (choisis par Jean Estienne) de l'excursion qu'a faite Victor Hugo (aux côtés de Juliette Drouet) en Baie de Somme (d'Ault au Crotoy) dans Balade dans la Somme. Sur les pas des écrivains (pp. 47-49). Un ouvrage publié en 2003 par les éditions Alexandrines.
Voir aussi Colette au Crotoy
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 12 février 2005 à 01:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
12 février 1965/Rétrospective Henri Michaux
Du 12 février au 4 avril 1965, rétrospective Henri Michaux au Musée national d’Art moderne à Paris.
Le livre est d’âme

Le livre est d'âme. D.R. MCS
« Les choses sont une façade, une croûte. Dieu seul est. Mais dans les livres, il y a quelque chose de divin.
Le monde est mystère, les choses évidentes sont mystère, les pierres et les végétaux. Mais dans les livres peut-être y a-t-il une explication, une clef.
Les choses sont dures, la matière, les gens, les gens sont durs, et inamovibles.
Le livre est souple, il est dégagé. Il n’est pas une croûte. Il émane. Le plus sale, le plus épais émane. Il est pur. Il est d’âme. Il est divin. De plus il s’abandonne. »
Henri Michaux, « Le Portrait de A. » in Difficultés (1930), Lointain intérieur, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1998, page 610.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 12 février 2005 à 01:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
11 février 2005
Colette au Crotoy
Controsole. Plage du Crotoy. Janvier 2005.
Cinq étés de suite, à compter de 1906, Colette séjourne au Crotoy dans la villa Belle Plage que loue son amie Missy : Sophie-Mathilde-Adèle de Morny, marquise de Belbeuf, fille du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III. C'est avec Missy avec que Colette vit le plus clair de son temps de 1906 (année de sa séparation définitive d’avec Willy) à 1911 (année où elle devient propriétaire de la maison de Rozven [en Bretagne] que lui a offerte Missy, et se lie à Henry de Jouvenel qu’elle a rencontré en décembre 1910 au journal Le Matin, et qu’elle épousera en décembre 1912).
C’est au Crotoy (1907-1908) qu’elle écrit plusieurs chapitres (« En baie de Somme », « Partie de pêche », dédiée à son ami Léon Hamel) et met au net le manuscrit des Vrilles de la vigne, qui paraissent en novembre 1908 sous la signature de Colette Willy dans La Vie parisienne. C’est aussi au Crotoy (1909) qu’elle commence à écrire La Vagabonde.
Le 3 janvier 1907 a lieu la création (houleuse) au Moulin Rouge de Rêve d’Égypte (une pantomime de Georges Wague, Emile Vuillermoz et Willy) où jouent Colette et son amie Missy. Le 15 février 1907, Colette signe son premier vrai contrat d’auteur avec Alfred Vallette, directeur du Mercure de France pour La Retraite sentimentale (publication le 23 février). L’été 1907, Willy et sa maîtresse Meg Villars (Marguerite Magniez, qu’il épousera en 1911) sont également installés au Crotoy, mais dans la villa voisine de celle de Missy.
« Ce doux pays, plat et blond, serait-il moins simple que je l’ai cru d’abord ? J’y découvre des mœurs bizarres : on y pêche en voiture, on y chasse en bateau […] Étrange, pour qui ignore que le gibier s’aventure au-dessus de la baie et la traverse, du Hourdel au Crotoy, du Crotoy à Saint-Valery ; étrange, pour qui n’a pas grimpé dans une de ces carrioles à larges roues, qui mènent les pêcheurs tout le long des vingt-cinq kilomètres de la plage, à la rencontre de la mer…
[…] le soleil peut se coucher tranquillement au-delà de la baie de Somme, désert humide et plat où la mer, en se retirant, a laissé des lacs oblongs, des flaques rondes, des canaux vermeils où baignent les rayons horizontaux… La dune est mauve, avec une rare chevelure d’herbe bleuâtre, des oasis de liserons délicats dont le vent déchire, dès leur éclosion, la jupe-parapluie veinée de rose…
Les chardons de sable, en tôle azurée, se mêlent à l’arrête-bœuf, qui pique d’une épine si courte qu’on ne se méfie pas de lui. Flore pauvre et dure, qui ne se fane guère et brave le vent et la vague salée […]
Pourtant, çà et là, verdit la criste-marine, grasse, juteuse, acidulée, chair vive et tendre de ces dunes pâles comme la neige…[…]
La baie de Somme, humide encore, mire sombrement un ciel égyptien, framboise, turquoise et cendre verte. La mer est partie si loin qu’elle ne reviendra peut-être plus jamais ? Si, elle reviendra, traîtresse et furtive comme je la connais ici. On ne pense jamais à elle. On lit sur le sable, on joue, on dort, face au ciel, jusqu’au moment où une langue froide, insinuée entre vos orteils, vous arrache un cri nerveux : la mer est là, toute plate, elle a couvert ses vingt kilomètres de plage avec une vitesse silencieuse de serpent. Avant qu’on l’ait prévue, elle a mouillé le livre, noirci la jupe blanche, noyé le jeu de croquet et le tennis. Cinq minutes encore, et là voilà qui bat le mur de la terrasse, d’un flac-flac doux et rapide, d’un mouvement soumis et content de chienne qui remue la queue…
Un oiseau noir jaillit du couchant, flèche lancée par le soleil qui meurt. Il passe au dessus de ma tête avec un crissement de soie tendue et se change, contre l’est obscur, en goéland de neige… »
Colette, « En baie de Somme », « Partie de pêche », Les Vrilles de la vigne, Romans, récits, souvenirs (1900-1919), Robert Laffont, Collection « Bouquins », I, pp. 673-674.
Voir aussi le Portrait de Colette.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 11 février 2005 à 19:06 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack
11 février 1948/Mort du cinéaste Sergueï Eisenstein
Mort à Moscou du réalisateur soviétique Sergueï M. Eisenstein (Сергей Михайлович Эйзенштейн)
FILMOGRAPHIE
1923 : Le Journal de Gloumov;
1924 : La Grève ;
1925 : Le Cuirassé Potemkine ;
1927 : Octobre ;
1929 : La Ligne Générale / l'Ancien et le Nouveau ;
1930 : Romance sentimentale (documentaire coréalisé avec Gregori Alexandrov);
1935-1937 : Le Pré de Bejine ;
1938 : Alexandre Nevski ;
1944 : Ivan le Terrible (premier épisode) ;
1945 : Ivan le Terrible (2e épisode ; inachevé) ;
1931/1979 : Que viva Mexico !, film réalisé par Gregori Alexandrov en 1979, d'après le scénario d'Eisenstein et les images tournées par Édouard Tissé en 1931.
Rédigé le 11 février 2005 à 06:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
10 février 2005
Trois grains d’ellébore, ma commère !
Constipés chroniques, s’abstenir ! On pourrait croire que cet ouvrage est une invite à s’adonner continûment à la lecture dans les lieux d’aisance, les «waterres » comme le dit Miller à la française. Une presque injonction. Ou au contraire une considération drapée, toute de mépris elliptique, qui pourrait détourner de cet opuscule certaines âmes trop prudes. Il n’en est pas tout à fait ainsi. Lire aux cabinets est d’abord une démarche introspective. Une interrogation de l’auteur sur l’incapacité où il est de mener, de front et de concert, deux fonctions contraires, exigeant toutes deux et concomitamment une concentration active. Ingestion et évacuation.
À partir de considérations personnelles, l’auteur élargit son champ d’investigation, s’interrogeant sur les mœurs des mères de famille en la matière. Mieux encore, sur les mères des grands hommes : « Les mères de nos grands hommes pratiquaient-elles la lecture au cabinet ? » Il est vrai qu’on nous tient, sur cette question plus que fondamentale, dans la plus grande et totale ignorance. Le ton devient plus impatient et plus cruel lorsque l’auteur s’adresse à son épouse dont les stations prolongées aux cabinets l’intriguent. « Peut-être est-elle en train de lire la Bible ! Elle y est depuis assez longtemps pour avoir lu tout le Deutéronome. » Peu importe d’ailleurs ce qu’elle lit, même s’il s’avère que ce qui l’absorbe à ce point, ce sont Les Mémoires du maréchal Joffre ! Ce qui importe, ce sont les envies de meurtre qui s’emparent de l’époux indisposé par ce qu’il imagine être des alibis pour échapper aux tâches domestiques ! Et l’auteur de faire la plonge en concoctant quelques stratégies, d’ailleurs paradoxales. Et de proposer à son épouse la lecture de livres particulièrement « absorbants », dont l’on peut se demander s’ils sont constrictifs, émollients ou purgatifs : La Phénoménologie de l’esprit de Hegel, par exemple.
L’auteur s’insurge contre toutes les formes modernes de boulimie qui impliquent le remplissage excessif, la rentabilisation forcenée, la rétention obligatoire. Et invite plutôt à « se laisser aller » ! Et à garder esprit et intestins aussi ouverts que possible ! Et s’il faut à tout prix faire quelque chose au cabinet, en dehors de ce qui est incontournable pour tout un chacun, mieux vaut adresser une prière de remerciements au Créateur, inventeur de ce système d’évacuation, plutôt que de s’adonner, en ce lieu-là, à la lecture des grands classiques ! Dont il n’est pas sûr que les auteurs seraient ravis de se voir ainsi associés aux fonctions de défécation, aussi parfaites soit-elles !
Une réflexion nourrie et drôle que celle d’Henry Miller ! Sans cesse prise dans une vrille ascendante. Qui associe avec bonheur sérieux et humour. Un vrai régal philosophique ! Je le redis encore : constipés chroniques, s’abstenir absolument !
Henry Miller, Lire aux cabinets, Editions Allia, 2000.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 10 février 2005 à 07:30 | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack
10 février 1953/Lancement du Livre de Poche
10 février 1953 : lancement des trois premiers titres de la collection « Le Livre de Poche » :
1 : Kœnigsmark de Pierre Benoit ;
2 : Les Clés du Royaume de A.J. Cronin ;
3 : Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry.
Rédigé le 10 février 2005 à 01:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
09 février 2005
Diotime
Tout inspire et tout m’inspire dans ce récit d’Henry Bauchau. La mosaïque choisie par la collection Babel pour la première de couverture : un tapis de pierres provenant du péristyle d’un palais des empereurs de Byzance. « C’est l’heure où les lions vont boire ». Le titre éponyme du récit : résonances lointaines, enfouies derrière de multiples strates de mémoire. Mais qui est donc cette Diotime ? Quel lien fusionnel entretient-elle avec les lions ?
Superbe comme la mosaïque qui se déploie sous nos yeux, le récit délivre un à un ses secrets. Diotime nous enlève jusqu’aux temps solennels et antiques qui sont les siens. Ceux des grands de la Perse. Cambyse qui aime d’amour fou cette jeune amazone, sa petite fille. Kyros, son père, qui tient la fillette en haute et tendre estime. Caractère indomptable que cette Diotime ! Le sang perse de ses ancêtres lions coule dans ses veines fougueuses. Elle n’a de cesse que de voir se réaliser son rêve: s’affronter enfin aux grands fauves, participer au sacrifice de leur sang, se repaître de leur sève. Afin d’inaugurer à elle seule une voie nouvelle, dans ce rituel ancestral qui exclut toute femme. Pour cela, il lui faut braver les interdits, tenir en laisse son désir pour Arsès. Remettre à plus tard ses noces. Il faut à Diotime rencontrer le Grand Ancêtre. Et il faut aux amants le temps de s’imprégner de la sagesse orientale du vieillard-enfant. S’imprégner du Tao. Le vieillard-enfant, un être mystérieux qui les conduit au pas lent de son buffle noir dans une cérémoniale marche initiatique. Jusqu’à l’étreinte létale du vieillard-Enfant avec le Grand Lion ancestral.
Henry Bauchau, Diotime et les lions, Actes Sud, Collection Babel, 1999.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 09 février 2005 à 08:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
9 février 1981/Mort de Bill Haley
9 février 1981 : mort à Harlingen (Texas) du chanteur et guitariste américain Bill Haley. Le 12 avril 1954, il avait enregistré pour la firme Decca (avec His Comets) Rock around the Clock (vendu à 45 millions d’exemplaires). Pour écouter les premières mesures, cliquer sur ce lien.
Rédigé le 09 février 2005 à 01:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
08 février 2005
Les couloirs de la mort
Pour le lecteur qui n’aurait pas le palais sucré, ce titre pourrait être dissuasif. Pourtant, par sa concision et par son étrange balancement, le titre, encore plus suave en anglais (« sweet and secret »), invite à dépasser ce goût de bonbon à la fraise qui emplit la bouche. Très vite, dès les premières pages, fond l’idée même de sucre candi qui roule sous la langue et crisse sous les dents. Le goût de sucre d’orge se change en goût de sperme et de sang. Le titre du roman surgit brutalement au cœur de l’intrigue et saisit le lecteur à la gorge et à l’estomac : « sexe et secret » (titre initial du roman, comme Paule Constant a eu l’occasion de le dire sur les ondes). Ce sont là les deux maîtres mots du récit, les deux ingrédients véritables autour desquels se construit ce roman magistral, écrit et composé à partir de faits authentiques : la condamnation à mort, aux États-Unis, d’un jeune homme accusé d’avoir violé, tué Candice, son amie, et d’avoir commis sur sa personne des actes de barbarie. Pour la narratrice, convaincue de l’innocence de celui qui va être exécuté, après dix ans d’incarcération, David Dennis a été l’objet d’une machination. Elle va tenter d’en dénouer les rouages et d’en révéler le secret.
Mené avec maestria, ce récit, qui milite en faveur de l’abolition de la peine de mort, dénonce également les complots et les enjeux de pouvoir des autorités, universitaires et magistrats de l’État de Virginie, qui ont intérêt à étouffer la vérité de cette sordide affaire. Autant dire que le combat, engagé par l’écriture de ce roman et par sa publication, se poursuit. Mieux, il commence.
Paule Constant, Sucre et secret, Gallimard, Collection blanche, 2003.
Texte©angèlepaoli
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 08 février 2005 à 12:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
8 février 1828/naissance de Jules Verne
8 février 1828 : naissance de Jules Verne.
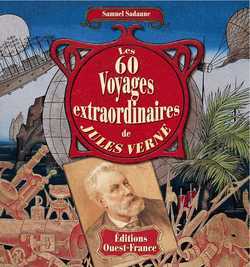
Samuel Sadaune, Les 60 Voyages extraordinaires de Jules Verne,
ouvrage récemment publié par les éditions Ouest-France.
Ci-après un article transmis ce jour, en exclusivité pour Terres de femmes, par Y.T., mon compagnon et le webmaestru de ce site :
Comme le souligne Jean-Paul Dekiss, le directeur du Centre international Jules-Verne à Amiens, « l’œuvre de Jules Verne est accompagnée d’un parfum d’actualité indéfinissable ». Une phrase fort à propos à l’approche du 100e anniversaire de la mort de l’écrivain, né à Nantes le 8 février 1828 et décédé à Amiens le 24 mars 1905 dans sa petite maison du boulevard de Longueville qui borde la voie ferrée. Précisément, alors que chacun s’apprête à fêter en grande pompe l’événement, la SNCF se veut visionnaire puisqu’elle mettra en place une gigantesque passerelle entre Amiens et Nantes grâce à la mise en circulation d’un TGV Jules-Verne qui unira Bretagne et Picardie pour des échanges high speed à 300 km/h.
Le pass Jules-Verne 2005
Tous les « Verniens », qui n’ont prévu de se rendre ni à Bergen (Norvège) ni à Miami où, dans le courant de l'année 2005, sera présentée alternativement une partie des collections Jules-Verne de la ville d’Amiens (plus de 30 000 pièces réunies dont le gigantesque fonds – récemment acquis – du collectionneur italien Piero Gondolo della Riva), peuvent acheter, depuis le 1er janvier dernier, le « pass Jules-Verne 2005 ». Il leur ouvrira, tout au long de l’année, les horizons lointains des Voyages extraordinaires, ainsi que toutes les portes des expositions et des spectacles consacrés à cet auteur inventif, tant à Amiens qu’à Nantes. L’offre est alléchante : du Nautisphère de « L’Imaginaire Jules-Verne » d’Amiens qui permettra d’explorer virtuellement « en 3 D relief » le monde envoûtant de l’écrivain (aux commandes du ballon dirigeable, du Nautilus… ou encore de la maison à vapeur) jusqu’à la visite du sultan des Indes sur son éléphant à voyager dans le temps... avec Royal de Luxe. Savez-vous ce que les plus avisés ont déjà noté dans leur agenda ? Le Tour musical en 80 minutes, une création conjointe des Conservatoires de Nantes et d’Amiens.
Mondes connus et inconnus
Que tous les explorateurs verniens qui veulent sortir des sentiers battus sachent enfin que la bibliothèque municipale de Nantes ─ qui possède 98 manuscrits (romans, pièces de théâtre, nouvelles, correspondances, etc.), dont ceux de L'Île mystérieuse, De la Terre à la Lune et Autour de la Lune ─ s’est associée à l’éditeur Actes Sud pour rééditer, à l’occasion de cette commémoration, des titres méconnus et des chefs-d’œuvre un peu oubliés de l’écrivain. Ils sont réunis dans une collection intitulée « Les Mondes connus et inconnus », clin d’œil au sous-titre donné par l’éditeur Hetzel aux Voyages extraordinaires.
Cette collection, coordonnée par le Nantais Olivier Sauzereau, est constituée de neuf ouvrages de format 22 x 28 cm, d’environ 250/300 pages.
Quelques pistes de lecture
Ci-dessous, les neuf ouvrages parus ou à paraître chez Actes sud / Bibliothèque municipale de Nantes :
Parus en novembre 2004 chez Actes Sud Junior :
• Le Sphinx des glaces, illustrations de Miles Hyman, préface de Christine Janin.
• Mirifiques Aventures de Maître Antifer, illustrations de Emre Orhum, préface d’Éric Gavoty de la Fondation Bélem.
• Le Chancellor, illustrations de Ludovic Debeurme, préface d’Étienne Klein.
• Voyage au centre de la Terre, illustrations de Jong Romano, préface de Henri Bauchau.
À paraître en mars 2005 chez Actes Sud :
• L’Île mystérieuse, préface de Jean Chesneaux.
• Les Aventures du capitaine Hatteras, préface de Olivier Sauzereau.
• Un capitaine de quinze ans, préface d’Agnès Marcetteau-Paul.
• Sans dessus dessous, préface de Dominique Bromberger.
• Le Monde illustré de Jules Verne, un album de gravures des Voyages extraordinaires, signées Riou, Ferat, de Neuville, Bayard, Roux et Benett. En collaboration avec Reporters sans frontières.
Les deux ouvrages incontournables :
• Jean-Paul Dekiss, Jules Verne l’Enchanteur, Ėditions du Félin, 2002 ; édition revue, 2004 .
Le roman philosophique de l’œuvre et du destin du plus populaire des auteurs français. Un bouillonnement d’idées. LA référence sur Jules Verne.
• Jean-Paul Dekiss, Jules Verne, Le rêve du progrès, Gallimard, Collection « Découvertes Littératures », 1991 ; nouvelle édition 2001.
Le petit frère du précédent ouvrage dans un mini-album.
• Voir aussi le Hors-Série du magazine Géo paru en novembre 2003 : Jules Verne, l’Odyssée de la Terre, qui comprend un témoignage magnifique de J.M.G. Le Clézio sur ses premières émotions de lecture à travers l’œuvre de Jules Verne.
Le Centre international Jules-Verne à Amiens
Le Centre international Jules-Verne (CIJV) est une association fondée en 1973. Elle a pour vocation de mettre à la disposition des chercheurs le fonds documentaire de l’œuvre de Jules Verne (Les Voyages extraordinaires en 62 romans et 18 nouvelles), mais aussi de restituer et de diffuser cette œuvre auprès du public. Avec la collaboration et le soutien des institutions, des pouvoirs publics et des entreprises.
Le fonds documentaire du centre est une véritable mine pour les Verniens, puisqu’il comprend une collection de 30 000 documents originaux et de 20 000 fiches, le tout étant conservé par les bibliothèques d’Amiens Métropole.
Pour l’année Jules Verne 2005, le CIJV a mis sur pied un programme de réhabilitation de la Maison de Jules Verne à Amiens. Le Centre s’est aussi vu confier un espace d’exposition, « L’Imaginaire Jules-Verne », qui a pris place dans un ancien cinéma en plein centre-ville. Jusqu’à la fin de l’année 2006, cet espace a été choisi comme lieu-test pour un avant-projet de centre littéraire entièrement dédié à des activités culturelles, éducatives et touristiques en étroite parenté avec l’univers et l’esprit des Voyages extraordinaires.
Voir aussi :
- le site du Centre International Jules-Verne.
- le Portail Jules Verne
- le site officiel du centenaire Amiens-Nantes Jules Verne 2005.
Texte©YT
Rédigé le 08 février 2005 à 02:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
8 février 1977/Carolyn Carlson crée This au Théâtre de la Ville
8 février 1977 : la chorégraphe Carolyn Carlson, qui, en 1975, a été chargée par Rolf Liebermann de diriger le GRTOP (Groupe de recherches théâtrales de l’Opéra de Paris), crée This au Théâtre de la Ville. Le 15 février a lieu la création de That et, en avril, de The Other.
This, That et The Other font partie des très nombreuses créations de Carolyn Carlson pendant la période 1975-1980. Parmi lesquelles X Land (1975), Trio, Wind, Water, Sand (1976) ; The Year of the Horse (1978) ; Writing in the Wall (1979) et Slow, Heavy and Blue (1980).
Rédigé le 08 février 2005 à 01:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
07 février 2005
7 février 1915/Giuseppe Ungaretti
7 février 1915 : publication dans la revue Lacerba des deux premiers poèmes de Giuseppe Ungaretti. Écrits à Milan en 1914/1915, ils ouvriront le recueil L’Allégresse des naufrages (1914-1919, Vallecchi, Florence, 1919), titre primitif du recueil L’Allégresse. Avant d’être intégrés sous le titre Ultime dans Vita d’un uomo (Mondadori, 1969).
Eterno
« Tra un fiore colto e l’altro donato
l’inesprimibile nulla »
Noia
« Anche questa notte passerà
Questa solitudine in giro
titubante ombra dei fili tranviari
sull'umido asfalto
Guardo le teste dei brumisti
nel mezzo sonno
tentennare »
Giuseppe Ungaretti, Ultime, Vita d’un uomo, Tutte le poesie, Mondadori, 1969.
Toujours
« D’une fleur cueillie à l’autre offerte
l’inexprimable rien »
Ennui
« Cette nuit elle aussi passera
Cette solitude tout autour
ombre titubante des fils de tramways
sur l’asphalte humide
Je regarde les têtes des cochers
qui dans le demi-sommeil
vacillent »
Giuseppe Ungaretti, Fin du premier temps (Milan, 1914-1915), in L’Allégresse, Vie d’un homme, Éditions de Minuit-Gallimard, Collection Poésie, 1981, pages 19 et 20.
Voir aussi la bio-bibliographie de Giuseppe Ungaretti.
Pour voir et entendre Giuseppe Ungaretti lisant à voix haute « Per sempre » (« Pour toujours »), écrit le 24 mai 1959 à Rome (Vie d'un homme, id, p. 293), se rendre sur le site de la RAI.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 07 février 2005 à 18:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
7 février 1927/naissance de Juliette Gréco
7 février 1927 : naissance (à Montpellier, Hérault) de Juliette Gréco.
Le 4 juin 1950, Juliette Gréco remporte le Grand Prix de la Sacem pour son interprétation de « Je hais les dimanches » (paroles de Charles Aznavour; musique de Florence Véran).
« Tous les jours de la semaine
Sont vides et sonnent le creux
Bien pire que la semaine
Y a le dimanche prétentieux
Qui veut paraître rose
Et jouer les généreux
Le dimanche qui s'impose
Comme un jour bienheureux
Je hais les dimanches!
Je hais les dimanches!
Dans la rue y a la foule
Des millions de passants
Cette foule qui coule
D'un air indifférent
Cette foule qui marche
Comme à un enterrement
L'enterrement d'un dimanche
Qui est mort depuis longtemps
Je hais les dimanches!
Je hais les dimanches!
Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi
C'est peut-être pour ça que je suis de parti pris
Chéri, si simplement tu étais près de moi
Je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas […] »
Rédigé le 07 février 2005 à 08:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
06 février 2005
6 février 1671/Madame de Sévigné
6 février 1671, Lettre adressée par Madame de Sévigné (le lendemain de ses quarante-cinq ans) à Françoise de Grignan, sa fille.
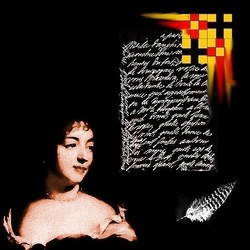
Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné.
Image, G.AdC
« Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Je ne l’entreprendrai pas aussi. J’ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus, et tous les pas qu’elle fait l’éloignent de moi. Je m’en allai donc à Sainte-Marie, toujours pleurant et toujours mourant : il me semblait qu’on m’arrachait le cœur et l’âme ; et en effet quelle rude séparation ! Je demandai la liberté d’être seule. […]. J’y passai cinq ou six heures sans cesser de sangloter : toutes mes pensées me faisaient mourir… ».
Madame de Sévigné, Lettres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome I, 1963, page 189.
Ci-dessous, un commentaire de Marie-Magdeleine Lessana :
« Le départ de Mme de Grignan laisse sa mère effondrée, meurtrie. La douleur aiguë, sauvage, que ressent Mme de Sévigné s’exprime continûment pendant les mois qui suivent cet événement capital. C’est un arrachement vécu dans le corps ».
Marie-Magdeleine Lessana, Entre mère et fille : un ravage, Hachette Littérature, Collection Pluriel, 2002, page 43.
Voir aussi :
- 7 août 1675
- 20 juillet 1694
- 17 avril 1696
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 06 février 2005 à 20:47 | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack
05 février 2005
5 février 1937/Mort de Lou Andreas-Salomé
5 février 1937, mort de Lou Andreas-Salomé à Göttingen.
À Rainer Maria Rilke :
« Je fus ta femme pendant des années, parce que tu fus la première réalité, où l’homme et le corps sont indiscernables l’un de l’autre, fait incontestable de vie même […]. Nous étions frère et sœur, mais comme dans ce passé lointain, avant même que le mariage entre frère et sœur ne devienne sacrilège. »
Lou Andreas-Salomé, Ma Vie, Presses Universitaires de France, Collection Quadrige, 1977; rééd. 2001.
« La pluie de ses doigts frais
s’empare de la fenêtre et nous l’aveugle ;
nous sommes assis dans les fauteuils profonds,
nous écoutons la douce heure crépusculaire
ruisseler de meules lasses.
Puis Lou parle. Et nos âmes
s’inclinent. Même le bouquet
à la fenêtre salue de ses hautes tiges,
et nous nous sentons tous chez nous
dans cette douce maison blanche. »
Rainer Maria Rilke, Pour te fêter, Œuvres poétiques et théâtrales, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1997, page 638.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 05 février 2005 à 12:28 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
5 février 1919/Fondation de The United Artists
5 février 1919 : quatre des plus grandes « stars d’Hollywood » (Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks et David Wark Griffith) fondent la firme de production cinématographique et de diffusion The United Artists Corporation (Les Artistes Associés). C’est dans cette firme que seront produits tous les films de Chaplin, depuis L’Opinion publique (1923) jusqu’à Un roi à New York (1957).
Rédigé le 05 février 2005 à 11:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
04 février 2005
4 février 1969/Récital de Barbara à l'Olympia
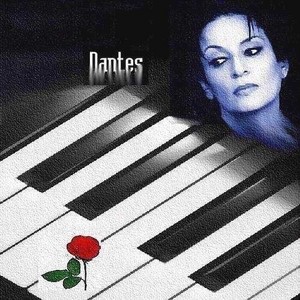
Portrait de Barbara.
Image, G.AdC
« À l'heure de sa dernière heure
Après bien des années d'errance
Il me revenait en plein coeur
Son cri déchirait le silence
Depuis qu'il s'en était allé
Longtemps je l'avais espéré
Ce vagabond, ce disparu
Voilà qu'il m'était revenu »
Barbara, « Nantes ». [extrait sonore : format Windows Media Player]

Barbara, Il était un piano noir : Mémoires interrompus,
Fayard, 1998. ISBN : 2213602743
Le 4 février 1969, Barbara entame un récital à l'Olympia pour deux semaines (jusqu’au 17 février). Elle est accompagnée par Roland Romanelli à l'accordéon, Michel Gaudry à la contrebasse, Michel Portal au saxophone, Michel Sanvoisin à la flûte à bec. Elle interprète trente chansons dont quinze nouveaux titres, extraits de l'album Le soleil noir, paru l’année précédente.
En première partie du récital, Barbara interprète des chansons du répertoire « début-de-siècle » : « Sur la place », « La complainte des filles de joie », « Veuve de guerre », « Les amis de Monsieur », « Elle vendait des petits gâteaux », « Le grand frisé ».
Dans la deuxième partie, elle interprète ses propres compositions, Georges Moustaki la rejoignant chaque soir sur scène pour chanter en duo « La dame brune ».
Parmi ses chansons : « Gare de Lyon », « Gueule de nuit », « Au bois de Saint-Amand », « L'amoureuse », « La solitude », « Göttingen », « Le soleil noir », « Pierre », « Mes hommes », « Nantes », « Une petite cantate », « Ce matin-là ».
De ce récital à l’Olympia, un double album 33 tours sera réalisé, qui sortira le 11 mars 1969.
Ci-dessous « Göttingen » :
« Bien sûr, ce n'est pas la Seine,
Ce n'est pas le bois de Vincennes,
Mais c'est bien joli, tout de même,
A Göttingen, à Göttingen,
Pas de quais et pas de rengaines,
Qui se lamentent et qui se traînent,
Mais l'amour y fleurit quand même,
A Göttingen, à Göttingen,
Ils savent mieux que nous, je pense,
L'histoire de nos rois de France,
Hermann, Peter, Helga et Hans,
A Göttingen,
Et que personne ne s'offense,
Mais les contes de notre enfance,
« Il était une fois », commencent,
A Göttingen
Bien sûr, nous, nous avons la Seine,
Et puis notre bois de Vincennes,
Mais, Dieu, que les roses sont belles,
A Göttingen, à Göttingen,
Nous, nous avons nos matins blêmes,
Et l'âme grise de Verlaine,
Eux, c'est la mélancolie même,
A Göttingen, à Göttingen,
Quand ils ne savent rien nous dire,
Ils restent là, à nous sourire,
Mais nous les comprenons quand même,
Les enfants blonds de Göttingen,
Et tant pis pour ceux qui s'étonnent,
Et que les autres me pardonnent,
Mais les enfants, ce sont les mêmes,
A Paris ou à Göttingen,
O, faites que jamais ne revienne,
Le temps du sang et de la haine,
Car il y a des gens que j'aime,
A Göttingen, à Göttingen,
Et lorsque sonnerait l'alarme,
S'il fallait reprendre les armes,
Mon coeur verserait une larme,
Pour Göttingen, pour Göttingen... »
Paroles et musique de Barbara.
Rédigé le 04 février 2005 à 23:35 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
Christine Bonduelle/ambivalences
les voix
à s’attendre
de chaque côté
du mur
de pierres
à tâton
perceuses
de jour
en trouées
étirant l’œil
à l’intérieur.
Christine Bonduelle, « Conversations », Bouche entre deux, Obsidiane, collection « Le legs prosodique », 2003, pp. 9 et 11.
regard d’eau
tenue secrète
en sous-bois
ronceux
toucheur d’âme
qui vive
lointaine
est-ce toi
ou rien
n’y a-t-il
rien que cris
sans voix ?
Christine Bonduelle, « Agapê », Bouche entre deux, id., page 28.
Ce recueil poétique est le premier ouvrage publié de Christine Bonduelle. Seuls quelques poèmes sont déjà parus dans Le Petit Digital illustré et la revue de poésie Le Mâche Laurier. « Dans la tradition du dix-septième siècle, les deux premières parties de Bouche entre deux se présentent comme un manuel moderne sur la conversation. Conversations dresse l’inventaire de ses nombreuses facettes, tandis qu’Agapê retrace une expérience de dialogue quasi silencieux. Le souci de se former à l’art de la conversation va de pair ici avec une extrême concision. [...] Imprégnés d'une forte tension entre rigueur formelle et hardiesse de ton, ces textes courts s'entrechoquent et dégagent une grande énergie poétique. » (Quatrième de couverture du recueil).
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 04 février 2005 à 22:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
4 février 1944/création d’Antigone d’Anouilh
Le 4 février 1944, création au théâtre de l’Atelier d’Antigone de Jean Anouilh. Dans une mise en scène et des décors d’André Barsacq. Avec Monelle Valentin dans le rôle d’Antigone et Jean Davy dans le rôle de Créon. Ainsi que Suzanne Flon, André Le Gall, Auguste Boverio, Beauchamp, Odette Talazac, Rambauville, Mathos et Sylver.
« CRÉON : - […] Crois-tu […] qu’on a le temps de faire le raffiné, de savoir s’il faut dire « oui » ou « non », de se demander s’il ne faudra pas payer trop cher un jour et si on pourra encore être un homme après ? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas, sur le premier qui s'avance. Dans le tas ! Cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous ; le vent qui vous gifle, et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom, cramponné à la barre. Il n'y a plus que le bateau qui ait un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends cela ?
ANTIGONE : - Je ne veux pas comprendre. C’est bon pour vous. Moi je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. »
Jean Anouilh, Antigone, Éditions de La Table Ronde, 1945.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 04 février 2005 à 17:59 | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack
03 février 2005
« Mes êtres d’incandescence »
Pour Adeline
« Ça commence par le secret gardé, par la séparation silencieuse du reste du monde. On s’aime. On passe dans la clandestinité. On quitte le monde en plein jour. »
Hélène Cixous (L’Amour du loup, chapitre I, « Sacrifices », page 19)
En feuilletant mes carnets, je retrouve cette prise de notes (un extrait de l'ouvrage de Cixous) qui date du premier jour des vacances de février 2004. Je lis ceci :
« Il y avait eu les bombardements d’Oran, les bombardements de guerre, avec bombes, descentes aux abris, sirènes d’alerte, l’espace devient extrêmement vertical, la vie est une corde tendue entre deux non-extrémités entre en haut et sous la terre, entre horreur et jubilation […] Il y a eu le bombardement de Salszbourg, un autre encore. Un autre encore. Une succession de bombardements […]
Nous sommes nés pour être bombardés et pour voir soudain les lieux familiers et les choses ordinaires devenus nus et spectaculaires. Alors le dehors gagne le dedans et le dedans s’étale impudiquement sans qu’on y puisse rien. C’est comme ce phénomène mathématique appelé Bouteilles de Klein une chose inconcevable et pourtant qui existe, un volume dont le dehors est dedans […]
Dès qu’on commence à raconter, il y a comme un apaisement des Mânes. Mais pendant quarante ans il y a impossibilité de tout récit. Quarante ans : toujours quarante ans de désert de mutisme. L’évanouissement dure quarante ans. Ensuite la mémoire reprend. Pendant l’évanouissement reste un monde, une population non racontée, bien cachée, tapie dans les replis, dans l’escalier, des larves de jeunes condamnés à mort, qui reviennent sitôt morts qui nous assiègent et que nous assiégeons.
La Fin n’est pas la fin. Pas plus que le commencement ne commence. »
Extrait de Hélène Cixous, La Mort du loup et autres remords, II « Le livre personnage du livre », « La Chose », éditions Galilée, 2003, pp. 115-116.
Voir aussi mon point de vue sur l'ouvrage :
« Petites érinyes de la conscience »
Rédigé le 03 février 2005 à 19:47 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
Andrée Chedid, Épreuves du langage
« Ainsi chemine
le langage
de terre en terre
de voix en voix
Ainsi nous devance
le poème
plus tenace que la soif
plus affranchi que le vent ! »
Reims, décembre 1999
Andrée Chedid, « Épreuves du langage », États provisoires du poème II, La Comédie de Reims et Cheyne Éditeur, 2000, page 13.
Voir aussi : le Portrait d'Andrée Chedid sur Terres de femmes.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 03 février 2005 à 14:25 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
3 février 1923/ La Vagabonde
3 février 1923 : création au théâtre de la Renaissance (à Paris), de La Vagabonde de Colette. Dans une adaptation théâtrale de Colette elle-même et de Léopold Marchand. La mise en scène de cette comédie en quatre actes est de Jacques Baumer. Parmi la distribution : Harry Baur, Jacques Baumer et Madeleine Guitry. L'adaptation paraîtra au mois d'août 1923 dans La Petite Illustration, puis chez Flammarion en 1924. C'est aussi en 1923 (juillet) que sort en librairie Le Blé en herbe.
« Peur de vieillir, d’être trahie, de souffrir… Un choix subtil a guidé ma sincérité partielle, pendant que j’écrivais cela à Max. Cette peur-là, c’est cilice qui colle à la peau de l’Amour naissant et se resserre sur lui, à mesure qu’il grandit… Je l’ai porté, ce cilice, on n’en meurt pas. Je le porterais à nouveau, si… si je ne pouvais pas faire autrement...
« Si je ne pouvais faire autrement… » Cette fois la formule est nette ! Je l’ai lue écrite dans ma pensée, je l’y vois encore imprimée comme une sentence en petites capitales grasses… Ah ! je viens de jauger mon piètre amour et de libérer mon véritable espoir : l’évasion. »
Colette, La Vagabonde, Robert Laffont, Collection Bouquins, I, 1989, page 930.
Voir aussi Visage de femme : « Colette à la une ». et 28 janvier 1873: Colette.
Voir l' index des auteurs.
Rédigé le 03 février 2005 à 11:31 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
02 février 2005
2 février 1922 : première publication d’Ulysse
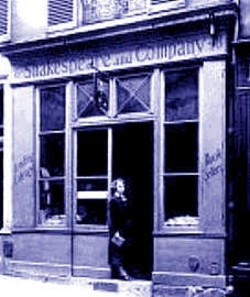
Librairie Shakespeare and Co,
à droite du 12, rue de l'Odéon, Paris
Ph.©D.R.
2 février 1922 : première publication officielle d’Ulysses (en anglais), le jour même des 40 ans de James Joyce. L'ouvrage a été imprimé en un volume chez Maurice Darantière à Dijon. Les deux premiers exemplaires sont remis en mains propres à Joyce comme cadeau d'anniversaire. L’ouvrage est édité sur l'initiative de Sylvia Woodbridge Beach (Baltimore, 1887- Paris, 1962) , qui tient la librairie-bibliothèque Shakespeare and Co., rue de l’Odéon. La diffusion de l’ouvrage aux Etats-Unis est interdite. Elle ne sera officiellement autorisée que le 6 décembre 1933. Quant à la librairie Shakespeare and Co., elle a été fermée par les Nazis, sous l'Occupation, en 1941, à la suite d'un refus de vente d'ouvrage par Sylvia Beach à un officier allemand.
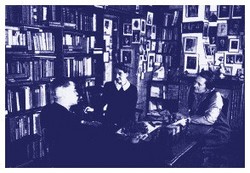
L'écrivain James Joyce
en compagnie de Sylvia Beach et de son amie Adrienne Monnier,
dans la librairie Shakespeare and Co.
Ph.©D.R.
Plusieurs fragments de l’ouvrage étaient déjà parus entre 1918 et 1920 dans The Little Review, dirigée par Margaret Anderson, à qui, à la suite de cette publication, a été intenté un procès pour immoralité (en octobre 1920) par le comité Sumner (« Comité de décence »).
C’est à partir de 1922 que Joyce entreprend l’écriture de sa deuxième œuvre monumentale Finnegans Wake, et dont le titre ne sera révélé que lors de la publication en 1939 chez Faber and Faber (Londres) et The Viking Press (New York). Entre-temps, durant les dix-sept années de gestation de l’ouvrage, Finnegans Wake a été appelé par Joyce Work in progress (L’œuvre en marche).
Ci-après un extrait d’un des dix-huit « points de vue », « Nausicaa », traduit par Patrick Devret dans la dernière traduction Gallimard.
« Tiens. Hm. Hm. Oui. C’est son parfum. Voilà pourquoi elle agitait la main. Je vous laisse ceci pour que vous pensiez à moi quand je serai au loin dans mon petit lit. Qu’est-ce que c’est ? De l’héliotrope ? Non. Jacinthe ? Hm. Essence de roses, je crois. Elle doit aimer les senteurs de ce genre. Suaves et bon marché ; vite tournées. Pourquoi Molly aime l’opoponax. Lui convient avec un soupçon de jessemin. Ses notes hautes et ses notes basses. […] J’imagine que c’est une infinité de minuscules particules diffusées alentour. Oui, c’est ça. Parce que ces îles à épices, ou les cinghalais ce matin, on les sent de loin. Je vous explique. C’est comme une gaze ou une résille très fine qui recouvre leur peau, fine comme comment appelle-t-on ça les fils de la Vierge et elles n’en finissent pas de l’élaborer, fine comme tout, comme les couleurs de l’arc-en-ciel sans qu’on la perçoive ? Ça reste accroché à tout ce qu’elle quitte. Le pied de ses bas. Ses souliers encore chauds. Son corset. Ses culottes : son petit coup de pied quand elle les fait valser. Bye-bye jusqu’à la prochaine fois. Le chat aime flairer dans ses fringues sur le lit. Reconnais son odeur entre mille. L’eau de son bain aussi. Ça me rappelle les fraises à la crème. »
James Joyce, Ulysse, Gallimard, 2004, page 464.
Voir aussi : 13 janvier 1941/Mort de James Joyce.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 02 février 2005 à 10:47 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
01 février 2005
Sylvia Plath/Winter trees
Winter trees
« The wet dawn inks are doing their blue dissolve.
On their blotter of fog the trees
Seem a botanical drawing -
Memories growing, ring on ring,
A series of weddings.
Knowing neither abortions nor bitchery,
Truer than women,
They seed so effortlessly!
Tasting the winds, that are footless,
Waist-deep in history -
Full of wings, otherwoldliness.
In this, they are Ledas.
O mother of leaves and sweetness
Who are these pietàs?
The shadows of ringdoves chanting , but easing nothing. »
Arbres d’hiver
« Les lavis bleus de l’aube se diluent doucement.
Posé sur son buvard de brume
Chaque arbre est un dessin d’herbier -
Mémoire accroissant cercle à cercle
Une série d’alliances.
Purs de clabaudages et d’avortements,
Plus vrais que des femmes,
Ils sont de semaison si simples !
Frôlant les souffles déliés
Mais plongeant profond dans l’histoire -
Et longés d’ailes, ouverts à l’au-delà.
En cela pareils à Léda.
Ô mère des feuillages, mère de la douceur
Qui sont ces vierges de pitié ?
Des ombres de ramiers usant leur berceuse inutile. »
Sylvia Plath, Arbres d’hiver, précédé de La Traversée, Poésie/ Gallimard, 1999, édition bilingue, page 175. Traduction de Françoise Morvan et Valérie Rouzeau.
Voir aussi :
- Sylvia Plath/« I am vertical »
- le Portrait de Sylvia Plath dans la Galerie-Exposition.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 01 février 2005 à 21:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
1er février 1926/Italo Svevo
1er février 1926 : Italo Svevo à l’honneur dans la revue Le Navire d’argent de la directrice de la Maison des Amis du Livre, Adrienne Monnier.
La libraire-éditrice consacre le 9ème numéro du Navire d’argent à Italo Svevo. On y trouve quelques chapitres de Sénilité et de La Conscience de Zeno, traduits par Benjamin Crémieux et Valery Larbaud. On peut également y lire plusieurs articles de Benjamin Crémieux consacrés à la ville de Trieste.
« Mon enfance, voir mon enfance ? Plus de dix lustres me séparent d’elle et mes yeux presbytes pourraient peut-être y parvenir si la lumière qui en émane n’était interceptée par des obstacles de tous genres, hautes montagnes en vérité : toutes les années et certaines heures de ma vie.
Le docteur m’a recommandé de ne pas m’obstiner à regarder si loin. Les événements récents sont également précieux pour ces messieurs et en particulier les imaginations et les rêves de la nuit précédente. »
Italo Svevo, « Préambule » (chapitre II), La Conscience de Zeno, Gallimard, Collection Folio, 1954, page 11.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 01 février 2005 à 10:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
31 janvier 2005
Certitude/Widad Benmoussa

« Je ne suis pas inquiète
J’ai du mal à m’exprimer
et n’en suis pas inquiète
Avec des étreintes grondantes
j’ouvre pour toi la saison des aveux
et voilà que je m’élève
étoile
après étoile
dans ta nuit blanche »
Widad Benmoussa, « Certitude », J’ai racine dans l’air, in La Poésie marocaine de l’indépendance à nos jours (anthologie), La Différence, 2005, page 75. Traduit de l’arabe par Abdellatif Laâbi.
Widad Benmoussa est née à Ksar-el-Kebir (Maroc) en 1969. Son premier recueil de poésie (J’ai racine dans l’air), publié à Rabat en 2001, donne la « dominante » de la personnalité de cette jeune femme qui affirme tout à trac : « En matière de refus, nul ne me ressemble ».
Nul doute par ailleurs qu’avec les extraits poétiques de cette anthologie (établie par Abdellatif Laâbi avec la collaboration de Jocelyne Laâbi) et récemment publiée par les éditions La Différence, « nous accédons à un continent poétique pour grande partie inexploré », comme le souligne la quatrième de couverture de l'ouvrage.
Voir
- la fiche de l'éditeur.
- le site d'Abdellatif Laâbi.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 31 janvier 2005 à 21:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
31 janvier 1956/Nuit et brouillard
Le 31 janvier 1956, le cinéaste français Alain Resnais reçoit le prix « Jean Vigo » pour la réalisation de son film Nuit et brouillard.
Un hiver 58
Elle se souvient de ce jour d’hiver triste et gris. Un jour privé de mistral. Un jour de classe pareil aux autres. Avec au programme de la matinée, le cours de sciences naturelles. Et la dissection de la grenouille. Un jour de jeu chloroformé. Elle se souvient de ce jour-là. Des professeurs assemblés dans le hall d’entrée du lycée. Plus silencieux qu’à l’ordinaire. À peine des chuchotis. Des élèves alignées deux par deux, attendant en silence. De l’entrée de Madame la directrice. Qui distribue des ordres, échange à voix basse quelques propos avec ses collègues. Des rangs qui se resserrent puis s’ébranlent. Se dirigent vers l’escalier d’honneur. Jusqu’à l’amphithéâtre. Le « grand amphi » réservé à la distribution des prix de fin d’année.
Aujourd’hui, c’est le jour des classes de cinquième. Les cours de la matinée sont annulés. Suspendus. Pour une raison qui lui échappe. Il n’y aura pas de dissection de la grenouille blanche étirée dans son bocal de formol. Pas de chahut avec le professeur en blouse blanche non plus. Elle l’aperçoit dans le groupe des accompagnatrices. Semblable en tous points, par le nom qu’elle porte et le physique simiesque qui est le sien, aux grands singes empaillés et ricanants. Qui trônent empoussiérés parmi les squelettes et les crânes de la salle de sciences. Pas d’arrêt fasciné devant les silex et les os numérotés, étiquetés, classés. Rutilants derrière leur vitre.
Le grand amphithéâtre leur est ouvert, transformé en salle de cinéma. C’est bien la première fois que cela se produit ! Elles échangent entre elles des regards interrogateurs. Mais ses camarades de classe n’en savent pas plus qu’elle. Elles prennent place dans les gradins. Devant l’écran. Blanc. Puis Noir. Soudain l’écran affiche des lettres constellées de zébrures. Le grésillement de la pellicule troue le silence. Un titre s’affiche en noir et blanc. Nuit et Brouillard. Elle ne s’attendait à rien de précis. Mais d’emblée, elle reçoit les terrifiantes images de plein fouet. Elle ne comprend rien. Sa stupeur est totale. Elle est figée sur son siège. Instinctivement, elle s’agrippe à la main amie de sa camarade. Elle lit pour la première fois le nom d’Auschwitz. Où est-ce ? C’est lugubre. Elle pénètre avec la caméra dans un camp flanqué de miradors. Elle découvre les barbelés et les baraquements. Elle découvre, pour la première fois, la promiscuité des corps désemparés. L’étoile jaune sur la toile rayée du pyjama informe. Elle découvre la vie au camp. La vie de ceux et celles qui vivent là. Entassés sur des lits de bois superposés. Sans matelas ni couvertures. Pourquoi ? Elle découvre le labeur et la souffrance dans la neige et la boue. Les coups qui font tomber les plus affaiblis. Et les tortures infligées aux autres à titre d’exemple. La queue pour se rendre, sous le vent coupant de l’hiver, à la soupe. Le seul point vivant de chaleur. Une soupe glaireuse mais fumante servie dans des gamelles en fer blanc. Une louche par corps. Avalée et lapée à même l’écuelle. Elle découvre les crânes rasés. Les regards vides et hagards de ceux qui n’ont plus de nom. Et qui ont faim. Cette maigreur des corps transis. Et les numéros tatoués sur les bras squelettiques. Pourquoi ?
Des numéros pareils à celui qu’elle a vu, un jour de grande chaleur marseillaise, sur le bras de son professeur d’anglais. Elle était en sixième alors. Elle avait posé la question autour d’elle. Il lui avait été répondu que, sans doute, son professeur était juif. Cette réponse était restée une énigme dont elle n’entendit plus parler. Maintenant elle savait : c’était donc cela être juif. C’était être réduit à l’incompréhension muette de corps déshydratés. Tremblants et grelottants. De froid et de terreur. Elle découvre des trous immondes où s’amoncellent chaussures et sacs. Cheveux et dents. Elle ne comprend pas. Elle découvre les douches où s’entassent bientôt des corps déchus aux yeux exorbités. Corps aussitôt entassés dans des bennes puis déversés dans d’autres trous plus profonds encore. Elle découvre les corps nus. Basculés pêle-mêle. Elle en éprouve, au plus aigu de sa chair, la cadavérique flacidité. Bras et jambes s’entremêlent aux bras et jambes. Les têtes heurtent d’autres têtes. Qui est qui ? À qui sont ces corps sans nom ?
Pendant ce temps-là, la vie continue, avec sa soupe glaireuse, ses longues marches dans la neige et la boue. Ses sommeils sans rêves. Sa marche inéluctable vers les couloirs des douches. La chaleur enfin. La fin définitive de l’enfermement. La dernière épreuve. Ce qui reste de vivant a compris. L’Enfer est là au bout du couloir. À portée de corps. Comme seule issue. Elle comprend, elle aussi, que cet Enfer-là a existé ! Qu’il a été conçu, qu'il a été réfléchi par d’autres hommes. Ceux-là mêmes qui hurlent des ordres incompréhensibles. Circulent dans le camp en toute liberté, bottés, casqués et gantés. Bien nourris, satisfaits du travail accompli avec précision. Et rigueur. Selon les règles établies. Qui vivent et rient au milieu des morts-vivants qui sont leur œuvre. Pour qui le silence de la mort n’est qu’un jeu. Le rideau tombe sur Auschwitz.
C’est cela, pour elle, Nuit et Brouillard. Le symbole de l’« Humanité déchue ». Elle avait onze ans. Rien, jamais, ne sera plus comme avant.
Texte d’Angèle Paoli
Rédigé le 31 janvier 2005 à 00:49 | Lien permanent | Commentaires (2) | TrackBack
30 janvier 2005
Zoé Karèlli, Imagination du moi
Zoé Karèlli, « Imagination du moi »
« Parfois les pas du temps
s’arrêtent et le silence alors
s’installe, tantôt terrible
odieux obscur et plein d’angoisse
épais inéluctable
tantôt plus clair, apparaissant
pétri de lumière
pur, enfin, limpide
et léger, si léger
que tu ne peux rester
là non plus
dans toute cette lumière
soudaine intense
que tu donnes et reçois
qui te brûle
au moment de calme
où le temps s’arrête
et le silence attend lumineux
et le temps attend lui aussi
que tu t’effaces. »
Zoé Karèlli, « Imagination du moi », Imagination du temps [1949], Anthologie de la poésie grecque contemporaine (1945-2000), Gallimard, Collection Poésie, page 83. Traduction de Michel Volkovitch.
BIO-BIBLIOGRAPHIE
Issue d’une grande famille de Salonique (Thessalonique), Chrysoula Arguriadou, dite Zoé (ou Zoi) Karèlli (Χρυσούλα Αργυριάδου, dite Ζωή Καρέλλη) est née en 1901 et morte le 17 juillet 1998. Elle n’a pas seulement été une pionnière de la mouvance féministe, en tant que fondatrice du mouvement « Greek Salonica Influence ». Elle est aussi l'auteur de douze recueils de poésie et d'essais littéraires parmi lesquels figurent un essai sur Paul Claudel et un autre sur Samuel Beckett. Elle a aussi traduit des poètes étrangers (dont T.S. Eliot) et écrit plusieurs pièces de théâtre.
Les poèmes de Zoé Karèlli composent un véritable journal intime, qui témoigne de la déchirure d’une double postulation antagonique : sensualité et mysticisme. « J'ai vécu avec force et sentiment, avec des émotions passionnées », dit-elle dans « Le dernier chant de Sapho ». Zoé Karelli est la sœur de l’écrivain Nikos-Gabriel Pentzikis.
Parmi ces recueils, on peut retenir Cheminement (1940), La Saison de la mort (1948), Imagination du temps (1949), Solitude et orgueil (1951), Gravures et icônes (1952), Le Navire (1955), Cassandre (Kassandra kai oalla poiamata, anthologie, 1955), Contes du Jardin (1955), Contrastes (1957), Le Miroir de minuit (1958), Le Carrefour (1973). Elle a aussi publié son Journal en 1973.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 30 janvier 2005 à 19:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
30 janvier 1959/Albert Camus
Le 30 janvier 1959, création au Théâtre Antoine de la pièce Les Possédés, d'après le roman de Fédor Dostoïevski (roman réintitulé par la suite Les Démons), dans une adaptation théâtrale et une mise en scène d'Albert Camus. Décors et costumes de Mayo. La pièce a tenu l'affiche du Théâtre Antoine jusqu'en juillet 1959, puis a bénéficié d'une tournée en banlieue (notamment à Suresnes au mois de septembre) et en province.
Avec la distribution suivante :
Pierre Vaneck dans le rôle de Nicolas Stavroguine
Pierre Blanchar dans le rôle de Stépan Trophimovitch Verkhovensky
Roger Blin dans le rôle de l’évêque Tikhone
Michel Bouquet dans le rôle de Pierre Stepanovitch Verkhovensky
Charles Denner dans le rôle du capitaine Lebiadkine.
Et dans les rôles féminins :
Tania Balachova dans le rôle de Varvara Petrovna Stavroguine
Charlotte Clasis dans le rôle de Prascovie Drozdov
Nadine Basile dans le rôle de Dacha Chatov
Janine Patrick dans le rôle de Lisa Drozdov
Catherine Sellers dans le rôle de Maria Timopheievna Lebiadkine
Nicole Kessel dans le rôle de Marie Chatov.
« J'ai rencontré cette oeuvre à vingt ans et l'ébranlement que j'en ai reçu dure encore, après vingt autres années. » (Albert Camus)
Ci-après, un extrait du script d'un entretien radiophonique avec Albert Camus, réalisé par Martine de Barcy pour Radio-Canada, autour de la création de la pièce de Dostoïevski.
(date de diffusion : 20 décembre 1959, 15 jours avant la mort d’Albert Camus)
=> Interview en accès audio libre (3 min 47 s)[format : Windows Media Player].
• Martine de Barcy :
« Mais je crois, Monsieur Camus, aussi loin que l’on remonte dans votre œuvre, on voit toujours le théâtre présent, et même déjà dans votre passé, puisque vous avez, dans votre vie d’étudiant à Alger, monté un certain nombre de pièces. Et vous avez vous-même joué. »
• Albert Camus :
« C’est exact, d’une part il n’y avait pas de théâtre à Alger ; comme j’en avais la passion, j’ai simplement créé un théâtre moi-même, un petit théâtre d’amateurs et d’autre part pour gagner ma vie, j’ai joué dans des troupes professionnelles en tournée. »
• Martine de Barcy :
« Mais que représente donc le théâtre pour vous attirer à différentes étapes de votre carrière ? »
• Albert Camus :
« Eh bien, je ne sais pas, souvent les créatures de théâtre me paraissent plus réelles que les créatures de la vie et, en tout cas, c’est un monde où je me sens beaucoup plus à l’aise que dans la vie courante. »
• Martine de Barcy :
« Mais n’y a-t-il pas pour vous contradiction entre l’œuvre créatrice d’homme de théâtre et celle de l’homme de lettres qui écrit des romans ou des essais ? »
• Albert Camus :
« Il n’y a aucune contradiction pour moi parce que le théâtre me paraît le plus haut des arts littéraires en ce sens qu’il demande la formulation la plus simple et la plus précise à l’intention du plus grand public possible et, pour moi, c’est la définition même de l’art. »
• Martine de Barcy :
« Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre de Dostoïevski spécialement ? »
• Albert Camus :
« Je l’ai choisie spécialement parce que je l’aime spécialement et j’ai toujours vu ces personnages dans une lumière dramatique, dans une lumière de scène, par conséquent j’ai été tenté de les porter à la scène. »
• Martine de Barcy :
« Mais ce roman paraît un peu touffu et certains disent même confus à la lecture ? Est-ce que ça ne présente pas quelque difficulté justement pour la schématisation scénique ? »
• Albert Camus :
« En fait, le roman est certainement touffu mais il n’est certainement pas confus. En ce sens que la logique intérieure qui est propre à Dostoïevski peut très bien s’y retrouver. C’est cette logique que j’ai justement essayé de retrouver et j’ai simplement éliminé ce qui était touffu pour ne garder que cette logique intérieure. »
• Martine de Barcy :
« Eh bien, Monsieur Camus, puisque vous avez l’amabilité de nous lire quelque chose, je vais vous demander de nous situer le passage. »
• Albert Camus :
« C’est très simple. Ce sont exactement les premières phrases prononcées au début de la pièce par le narrateur lorsqu’il arrive devant le public. Ce narrateur, qui fait aussi partie des personnages de la pièce, arrive devant un rideau noir. »
« Mesdames, Messieurs,
Les étranges événements auxquels vous allez assister se sont produits dans notre ville de province sous l’influence de mon respectable ami le professeur Stépan Trophimovitch Verkhovensky. Le professeur avait toujours joué, parmi nous, un rôle véritablement civique. Il était libéral et idéaliste ; il aimait l’Occident, le progrès, la justice, et, en général, tout ce qui est élevé. Mais sur ces hauteurs, il en vint malheureusement à s’imaginer que le tsar et ses ministres lui en voulaient personnellement et il s’installa chez nous pour y tenir, avec beaucoup de dignité, l’emploi de penseur exilé et persécuté. Simplement, trois ou quatre fois par an, il avait des accès de tristesse civique qui le tenaient au lit avec une bouillotte sur le ventre. […]
Là commence mon histoire. »
Albert Camus, Les Possédés (d'après Dostoïevski), in Théâtre, récits, nouvelles, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1962, page 925.
Sur le site de France Culture, plus de huit heures de programmes sonores (entretiens et débats) pour apprécier l'actualité de la pensée d'Albert Camus.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 30 janvier 2005 à 00:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
29 janvier 2005
29 janvier 1932/Fernando Pessoa
Petit détour, ce matin, par Le Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa. À la date du 29 janvier 1932 (notules 324 et 325), je tombe en arrêt sur ces deux notules (324 et 325) :
324
« Savoir se défaire de toute illusion est absolument nécessaire pour parvenir à faire des rêves.
Tu atteindras au degré suprême de l’abstention par le rêve, où les sens se mêlent, où les sentiments débordent, où les idées s’interpénètrent. De même que les couleurs et les sons confondent leurs saveurs, les haines prennent la saveur des amours, les choses concrètes celle des choses abstraites, et inversement. On voit se briser les liens qui, s’ils reliaient tout, séparaient tout cependant, en isolant chaque élément. Tout dès lors se fond et se confond. »
325
Fictions d’interlude, qui viennent couvrir, multicolores, le marasme et l’aigreur de notre intime incroyance. »
Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité. Edition intégrale. Nouvelle édition refondue, revue et corrigée. Christian Bourgois éditeur, 1999, page 324.
Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 29 janvier 2005 à 14:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
28 janvier 2005
28 janvier 1873/Colette
28 janvier 1873 : naissance de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne).

Colette
Ph, G.AdC
« J’étais justement faite pour ne pas écrire » (Colette)
« Mon premier hiver scolaire fut un grand hiver, j’allais à l’école entre deux murs de neige plus hauts que moi… Qu’a-t-on fait de ces grands hivers d’autrefois, blancs, solides, durables, embellis de neige, de contes fantastiques, de sapins et de loups ? Après avoir été aussi réels que mon enfance, ils sont donc aussi perdus qu’elle ? Aussi perdus que la vieille Mlle Fanny, immatérielle institutrice fantôme, qui vivait de romans et de privations ? Parfois Mlle Fanny sortait de son rêve romanesque, et poussait un hennissement qui annonçait la leçon de lecture… Cette année-là, nous apprîmes à lire dans le Nouveau Testament. Pourquoi le Nouveau Testament ? Parce qu’il se trouvait là, je pense. Et la vieille demoiselle fantôme institutrice scandait, à coups de règle sur son pupitre, le rythme de syllabes sacrés, psalmodiés en chœur : En ! – ce ! – temps ! – là ! – Jé ! – sus ! – dit ! – à ! – ses ! – dis ! - ci ! – ples !... Parfois un élève bébé, qui s’était assise sur sa chaufferette pour se réchauffer, poussait un cri aigu, parce qu’elle venait de brûler son petit derrière son petit son derrière. Ou bien une colonne de fumée montait d’une chaufferette… Tout autour de nous, c’était l’hiver, un silence troublé de corbeaux, de vent miaulant, de sabots sabotant, l’hiver et la ceinture des bois autour du village… Rien d’autre. Rien de plus. Une humble, une rustique image…
Mais je crois que si une petite magie inoffensive pouvait me rendre ensemble l’arôme de la pomme bavant sur la braise, de la châtaigne charbonnant, et surtout l’extraordinaire vieux tome du Nouveau Testament, rongé, loqueteux, moisi, où Mlle Fanny conservait, entre les pages, des pétales de tulipe séchés, transparents comme l’onyx rouge, des petits cadavres gris de violettes, les figures à barbe carrée des pensées de printemps, je crois, oui, que je serais bien contente. Je crois que j’emporterais avec moi, je respirerais ce grimoire à dévoiler le passé, cette clef qui rouvre l’enfance, et qu’il me rendrait mes six ans qui savaient lire, mais qui ne voulaient pas apprendre à écrire ? Cette répugnance, que m’inspirait le geste d’écrire, n’était-elle pas un conseil providentiel ? Il est un peu tard pour que je m’interroge là-dessus. Ce qui est fait est fait. Mais dans ma jeunesse, je n’ai jamais, jamais désiré écrire. Non, je ne me suis jamais levée la nuit en cachette pour écrire des vers au crayon sur le couvercle d’une boîte à chaussures ! Non, je n’ai jamais jeté au vent d’ouest et au clair de lune des paroles inspirées ! Non, je n’ai pas eu 19 ou 20 pour un devoir de style, entre douze et quinze ans ! Car je sentais, chaque jour mieux, je sentais que j’étais justement faite pour ne pas écrire. Je n’ai jamais envoyé, à un écrivain connu, des essais qui promettaient un joli talent d’amateur ; pourtant, aujourd’hui, tout le monde le fait, puisque je ne cesse de recevoir des manuscrits. J’étais donc bien la seule de mon espèce, la seule mise au monde pour ne pas écrire. Quelle douceur j’ai pu goûter à une telle absence de vocation littéraire ! »
Colette, « La chaufferette », Journal à rebours [Arthème Fayard, 1941],
Laffont/Bouquins, III, 1989, pp. 60-61.
Voir aussi : 3 février 1923/ La Vagabonde.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 28 janvier 2005 à 11:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
26 janvier 2005
26 janvier 1861/Gustave Flaubert
À Jules Michelet
Croisset, 26 janvier 1861.
[…] Quel admirable livre que La Mer ! […] C’est une œuvre splendide d’un bout à l’autre, qui a l’air simple et qui est sublime. Quelle description que celle de la tempête d'octobre 1859 ! quel chapitre que celui de la mer de lait, avec cette phrase exquise à la fin : « De ses caresses assidues […] la tendresse visible du sein de la femme […] » ! Vous nous donnez des rêveries immenses avec l'atome, la fleur de sang, les faiseurs de monde ! Il faudrait tout citer ! Vous faites aimer les phoques. […]
On dirait que vous avez fait le tour du monde sur l’aile des condors, et que vous revenez d’un voyage dans les forêts sous-marines. On entend le murmure des grèves. C’est comme si l’eau salée vous cinglait à la figure. Partout on se sent porté sur une grande houle.
Et ce qui n'est pas magnifique est d'une plaisance profonde, comme ce petit roman de la dame aux bains de mer, si fin et si vrai ! […] dans un coin de votre livre j'ai retrouvé les soleils de mon adolescence.
N'importe, même dans les jours de défaillance, à un de ces lugubres moments où les bras vous tombent de fatigue, quand on se sent impuissant, triste, usé, nébuleux comme le brouillard et froid comme les glaçons qui craquent, on bénit la Vie, cependant, s'il vous arrive une sympathie comme la vôtre, un livre comme La Mer. Alors tout s'oublie. - Et de ce haut plaisir il reste peut-être une force nouvelle, une énergie plus longue.
Permettez-moi donc, Monsieur, de serrer cordialement, avec un frémissement d’orgueil, votre loyale main, qui est si habile, et de me dire (sans formule épistolaire)
tout à vous
Gustave Flaubert
Gustave Flaubert, Correspondance, III, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, pp. 142-143. Edition établie par Jean Bruneau.
Rédigé le 26 janvier 2005 à 00:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
25 janvier 2005
Virginia, lectures croisées
En feuilletant, ce jour anniversaire de la naissance de Virginia Woolf, la correspondance entre Vita Sackville-West et Virginia, je tombe immédiatement sur une lettre que Virginia, en vacances à Cassis, adresse à Vita, son inépuisable et insatiable amie, alors en expédition en Perse.
La lettre, datée du mardi 5 avril 1927, est écrite de la Villa Corsica, à Cassis. Je lis ceci, sous la plume de Virginia :
« 1. Virginia est complètement déparée par sa coiffure à la garçonne.
2. Virginia est entièrement avantagée par sa coiffure à la garçonne ;
3. La coiffure à la garçonne de Virginia est totalement imperceptible.
Telles sont les trois écoles de pensée sur ce sujet si important. J’ai acheté une boucle de cheveux que j’attache à un hameçon. Elle tombe dans la soupe et elle y est pêchée à l’aide d’une fourchette. »
Correspondance, Stock, Le nouveau cabinet cosmopolite, 1985, page 245.
Sur les séjours que Virginia Woolf fit à Cassis, chez sa sœur Vanessa, il existe un livre de petit format, séduisant et lisse, doux au toucher. Soigné dans sa présentation, dans le choix des couleurs. Avec sa première de couverture illustrée d’un bandeau photo central, rez-de-chaussée d’un phare, figure de proue sur mer calme. Un livre écrit par Joëlle Gardes, et publié en 2000. Sous le titre : Virginia Woolf à Cassis - Roches et failles
Sur cet ouvrage, j’ai rêvé. Mes notes :
Elle feuillette les pages de papier glacé. Elle fait glisser le signet « rouge Titien ». Elle regarde les photos. Certaines en double page. Puis leur titre. Comme la photo, magique, de ce bord de mer, calme et lisse, que contemple une femme de dos. Perdue dans son grand manteau sombre, la silhouette longue s'absorbe en son « lointain intérieur ». Ou cette autre photo qui lui succède sous le titre de « Grand large ». La silhouette sombre a disparu et l’horizon désert garde son calme étrange face au déchaînement des flots. L’écume des vagues a effacé depuis longtemps la trace des pas de Virginia sur les dalles qui enserrent le « pied du phare ». D’autres photos, d’un format plus réduit, cadrées avec une plaisante et séduisante irrégularité, rythment l’intime. « La traverse du château (II) » avec ses murs feuillus d’où émergent des frondaisons de pins parasol, cyprès... Ou encore « La façade de Fontcreuse » où s’inscrivent en ombre chinoise les ramures du platane et les deux jarres qui flanquent l’arbuste épineux grimpant entre les volets clos. Un peu plus loin, pourtant, un chat noir est là qui guette de son oeil unique l’entrée du visiteur. La voici dans le salon de « La Bergère » où se côtoient des objets hétéroclites. Appartenant à un temps révolu et cependant étrangement familier. Elle hasarde un regard dans la chambre avec sa belle armoire provençale où se reflète un bouquet riant. Elle se plait à imaginer qu’elle, la longue dame anglaise, s’est arrêtée devant la glace pour arranger une mèche folle échappée de son chignon. Ou pour vérifier, d’un geste rapide, le plissé de sa robe. Car Virginia a vraiment vécu en ces lieux. Le temps de brefs séjours auprès de sa soeur Vanessa, entourée d’artistes et installée à la « Bergère ». Dans le domaine de Fontcreuse… C’est cela qu’elle découvre sous la plume de Joëlle Gardes, dans le chapitre « Intérieurs ». Un texte précis. Qui retrace les épisodes cassidiens de la vie de Virginia Woolf. L’Angleterre, pourtant, n’est jamais bien loin.
Elle reprend le livre à rebours. « Ouvertures ». Tel est le titre de la première partie de « Roches et Failles ». Qui est ce « je » qui écrit : « J’étais comme un rocher inerte » ? C’est le « je » de Joëlle Gardes, l’auteur du petit livre coquille d’oeuf. Un « je » et une souffrance qui très vite s’estompent derrière la figure de plus en plus ample de Virginia. Les deux visages se superposent par moments. Qui est qui ? L’une est l’autre !
L'écriture d’« Ouvertures » est belle. Fluide, naturelle, légère. Et elle, elle passe sans s'en rendre compte des impressions de l'une aux impressions de l’autre. Les impressions de Virginia Woolf. Il y a comme un fondu enchaîné entre les deux écritures, entre les sensations ressenties par l'une et l'autre devant un paysage resté immuable. Bien sûr, elle sait que ce sont des projections, des superpositions, d'une sensibilité d'aujourd'hui sur une sensibilité d'hier. L'occasion pour Joëlle Gardes de tenter de faire revivre Virginia Woolf. Les moments de bonheur passés à Cassis. Qui lui ont probablement inspiré « La Promenade au phare » ou « Les Vagues ». Virginia Woolf est là, bien là. Elle la sent vivre et vibrer et elle circule de Cassis à l'Angleterre, sans s'en rendre compte. Joëlle Gardes s'approprie un lieu, un temps, un visage. Par son écriture, Joëlle restitue tout cela en douceur et en finesse. Elle lui rend Virginia très proche, très présente. C'est un texte qui « la » parle, qui parle d’elle, Virginia.
Il y a cette dernière photo : « La gare de Cassis ». Dans les brumes du soir, ce pourrait tout aussi bien être celle du village de Rodmell. Rodmell où vivait Virginia lorsqu’elle n’était pas à Londres. Et où elle mourut.
Elle hésite à refermer le livre. Une profonde nostalgie l’envahit. Cassis, lieu familier des promenades dominicales de son enfance. Exhumé par sa lecture. Inconsciente enfance. Elle ignorait alors qu’elle mettait ses pas dans ceux de Virginia. Les seuls récits qu’elle connaissait de cette station balnéaire faussement tranquille étaient ceux du Provençal. Et ceux que leur faisait son père, souvent chargé de lourds dossiers. C’étaient les règlements de compte des truands corses-marseillais qui éclaboussaient de leur sang les falaises du cap Canaille. Avec ces corps déchiquetés qui s’agrippaient à la rocaille. Et ces bagnoles à la James Dean qui s’écrasaient dans les flots. Virginia n’a pas eu le temps de connaître Cassis sous l’angle de la violence. Et les malfrats écroués aux Baumettes n’avaient pas non plus l’idée qu’une romancière anglaise de génie avait traversé ces lieux. « La traversée des apparences » ! Ce pourrait être le titre d’un nouveau roman. Un roman sur la croisée des chemins, de ces chemins qui ne se rencontrent pas. Un roman de Virginia !

Source : Castalie
Le petit livre s’ouvre à nouveau de lui-même. Sur une double page : c’est, en gros plan, la photo d’une feuille d’agave, tordue, torturée et griffue. Marquée des biffures du temps. Ecriture incrustée dans le vert filandreux de l’agave. Signes gravés dans sa chair. Page de fibres vives, à l’image de celles que Virginia laisse derrière elle.
Joëlle Gardes, Virginia Woolf à Cassis, Editions Images En Manœuvres, 2000.
Texte d'Angèle Paoli
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 25 janvier 2005 à 13:15 | Lien permanent | Commentaires (3) | TrackBack
Terres de femmes sur France 3 Corse
Terres de femmes est à la "une" de la rubrique Agenda Culture/Livres du site de France 3 Corse en même temps que le dernier ouvrage de Jeanne Bresciani (Les Vestiges de Janvier), dont j'ai rendu compte sur ce blog. Jeanne Tomasini est aussi dans la sélection du jour : j'aurai sûrement l'occasion de reparler de cette octagénaire talentueuse et pétulante (si je m'en tiens à notre dernière rencontre à Luri, dans le Cap) et des éditions Little Big Man qui ont par ailleurs publié La Vendetta de Sherlock Holmes de Jean Pandolfi-Crozier (dont on peut toujours suivre les aventures haletantes sur le blog scripteur).
Rédigé le 25 janvier 2005 à 10:29 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
25 janvier 1882/Naissance de Virginia Woolf
Date anniversaire de la naissance (à Londres, le 25 janvier 1882) de Virginia Woolf.
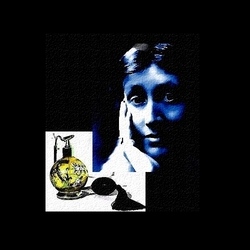
Portrait de Virginia Woolf.
Image, G.AdC
« En posant sa broche sur la table, elle eut un spasme subit comme si, pendant qu’elle rêvait, des griffes de glace s’étaient enfoncées dans sa chair. Elle n’était pas vieille encore, elle venait de commencer sa cinquante-deuxième année. Des mois et des mois de cette année étaient intacts. Juin, juillet, août ! Chacun d’eux était encore presque entier et, comme pour recueillir la goutte qui tombe, Clarissa (elle alla vers sa coiffeuse) se plongea au cœur même de ce moment, l’arrêta, le moment de ce moment de juin lourd du poids de tous les autres matins, regarda la glace, la coiffeuse, avec tous ses flacons, comme pour la première fois, réunit son être en un point (elle regarda dans la glace) et vit le délicat visage rose de la femme qui allait ce soir même donner une soirée, Clarissa Dalloway, elle-même.
Que de fois elle avait vu ce visage et toujours avec cette imperceptible contraction ! Elle faisait une moue en se regardant dans la glace, pour mettre son visage au point. C’était bien elle, mise au point, précise, définie. »
Virginia Woolf, Mrs. Dalloway [1925], Stock, 1948 pour la traduction française, Le Livre de Poche, collection Biblio, page 50.
« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d’habitude. »
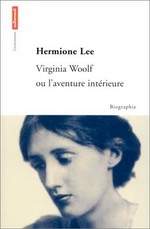
Journal de Virginia Woolf, 17 février 1922. À John Barnard, in Hermione Lee, Virginia Woolf ou l’aventure intérieure [1996], Autrement, collection Littératures, 2000.
Rédigé le 25 janvier 2005 à 09:52 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
24 janvier 2005
Tout est dans le rêve...
Le Rêve de Balthus de Nathalie Rheims n’est pas une « somme ». Non, c’est un petit livre. Conçu comme un véritable jeu de pistes, aux multiples messages cryptés. Mais c’est surtout un voyage onirique, tout comme la toile qui lui sert de guide.
Mais que s’est-il donc passé le 25 mars ? C’est l’une des nombreuses questions qui guident la lecture de ce roman. Le 25 mars, c’est le jour de la Visitation, le jour où l’Ange Gabriel rend visite à Marie. Jour béni de promesse de vie et de résurrection. C’est le jour de l’Annonciation. Mais c’est aussi (oh, surprise !) le jour où Abel périt sous les coups de Caïn, son frère. Dies irae dies illa. Jour de colère et de désespoir. L’humanité est marquée pour toujours par le sceau noir de la jalousie. Éternel dialogue entre la vie et la mort. Les deux volets du diptyque sont là pour l’essentiel. Oui, mais quoi d’autre encore ? Le 25 mars, c’est aussi le jour anniversaire de la rencontre rituelle de la Confrérie de Sainte-Ursule. Ah ! Et où ? À Venise !
C’est là, à Venise, non loin de l’église San Giovanni e Paolo, que se retrouvent les membres d’une curieuse congrégation en quête du neuvième cycle de la réincarnation. Une secte alors ? Peut-être. Versée, en tout cas, dans les théories du Suédois Swedenborg. Théories que s’applique à mettre en pratique cette assemblée mystique. Parmi les hommes encapuchonnés, qui s’autoconvoquent selon un rituel étrange : le peintre Balthus. Et son ami très cher, Maurice, père de Léa, qui confie à sa fille, quelque temps avant de mourir: « Tout est dans Le Rêve de Balthus ». Petite phrase qui martèle de son mystère les songes de l’amnésique Léa. Mais il y a aussi Andrea, père désespéré après la disparition d’Angie, soudainement « envolée » sans laisser de trace, du côté du Rialto. Et Gianni, Michel, Attilio et les autres…
Justement, le 25 mars 1958, un an après que le peintre eut réalisé « Le Rêve », la médiumnique Léa révèle que « la jeune fille à la rose » peinte par Balthus n’est autre qu’Angie. Mais cette révélation en amène d’autres et ensemble ils découvrent l’étrange similitude entre Angie, la jeune fille « ailée » de Balthus, et le Persée de Gustave Moreau. Tandis que Léa, elle, s’incarne dans la jeune fille endormie (Andromède). Elle est Léa, la jeune fille « au rêve ». L’année suivante, le 25 mars 1959, Léa révèle, à travers le rêve de ce jour-là, l’existence d’un tableau d’Ingres où la même Angie « apparaissait à une jeune fille endormie ». Puis surgit, chez chacun des collectionneurs, une toile de Fragonard, de Watteau, de Vermeer, de Caravage, de Titien. Au travers des siècles, le sujet du tableau est toujours le même : l’Annonciation… et ses divers avatars.
Au hasard des métamorphoses change toutefois l’objet tendu par Angie à la dormeuse qu’elle survole et frôle de son souffle. Rose jaune, croix d’or, lance, pomme, compas, livre, violon, miroir. Et enfin une plume, annoncée, comme les autres attributs de l’ange, dans le Livre des Rêves. Un livre d’heures, livre prophétique « daté de 1509 ». Et possession de Maurice. Mais manque la plume... et la toile dans laquelle elle apparaît. Une toile du Quattrocento, composée de plusieurs volets. Le Songe de Sainte Ursule, cinquième volet du cycle de la jeune martyre, a disparu. En même temps que son créateur. Le neuvième peintre, Vittore Carpaccio évidemment… sans lequel la quête d’immortalité ne peut aboutir.
Un voyage énigmatique que Le Rêve de Balthus, qui conduit le lecteur, ce rêveur éveillé, jusqu’aux confins de l’inconscient. L’inconscient de Léa qui est aussi sans doute celui, complexe, de son double, Nathalie Rheims. Et de l’univers qui est le sien. Davantage poétique qu’ésotérique…
Nathalie Rheims, Le Rêve de Balthus, Fayard/Leo Scheer, 2004.
Texte©angèlepaoli
EXTRAIT
« La boucle était bouclée. Le songe d’Ursule rejoignait l’annonce faite à Marie. Le rêve de Balthus se fondait dans celui de Carpaccio. Le Cycle de la confrérie se refermait sur un temps circulaire, s’ouvrant sur l’éternel retour. L’évidence était là, sous les yeux de tous, cachée dans le tableau depuis neuf ans, mais personne ne l’avait vue, car la main de Léa restait crispée autour du médaillon.
Il fallait voir ce qui était peint : l’invisible. Et cela, sans un miracle, personne ne le pouvait.»
(p. 98).
Voir aussi le Portrait de Nathalie Rheims.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 24 janvier 2005 à 18:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
Une histoire corse
Je dédie cet extrait d'Une histoire corse de Guy de Maupassant à Ugo Pandolfi, auteur de la talentueuse Vendetta de Sherlock Holmes.
« Après avoir gravi péniblement le sinistre val d'Ota, j'arrivais, au soir tombant, à Evisa, et je frappais à la porte de M. Paoli Calabretti, pour qui j'avais une lettre d'ami.
C'était un homme de grande taille, un peu voûté, avec l'air morne d'un phtisique. Il me conduisit dans ma chambre, une triste chambre de pierre nue, mais belle pour ce pays à qui toute élégance reste étrangère, et il m'exprimait en son langage, charabia corse, patois graillonnant, bouillie de français et d'italien, il m'exprimait son plaisir à me recevoir, quand une voix claire l'interrompit et une petite femme brune, avec de grands yeux noirs, une peau chaude de soleil, une taille mince, des dents toujours dehors dans un rire continu, s'élança, me secoua la main : "Bonjour, Monsieur ! ça va bien ?" enleva mon chapeau, mon sac de voyage, rangea tout avec un seul bras, car elle portait l'autre en écharpe, puis nous fit sortir vivement en disant à son mari : "Va promener Monsieur jusqu'au dîner."
M. Calabretti se mit à marcher à mon côté, traînant ses pas et ses paroles, toussant fréquemment et répétant à chaque quinte : "C'est l'air du val, qui est FRAÎCHE, qui m'est tombé sur la poitrine."
Il me guida par un sentier perdu sous des châtaigniers immenses. Soudain, il s'arrêta, et, de son accent monotone : "C'est ici que mon cousin Jean Rinaldi fut tué par Mathieu Lori. Tenez, j'étais là, tout près de Jean, quand Mathieu parut à dix pas de nous : "Jean, cria-t-il, ne va pas à Albertacce, n'y va pas, Jean, ou je te tue, je te le dis." Je pris le bras de Jean : "N'y va pas, Jean, il le ferait." (C'était pour une fille qu'ils suivaient tous deux, Paulina Sinacoupi.) Mais Jean se mit à crier : "J'irai, Mathieu, ce n'est pas toi qui m'empêcheras." Alors Mathieu abaissa son fusil avant que j'eusse pu ajuster le mien, et il tira. Jean fit un grand saut de deux pieds, comme un enfant qui danse à la corde, oui, Monsieur, et il me retomba en plein sur le corps, si bien que mon fusil m'échappa et roula jusqu'au gros châtaignier, là-bas. Jean avait la bouche grande ouverte, mais il ne dit pas un mot. Il était mort."
Je regardais, stupéfait, le tranquille témoin de ce crime. Je demandai : "Et l'assassin ?" Paoli Calabretti toussa longtemps, puis il reprit : "Il a gagné la montagne. C'est mon frère qui l'a tué, l'an suivant. Vous savez bien, mon frère, Calabretti, le fameux bandit ?..." Je balbutiai : "Votre frère ?... Un bandit ?..." Le Corse placide eut un éclair de fierté : "Oui, Monsieur, c'était un célèbre, celui-là ; il a mis à bas quatorze gendarmes. Il est mort avec Nicolas Morali, quand ils ont été cernés dans le Niolo, après six jours de lutte, et qu'ils allaient périr de faim." Il ajouta d'un air résigné : "C'est le pays qui veut ça", du même ton qu'il disait en parlant de sa phtisie : "C'est l'air du val qui est fraîche." »
Guy de Maupassant, "Histoire corse", Gil Blas, 1er décembre 1881. Texte publié sous la signature de Maufrigneuse.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 24 janvier 2005 à 14:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
24 janvier 1929/Jacques Réda
Jacques Réda fête aujourd’hui ses soixante-seize ans. Il est né à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) le 24 janvier 1929. Ci-après un extrait de son dernier recueil, L’Adoption du système métrique, publié en octobre 2004.
Crépuscule
« On ne voit pas les gens dont en entend la voix
Et ceux qu’on voit ont l’air d’illustrer le silence
Tandis que circulairement l’orage lance
De longs éclairs muets qui tremblent sur les toits.
On attendait un sourd roulement de tonnerre,
Mais rien. La dame, en face, arrose sans un bruit
Ses fleurs pâles déjà recloses pour la nuit
Et partout règne un silence extraordinaire.
Peut-être le moteur de la terre s’est-il
Arrêté brusquement malgré la loi physique
Et ne perçoit-on pas encore la musique
Des sphères à travers ce silence d’exil.
Eh bien qu’elle rugisse ou file son murmure
À l’infini sans nous qui sommes exilés
Entre l’aube stridente et les cieux constellés,
Dans le soir insonore avant la nuit obscure. »
Jacques Réda, « Crépuscule », L’Adoption du système métrique, Gallimard, 2004, page 107.
Voir aussi le site Jacques Réda et le blog Poezibao.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 24 janvier 2005 à 09:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
23 janvier 2005
23 janvier 1947/Mort de Pierre Bonnard
23 janvier 1947 : mort, au Cannet (Alpes-Maritimes), du peintre Pierre Bonnard, membre des Nabis.
« Les véritables paradis sont ceux que nous avons perdus » (Marcel Proust)
« La mort de Pierre Bonnard, le 23 janvier 1947, n’a pas fait grand bruit dans le monde des arts. Et pour cause : pas de vie mondaine, peu de relation dans le milieu, une existence retirée, la réputation d’un attardé de l’impressionnisme, j’en passe […] Bonnard n’a eu qu’un tort, c’est de persister à devenir lui-même, à n’être que soi, mais totalement ; de dire à voix haute ce que la plupart n’osent plus penser : que le bonheur existe, et l’amour et la beauté, que ce n’est ni d’avant ni d’arrière-garde, et qu’il est sacrément bon de ne chercher que cela. Au fond de soi. Tout au fond. »
Guy Goffette, « Le papillon de l’an 2000 », Elle, par bonheur, et toujours nue [1998], Gallimard, collection Folio, 2002, pp. 138-140.
« En peinture aussi, la vérité est près de l’erreur » (Pierre Bonnard).
Voir sur le site Royal Museums of Fine Arts of Belgium Catalogue la fiche détaillée de la toile de Pierre Bonnard (Nu à contre jour) qui illustre la première de couverture de l'ouvrage de Guy Goffette (ci-dessus).
Pour consulter la liste des œuvres de Pierre Bonnard présentes à ce jour sur la Toile, se reporter au site Artcyclopedia.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 23 janvier 2005 à 13:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
22 janvier 2005
Battement
Battement
Battement de la mer
eau en mouvement eau
errante. débris. thyms.
Orties. contre le temps
J’allais à ton odeur. je m’allongeais sur ta ruine.
Je dormais devant ton corps.
Temps en retour ré
volu maintenant. rose
Photographique soufflée.
Des vents . rose
baie . rosaire
Que ta main arrête .
battement temps
qui
de nouveau
arrive
Jacques Roubaud, Quelque chose noir [1986], Poésie/Gallimard, 2001, page 23.
Voir aussi un autre poème de Jacques Roubaud ("Le sens du passé", issu du même recueil) sur le site Poezibao.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 22 janvier 2005 à 19:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack
22 janvier 1970/Le fauteuil d'Eugène Ionesco
Le 22 janvier 1970, Eugène Ionesco est élu à l'Académie française au fauteuil de Jean Paulhan :
« (Didascalie : Il va s’asseoir dans le fauteuil.) La situation est absolument intenable. C’est ma faute, si elle est partie. J’étais tout pour elle. Qu’est-ce qu’elle va devenir ? Encore quelqu’un sur la conscience. J’imagine le pire, le pire est possible. Pauvre enfant abandonnée dans cet univers de monstres ! Personne ne peut m’aider à la retrouver, personne, car il n’y a plus personne. »
Eugène Ionesco, Rhinocéros [1960], Acte III, Gallimard, Collection Folio, page 243.
Voir aussi Le rhinocéros n'est pas mort...
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 22 janvier 2005 à 01:42 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
21 janvier 2005
21 janvier 1947/Michel Jonasz

Colombina
Image, G.AdC
Aujourd’hui Michel Jonasz fête ses 58 ans
(il est né le 21 janvier 1947 à Drancy, Seine-Saint-Denis)
« Lune,
Tu peux m'allumer,
Tu peux essayer, au moins vas-y.
Tends-moi la perche,
Je serai à la hauteur.
Lune,
Le Soleil m'ennuie
Et j'attends la nuit.
Cruelle, j'ai peur. Reviendras-tu ?
Toute une journée sans nouvelles.
Lune,
Mes yeux, tous les soirs,
Sont remplacés par
Deux cercles blancs de lumière,
Le reflet d'un éclair de
Lune.
Laisse-moi t'embrasser,
Juste un seul baiser,
Une caresse du bout des doigts ou
Est-ce trop te demander là ? » […]
Michel Jonasz
Rédigé le 21 janvier 2005 à 00:39 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
20 janvier 2005
Torcello/20 janvier 1900
Le 20 janvier 1900 meurt à Brantwood (Cumberland) John Ruskin. J’ai évidemment en tête La Bible d’Amiens, mais aussi Les Pierres de Venise, dont je cite ci-dessous un passage consacré à Torcello :
« Si vous voulez vous bien rendre compte de l'esprit dans lequel commença la domination de Venise et d'où lui vint la force d'accomplir ses conquêtes, ne cherchez pas ce que pouvaient valoir ses arsenaux ; n'évaluez pas le nombre de ses armées ; ne considérez pas le faste de ses palais ; ne cherchez pas à pénétrer le secret de ses Conseils ; mais montez sur le rebord rigide qui entoure l'autel de Torcello, et là, contemplant comme le fit jadis le pilote, la structure de marbre du beau temple-vaisseau, repeuplez son pont jaspé des ombres de ses marins défunts, et surtout, tâchez de ressentir l'ardeur qui brûlait leurs coeurs, lorsque, pour la première fois, les piliers édifiés dans le sable et le toit leur cachant un ciel encore rougi par l'incendie de leurs foyers, ils firent retentir, à l'abri de ces murailles et accompagné par le murmure des vagues et le tournoiement d'ailes des mouettes, l'hymne-cantique chanté par eux à pleine voix.
John Ruskin, Les Pierres de Venise, Paris, Hermann, 1983, page 52. Traduction de Mathilde Crémieux.
Voir aussi sur ce blog Torcello : Venezia 83 (III)
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 20 janvier 2005 à 12:19 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
19 janvier 2005
19 janvier 1839/Naissance de Paul Cézanne
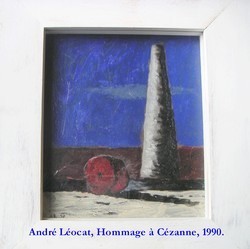
Sans titre, peinture à l'acrylique (1990) d'André Léocat (né à Brest en 1949).
Collection privée. Ph, D.R.
Autour de Paul Cézanne. Né à Aix-en-Provence, 28, rue de l’Opéra, le 19 janvier 1839 :
« Il est évidemment naturel que l'on aime chacune de ces choses au moment où on les fait ; mais, si on le montre, on les fait moins bien ; on juge au lieu de dire. On cesse d'être impartial ; et le meilleur, l'amour, reste en dehors du travail, n'y pénètre pas, reste en dette à côté sans être transposé. »
Rainer Maria Rilke, Lettres sur Cézanne, Editions du Seuil, Collection « Le don des langues », 1970. Traduction de Philippe Jaccottet.
Stimmung (état d’âme, atmosphère) : « impression que dans les peintures de Cézanne les objets semblent se former devant nos yeux, semblent surgir directement de la surface puis s’y dissoudre. »
Fritz Novotny, Cézanne, Vienne, The Phaïdon Press, New York, Oxford University Press, 1937, page 12.
« Il suffit que, sur un balcon
ou dans l’encadrement d’une fenêtre,
une femme hésite…, pour être
celle que nous perdons
en l’ayant vue apparaître. »
Rainer Maria Rilke, « Les fenêtres », I, Poèmes en langue française, Œuvres poétiques et théâtrales, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, page 1135.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 19 janvier 2005 à 14:01 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
18 janvier 2005
Me voici restitué[e] à ma rive natale…
(Note personnelle d'Angèle : je dédie tout particulièrement ce poème à Joëlle G.-T., une de mes lectrices les plus fidèles. J'écoute actuellement l'Andante sostenuto de la Sonate pour piano en si bémol, D.960, de Schubert, interprétée par Alfred Brendel)
« …Comme celui qui se dévêt à la vue de la mer, comme celui qui s’est levé pour honorer la première brise de terre […]
Les mains plus nues qu’à ma naissance et la lèvre plus libre, l’oreille à ces coraux où gît la plainte d’un autre âge,
Me voici restitué à ma rive natale… Il n’est d’histoire que de l’âme, il n’est d’aisance que de l’âme.
Avec l’achaine, l’anophèle, avec les chaumes et les sables, avec les choses les plus frêles, avec les choses les plus vaines, la simple chose, la simple chose d’être là, dans l’écoulement du jour…
Sur des squelettes d’oiseaux nains s’en va l’enfance de ce jour, en vêtement des îles, et plus légère que l’enfance sur ses os creux de mouette, de guifette, la brise enchante les eaux filles en vêtement d’écailles pour les îles… »
Saint-John Perse, Exil [1941], in Éloges, suivi de La Gloire des Rois, Anabase, Exil, Gallimard, collection Poésie, 1960, p. 160.
Pour en savoir plus sur Saint-John Perse, se reporter au site « Saint-John Perse, le poète aux masques », où il est possible d’écouter de nombreux extraits d’archives sonores, dont de longs extraits du Discours de Stockholm.
Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 18 janvier 2005 à 20:44 | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack
18 janvier 1948
Tout en lisant, en consultant une biographie de l’écrivain Pierre Drachline (né le 18 janvier 1948, auteur d’une Autopsie à vif très décapante et « mortimiste » [selon l'expression de Louis Calaferte], je découvre par hasard un étonnant Lexikon alphabétique d’écrivains (site Labyrinthe), le labyrinthe des ressources sur la littérature contemporaine. Qui me conduit tout droit sur le blog de François Bon. Tiers Livre. Quelle merveille que ce blog ! Et quel bel agenda ! Un détour par les archives me laisse en arrêt devant la phrase suivante : « désormais, l'image Internet de l'atelier d'un livre, avec iconographie, matériaux complémentaires, études et liens, se constitue progressivement, dès les premières phases d'écriture mais c'est aussi une manière de revenir visiter sa propre histoire ». Un programme que j’aimerais bien continuer à explorer pour les mois à venir dans le blog Terres de femmes !
Texte©angèlepaoli
Rédigé le 18 janvier 2005 à 10:51 | Lien permanent
| Commentaires (3)
| TrackBack
À l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Françoise Hardy (17 janvier 1944), cet extrait d’une chanson de l’égérie de « tous les garçons et les filles de mon âge », chanson que je dédie à mon amie lheurebleue : « c'est l'heure que je préfère, Paroles et musique de Françoise Hardy (1970). Voir aussi le site officiel de Françoise Hardy.
Rédigé le 17 janvier 2005 à 11:24 | Lien permanent
| Commentaires (2)
| TrackBack
En l’honneur de Jules Supervielle (né le 16 janvier 1884 à Montevideo [Uruguay] et mort à Paris le 17 mai 1960), cette petite improvisation prémonitoire de 4’33 de John Cage. Celle-ci n’est pas pour tous instruments, mais pour piano noir solo. « Un homme, qui avait été un grand pianiste, s’assit un jour à son fantomatique piano et invita les amis à le venir voir jouer. Chacun comprit que ça allait être du Bach. On pensait que peut-être, vu le génie de l’exécutant et du compositeur, on allait entendre quelque chose. Et les invités faisaient aller leur tête de droite et de gauche dans une grande espérance. Certains avaient pensé que c’était Bach lui-même. En effet, c’était lui. Il joua la Toccata et Fugue. On suivait avec passion le jeu de l’artiste et chacun crut vraiment l’entendre. À la fin du morceau tous se mirent à battre des mains avec enthousiasme, mais il fut manifeste que nul bruit n’en sortait. Alors, comprenant qu’il n’y avait pas eu miracle, on se hâta de rentrer chez soi au plus vite. » Jules Supervielle, L’Enfant de la haute mer [1931], Gallimard, Collection Folio, 1972, page 91. Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 16 janvier 2005 à 04:05 | Lien permanent
| Commentaires (2)
| TrackBack
14 janvier 1977. Mort d’Anaïs Nin. « Quand les autres me demandaient la vérité, j’étais convaincue que ce n’était pas la vérité qu’ils voulaient, mais une illusion avec laquelle ils pourraient supporter de vivre. J’étais persuadée de leur besoin d’illusion. » Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 14 janvier 2005 à 14:25 | Lien permanent
| Commentaires (1)
| TrackBack
Le 13 janvier 1941 mourait James Joyce. Nora, sa compagne, choisit pour les funérailles une couronne de feuillage vert en forme de harpe. Elle confie à son ami Paul Ruggiero : « Ho fatto questa forma per il mio Jim che amava tanto la musica » [j’ai choisi cette forme pour mon Jim qui aimait tant la musique. » James Joyce, "On the Beach at Fontana", Poetry, vol. XI, n° 2, Chicago, novembre 1917, pp. 70-71. « Le vent geint et les galets geignent, Du vent qui geint, de la mer grise Partout la mer autour de nous, Trieste, 1914 James Joyce, Œuvres I, Poèmes d’api, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Voir aussi : 2 février 1922
Rédigé le 13 janvier 2005 à 15:06 | Lien permanent
| Commentaires (2)
| TrackBack
Cela commence comme une pièce de théâtre contemporain. Une pièce en un seul acte et trois personnages en scène. À peine quelques didascalies pour planter le décor : une toile à la Claude Lorrain. Un paysage XVIIe s., lieu de rencontre de trois étranges personnages, munis d’un magnétophone. Ce n’est pas là le seul anachronisme. L’universitaire « à la recherche de ses propres sentiers » se nomme Scriptor. Pictor, « mécanicien d’horizons », se charge de « révéler les corps et les âmes ». Quant à Viator, « ex-commis en culture française », il tente « d’élargir son éventaire ». À peine posés ces curieux éléments de dramaturgie, le jeu commence. Car il s’agit d’un jeu, comme ceux que pratique France Culture entre midi et quatorze heures. Pictor lance un mot au hasard. Le premier qui « tombe sur le tapis », le voilà donc, c’est le mot « mort »! Le seul mot qui roule et rebondit, tout au long du jeu, de réplique en réplique. Avec sa cohorte clinquante d’accessoires. Dès lors, les répliques s’enchaînent, rapides, brèves, réduites parfois à de simples stichomythies, comme dans une jonglerie macabre où se croisent et se bousculent crânes et objets de vanités divers. Qui se déclinent dans les multiples variantes du genre pictural, en vogue en Europe du Nord dès le XVIe siècle (David Bailly, Harmen et Pieter Steenwyck, Jan de Heem, Peter Potter, Pieter Claesz,…). L’occasion pour les trois dieux « Tor » de dévider à l’infini, sur l’écheveau de leur dialogue, le tressage subtil de la « relation entre la mort et l’œuvre d’art ». Et pour l’auteur, une manière originale de réfléchir et de s’interroger sur l’art d’apprivoiser la mort. Une réflexion philosophique indémodable! Qui n’en relève pas moins de l’humaine « vanité ». Viator « Il y a dans toute oeuvre d'art une tentation surmontée du suicide. L'œuvre est là non seulement pour permettre de résister à autrui, mais pour trouver un "modus vivendi " avec soi. » Texte©angelepaoli Retour à l' index de mes Topiques de Cap-Corsine
Rédigé le 10 janvier 2005 à 20:20 | Lien permanent
| Commentaires (1)
| TrackBack
« Il se disait : mon amour échappe au temps. Il regardait les doigts de la femme occupés pour rien à leur œuvre de jouissance et de plénitude. Et c’était tellement beau que, éprouvant que son désir n’en finissait pas de monter et de se tendre, il redoutait de bousculer l’ordre du plaisir et appréhendait la violence d’effraction dont il était porteur. La forme s’étendait, haussée et creusée à la fois. Elle atteignait à la perfection de son relief, déployée dans le vif, épaisse comme une feuille d’acanthe, lobée comme la fleur de l’iris : signature héraldique du corps d’amante. Ce blason de féminité occupait tout l’horizon du regard. Il y avait eu, autrefois, chez l’enfant et l’adolescent, à l’orient de l’âme liturgique, l’ostensoir, la veilleuse du tabernacle, le crucifix, l’image de la Vierge des sept douleurs – tout cet ensemble amalgamé en une seule présence de réalité sacrale qui remplissait espace et temps. Et maintenant, c’était le sexe d’une femme, c’était une femme par son sexe, qui tenait le lieu de la totalité. La puissance d’adoration […] n’avait pas changé. […] Elle s’était enrichie d’avoir accepté le sensible dans sa limitation, dans sa corruptibilité, dans sa radicale humilité de l’être, dans sa vitalité sans glose. L’inscription du sexe de la femme – de l’amante au-dessus de toutes les femmes – dans le champ ouvert, tendu, fervent, de la conscience de soi et du monde que le jeune homme incarnait alors, se faisait dans les traces à peine désertées de ce qui avait été l’inscription du divin. Et de la même façon que la foi avait généré une esthétique, celle du plain-chant notamment, […] l’amour pour une femme, dans la force soutenue du désir et sous le signe hiérophanique du sexe, créait chez le jeune homme les conditions d’une expression poétique et plastique de son existence. » Claude Louis-Combet, Le Chemin des vanités d’Henri Maccheroni, José Corti, 2000, pages 33-34. Voir aussi : Retour à l' index de mes Topiques de Cap-Corsine
Rédigé le 10 janvier 2005 à 17:49 | Lien permanent
| Commentaires (0)
| TrackBack
« On me disait, non, ne prends pas, non, ne touche pas, cela brûle. Non, n’essaie pas de toucher, de retenir, cela pèse trop, cela blesse. On me disait : lis, écris. Et j’essayais, je prenais un mot, mais il se débattait, il gloussait comme une poule effrayée, blessée, dans une cage de paille noire tachée de vieilles traces de sang. » Yves Bonnefoy, La Vie errante [1993], Poésie/Gallimard, 2002. Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 07 janvier 2005 à 03:07 | Lien permanent
| Commentaires (1)
| TrackBack
Dans ce très beau texte en prose qu’est L’Arrière-pays, le poète Yves Bonnefoy s’essaie à découvrir son arrière-pays mental. Un arrière-pays qui se cherche et se construit au travers des regards portés sur la peinture italienne du Quattrocento. Alimentent ses rêveries les « paysages d’arrière-plans » de Piero della Francesca et les architectures de Brunelleschi et d’Alberti échafaudées dans « la dialectique solaire du plan central ». Davantage mental que géographique, cet arrière-pays qui hante le poète se construit à la croisée des chemins, à cet endroit même où le voyageur hésite, tenté tout à la fois par les paysages dont les perspectives s’offrent au regard ou par les lignes des collines qui dérobent leurs arrière-plans démultipliés. Selon le poète, l’arrière-pays est ce lieu où « l’invisible et le proche se confondent » ; où « la rêverie se nourrit d’une plénitude vacante ». Inaccessible, l’arrière-pays ne peut exister que délesté de tout ancrage géographique. Même s’il s’enracine dans des espaces privilégiés : l’île de Capraia ou les grands déserts, les terres traversées au cours de voyages en Iran, dans le Caucase ou en Grèce. Le poète confronte continûment le temps et l’espace intérieurs qui sont siens à certains de ses souvenirs d’enfant, notamment à la lecture des Sables rouges. Dont le nom de l’auteur s’est définitivement effacé de sa mémoire, mais non point sa propre identification avec le héros du récit, un archéologue égaré dans une mystérieuse aventure en plein désert de Gobi. Lectures enfantines qui en feront naître d’autres. Celles des lentes expéditions d’Alexandra David-Néel au coeur de l’Asie centrale et du Tibet. Ainsi le poète tente de circonscrire son espace mental selon des limites et des formes, des figures récurrentes et des approches qui constituent une « aire », son « aire ». Qui va « de l’Irlande aux lointains de l’empire d’Alexandre que le Cambodge prolonge », en passant par l’Égypte, les sables de l’Iran aux bibliothèques cachées, les villes islamiques d’Asie, Zimbabwe, Tombouctou, les vieux empires d’Afrique, - et certes le Caucase, l’Anatolie et tous les pays de la Méditerranée. » Car, écrit le poète, « les civilisations que j’assemble, nées du désir de fonder, ont pour signe de soi le cercle, le plan central et le dôme. Au prix, bien sûr d’être investies par un autre cercle, celui de l’horizon inconnu, de l’appel des lointains au pèlerinage, à la quête de l’obsession d’un autre pôle, du doute. » D’autres villes surgissent, d’autres toiles découvertes au cours de pérégrinations italiques, d’autres interrogations, d’autres « icônes », entraînant avec leur surgissement le reflux du « livre détruit », le roman de L’Ordalie. « Parce que ces bifurcations, ces décompositions prismatiques étaient certes irréductibles à toute psychologie, toute vraisemblance, se retirant comme une eau de l’écriture finie. » Étrange mise en abyme que cette « ordalie » purificatrice. À l’origine d’une nouvelle arborescence, celle d’une nouvelle création, d’« un nouveau livre, avec ses exigences énigmatiques, son infini rentré, son autonomie silencieuse ! » Yves Bonnefoy, L’Arrière-pays [1972], éditions Gallimard, Collection Poésie, 2003. Retour à l' index des auteurs
Rédigé le 02 janvier 2005 à 16:14 | Lien permanent
| Commentaires (0)
| TrackBack
« La pourpre coule Le jus du soir Pépins et duvets La transparence des grappes L'effervescence des mouches Un grain de beauté La harpe des vignes Le lait qui perle Michel Butor, Collations, Poésie Seghers, 2003, p. 130. Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 01 janvier 2005 à 20:14 | Lien permanent
| Commentaires (0)
Cent vues de l'enclos des nuages d'André Ar Vot est un millefeuille, à lire et à goûter, feuille après feuille, touche par touche, du bout des doigts. Un feuilleté sur les nuages. Un nuancier qui entraîne le lecteur gourmet à travers les airs, strates et aires, stratosphères. À la rencontre des nuages, de leurs histoires et de celles qu’ils nous racontent. De leurs mystères. Aussi fugitifs et secrets que les formes impalpables qu’ils inventent pour que le poète invente à son tour toute une jonglerie de mots insolites et une rêverie des ciels pour tenter de percer leur magie volatile (et vibratile ?). Qui toujours recule et toujours échappe. Comme l’art. C’est d’ailleurs une réflexion de Picasso que le poète a choisi de mettre en exergue à son « avertissement » : « On ne fait pas de tableau, on fait des études, on n’en finit pas de s’approcher » (Propos sur l’art). Il en est de même des nuages, même si le poète, passé Maître en l’a-matière, s’ingénie à inventer, par antiphrase, un « Manuel des Nuages en 25 leçons ». D’ailleurs les « 25 leçons » sont dépassées, et pareillement les « Cent Vues » que lui inspirent les Cent Vues du Mont Fuji d’Hokusai. Les variations sont à l’image des nuages : infinies ! Elles nous emportent du nuage « baleine blanche-Moby Dick » à la « Grotte flottante » de l’homo erectus de Tautavel, non sans happer au passage, de manière instinctive, les noms irrésistiblement proustiens de « Palamède et Verdurin ». Ailleurs, on glisse avec lui sur cette évidence : « Les nuages et les hirondelles sont des organes agiles, les particules d’un grand corps morcelé, un puzzle qui se reconstitue pour les vastes traversées. Toujours en mouvement, ni les uns ni les autres ne mettent pied à terre. » Et l’on croise en chemin une réflexion sur les « avatars » des nuages qui se changent en pluie ou en « ombres errantes » pour « communiquer avec nos propres sens ». Il y a toute une texture du nuage, une généalogie, une « galaxie médusée ». Certains figurent au « Salon des Refusés », d’autres s’installent dans la « Nature morte », façon Whistler. On côtoie les nostalgiques et les mondains, les insouciants et les belliqueux, les indolents, les tapageurs. Et même « les simples d’esprit », qui ont la préférence du poète. Car, dit celui-ci, « le royaume des cieux leur appartient. » Al di là delle nuvole. Par-delà les nuages… André Ar Vot, Cent vues de l'enclos des nuages, José Corti, 2004. EXTRAIT « Le ciel est un palimpseste dont les nuages sont les écritures successives. Un vent les efface et remplace ce qu’un autre vent, d’un autre geste, avait transcrit. Texte©angelepaoli Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 30 décembre 2004 à 18:22 | Lien permanent
| Commentaires (1)
Jeanne Bresciani, Les Vestiges de Janvier Rome, avril 2000 : « Avril est un mois cruel ». Un an après la mort de son ami et ancien élève, Charles Janvier, le professeur Giambattista Bellingeri, qui a choisi pour pseudonyme d’écrivain le nom même de son ami défunt, confie à ses carnets intimes l’histoire de Charles : figure désenchantée de « l’éternel étudiant » en quête d’absolu. Est dessinée en contrepoint l’histoire de Vanina Ventiseri, éprise d’un amour éperdu pour Charles. Nina confie à Giambattista, à travers une correspondance dense et assidue, le détail de sa relation avec cet homme. Une relation amoureuse déchirante, tendue au plus extrême de l'incandescence, mais aussi de son point de rupture. Parce que construite sur le malentendu. Une passion d’emblée vouée à l’échec. Qui, pour l’essentiel, durera l'espace d’un matin. Tout en déposant dans les fibres de la mémoire et du corps des limons indélébiles. Entre les deux amants, que déchire ce bel et impossible amour, se glisse, également confident de Charles et de Nina, la figure du narrateur, qui livre à l’écriture souvenirs, analyses, interrogations et doutes. Meurtrissures. Qui sont aussi celles de ses amis. Le dernier roman de la Bastiaise Jeanne Bresciani, Les Vestiges de Janvier, se compose en apparence de deux volets de diptyque bien distincts, « Les Carnets de Charles », « Les lettres de Nina ». Mais c’est en réalité une partition polyphonique aux registres et ornements d'une complexité fascinante et piranésienne. Dont les voix se croisent, se nouent, se chevauchent, s’entrecroisent, se dénouent, pour tisser au final un lamento aux accents sublimement baroques et dolents. Cette composition « berninienne » est tout en jeux subtils de miroirs et de mises en abyme. Mais, si notes, fragments, lettres et commentaires, en se rejoignant et se disjoignant, mettent en évidence les strates fines de la composition, ils tracent aussi en filigrane le portrait de la véritable héroïne : la mémoire. Et son réseau de vestiges que la mémoire estompe et délaisse derrière elle. Et que chacun désespère de ranimer. « Qui sait si l’on ne souffre pas de trop de mémoire, même quand on ne se souvient de rien ? », est-il écrit dans les « Carnets de Charles », dans une note prise sur le vif (page 31). Le roman s’ouvre sur le souvenir de l'absent. Il se clôt sur un épilogue où module une tout autre voix. La voix d’une femme autre. Autre que Nina. Une voix aux harmoniques tout aussi irradiantes et douloureuses… plus bouleversante encore. La voix du « coup de théâtre final ». Un très beau roman que celui de Jeanne Bresciani. Un roman exigeant, absolu, sans concession aucune à la moindre facilité d'écriture. Imprégné d’une culture qui émerge d’un continent que l'on croit souvent englouti. Un roman certes baroque, mais dont la langue est toute de concision et de litote. Une langue qui relève davantage de celle d’une Madame de La Fayette ou d’un Guilleragues que de celle d'un Scarron. Mais n'ayez crainte. En dépit de ses accents élégiaques et de ses soupirs, ce roman ne manque pas de distance et d’humour. Il n’est qu’à lire l’épigraphe sur lequel s’ouvrent les « Carnets de Charles » : « Si l’imagination a pu coïncider avec la réalité, la faute doit en être attribuée, selon moi, à la réalité. » Exergue empruntée au romancier sicilien Andrea Camilleri. Un gourmet de la langue lui aussi. Il en subsiste quelques-uns. Jeanne Bresciani, Les Vestiges de Janvier, Éditions Pétra, décembre 2004. Texte©angelepaoli EXTRAIT : « Où se perd-il aujourd’hui ce regard qui m’avait un instant remarquée, brillant pour moi du feu clair d’un rire ou me lançant quelques éclairs d’orage ? Dans quel autre regard ou dans quelle autre absence ? Et tous ces gestes insignifiants qui suffisent à vous rendre amoureux d’une créature singulière, unique en son genre et seule de son espèce : l’éternelle chimère de nos pensées ? Et ces paroles qui se fondent au plus intime des vôtres comme si les langues échangeaient bien autre chose qu’un baiser en s’imprégnant de leur secrète substance ? BIOGRAPHIE Née près de Bastia en 1949, Jeanne Bresciani vit et travaille à Paris. Elle a publié son premier ouvrage Affriques en 1981 aux éditions Tierce. Deux, rue de la marine (1999), écrit en collaboration avec sa sœur Hélène Bresciani, a obtenu le Prix du livre corse de langue française en 2000. Les Vestiges de Janvier (publié aux Editions Pétra en décembre 2004) est son quatrième ouvrage.
Rédigé le 28 décembre 2004 à 15:37 | Lien permanent
| Commentaires (1)
L’insecte « De tes hanches à tes pieds Là se dresse une montagne. Par tes jambes je descends Puis je glisse vers tes pieds El insecto « De tus caderas a tus pies Soy más pequeño que un insecto. Voy por estas colinas, Aquí hay una montaña. Por tus piernas desciendo Hacia tus pies resbalo, Pablo Neruda, « L’insecte », Le désir, Les Vers du capitaine, Poésie/Gallimard, 1998, p. 180. Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 26 décembre 2004 à 11:33 | Lien permanent
| Commentaires (3)
Dès les premières pages, elle est, elle, la petite sœur de cinq ans, « celle par qui la ténèbre arrive » ! Pourtant, ténébreux, il ne l’est pas moins. Lui, de cinq ans son aîné. Pareille à elle, avec ses grands yeux sombres. Et ce même amour exigeant vissé à l’âme et au corps. C’est qu’ils sont de la même espèce, le frère et la petite sœur. De la race solitaire et solidaire des « maudits ». Ils le savent. Et ils en jouent. Rongés semblablement dès leur plus tendre enfance et jusqu’au plus profond de leurs viscères par l’interdit de leur amour. Un amour qui prend chair et bonheur dans la fulgurance d’un éclair de printemps. Et conduit inéluctable au bord du gouffre les deux amants. Leur tragédie prend fin avec le suicide (? !) de l’un … puis de l’autre. Leur histoire ? Une passion folle qui s’accouple avec la mort ! Entre les deux versants, une descente lente aux enfers, et longue sur des chemins pavés d’opium ! Rutilants et douloureux ! Ainsi est-il de Blesse, ronce noire, la fiction qu’a inspiré à Claude Louis-Combet le poète autrichien Georg Trakl. Et plus particulièrement le poème « Révélation et anéantissement ». Il fallait bien que le texte prît son essor à l’automne, saison des profondeurs crépusculaires. Dans cet automne fin de siècle, cependant somptueux. Il fallait bien que s’ancre le récit dans le grenier de la maison. Car « c’est au grenier qu’a lieu, dit Bachelard, la bouderie absolue, la bouderie sans témoin ». Pour le philosophe Louis-Combet, La Poétique de l’espace ne pouvait avoir de secret. C’est dans ce grenier « au miroir » que le garçon «dans sa jeunesse sans innocence » initie la petite sœur consentante et l’entraîne au cœur de mystères et de sacrifices originels. Sacrifice de la poupée transpercée par la violence d’un coup de sabre. Mystère du corps féminin mis à nu par le frère. Découvert, le sexe enfantin, entre ouverture et fermeture, dans une mise en abyme vertigineuse de jeux de regards et de jeux de miroir. Voilà bouclée la scène primitive et primordiale des amours enfantines. Amours incestueuses auxquelles ni l’un ni l’autre ne cherchent à échapper. Jamais. Chacun grandit avec la pleine conscience d’avoir déjà accompli la faute. Faute exigeante, tyrannique, inscrite au plus vibrant des replis secrets de leur chair. Qui, l’heure venue réclame son dû. Le récit se clôt à l’automne, mais un automne brouillé de « brumes fuligineuses » celui-là. Et Gretl emporte avec elle la dernière image : celle de l’enfant nue au miroir. Claude Louis-Combet, Blesse, ronce noire, José Corti, 1995. Texte©angelepaoli EXTRAIT Dans le grenier de la vieille maison, c’est un capharnaüm de malles remplies de livres, de lettres, de papiers de famille, mais aussi de vêtements périmés, de rideaux, de dentelles, de coussins à franges et à ramages. Il y traîne des jouets comme fracassés par le temps : une poupée qui a perdu une jambe, une autre dont le crâne de porcelaine s’est brisé et laisse apparaître le délicat appareil de contrepoids qui fait mouvoir les yeux, petits globes de verres bleus se haussant et s’abaissant sous des paupières immobiles ornées de très longs cils. Les poupées portent des robes à l’image de celles des petites filles et, là-dessous, de précieux petits pantalons blancs serrés contre les cuisses. Un jeu de quilles est étalé sur le plancher. Un cheval de bois éreinté est encore attelé à sa charrette, mais celle-ci n’a plus de roues. Des soldats de plomb fauchés dans leur élan viril gisent dans une boîte de carton. De nombreux couvre-chefs, masculins ou féminins, sont accrochés à des patères ou traînent dans la poussière : des casquettes, des gibus, des canotiers, des chapeaux extravagants ornés d’oiseaux, de fleurs, de plumes, et garnis de rubans, de voiles noirs ou de voilettes. Des outils d’antan paraissent abandonnés à leur rouille. Le bois est cironné : maillets, manches de gouges et ou de marteaux, poignées de scies sont effrités au-dedans, pulvérulés, et s’émiettent à même le sol. Des baquets, des arrosoirs et divers ustensiles en zinc sont cabossés, percés, déchaussés, béants. Un sabre d’abordage, engainé de cuir, pend lamentablement, pointe en bas, retenu par une boucle de cordonnet, parmi des colliers de fausses perles et de fausses pierres, des grelots, des gants de filet déchirés et noircis. Une grande pesanteur d’inertie accable ce ramassis d’objets éliminés. Un miroir grandiose, serti dans un décor de plâtre foisonnant de palmettes et de lauriers, affiche son éclat blanchâtre et terne au-dessus du fatras. Voir aussi :
Rédigé le 26 décembre 2004 à 11:01 | Lien permanent
| Commentaires (0)
« Tout s'y lit l'or bleu du désir l'eau qui dort sous Alain Duault, Nudités, poèmes, Gallimard, 2004, p. 35. Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 26 décembre 2004 à 00:07 | Lien permanent
| Commentaires (2)
Entre absence et présence Mots Voix Mots Voix Nom Lettres Nom Angèle Paoli Texte©angelepaoli
Rédigé le 24 décembre 2004 à 12:55 | Lien permanent
| Commentaires (1)
Quelle partie d’échec se tisse dans l'étrange duel de cette Partition (Alain Veinstein) ? Quel combat à la vie à la mort se joue dans cette convocation d’un père par son fils ? Comment se trament, se combinent, se transforment les forces qui drainent cet invisible tête-à-tête mortel ? Lui, le père, est un pianiste de renommée internationale. Un monstre, selon le narrateur, son fils. De quel crime Samuel Wallasky est-il donc coupable ? Quel morceau de chair ce fils âgé d’une trentaine d’années veut-il faire dégorger à cet homme au moment de le faire mourir ? C’est ce que nous livre à déchiffrer, dès les premières mesures, cette partition aux accents de meurtre et de tragédie. Pourtant, le titre du roman est tout autre. Bref, neutre, presque abstrait. Il ne laisse rien filtrer de la portée musicale que le narrateur va tenter de parcourir au jour le jour. Tapi dans le grenier de la maison qu’habitent Wallasky et sa compagne, cultivatrice en fleurs mortuaires, le narrateur observe. À travers les lattes disjointes du plancher, il observe par le menu le couple qui s’aime et se déchire. Rien n’échappe à ce scrutateur de tous les instants. Pas même les pauvres et tragiques coïts du couple. Ni les gestes de plus en plus alentis du pianiste ou la beauté de ses doigts effilés courant sur le clavier. Encore moins la douleur qui défait ses traits à mesure que son corps se penche et se tord sur le piano. Épier le père pour se l’approprier et le détruire. Démasquer le monstre. Fouiller sa vie et sa chair pour en débusquer la faille. Lui faire éructer son secret au milieu des râles et du sang. C’est là qu’est le projet du fils. Une mise à mort doublement efficace. Qui doit signer la réparation de l’injure faite à sa mère en même temps qu’elle doit permettre au fils de le faire naître enfin à la vie. Or, quelques jours à peine suffisent pour voir se dégonfler l’image baudruche du père. Quelques jours à peine pour que la partition change de registre et se charge d’une incontrôlable émotion. Et si la mort est toujours au rendez-vous, ce n’est pas celle que le fils attendait. C’est que la partition, pareille à un Janus bifrons, laisse peu à peu entrevoir une page vierge. Il aura suffi de quelques jours pour que la haine se mue en un imprévisible et indéchiffrable amour. Alain Veinstein, La Partition, éditions Grasset. EXTRAIT "C’est un commencement. J’apprends à tuer. Je répète en vue du grand jour. Je serai capable, je te l’assure mon amour, de la plus grande froideur. Mes mains ne trembleront pas au moment d’actionner le chien. Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 24 décembre 2004 à 09:23 | Lien permanent
| Commentaires (2)
Il y eut un matin littéraire... Sans rougir, je peux affirmer que la littérature, je l’ai aimée dès mes débuts de « grande » ! D’abord grâce à mon père, ce grand découvreur de textes et ce « passeur », à qui je rends hommage, par-delà les années qui me séparent de lui depuis sa disparition. Un jour, il lui a pris de faire entrer Rhinocéros dans la salle de séjour. Il nous en lisait de longs extraits. Et ce fou de Ionesco était convié à notre table ! Midi et soir ! Au grand dam de ma mère, que cette étrangeté, peu orthodoxe selon ses critères de femme rangée, dérangeait. J’étais en sixième et je riais à en pleurer. Il faut dire que mon père était irrésistible dans le rôle du dénommé Dudard ! « Faut vous dire Monsieur » que Ionesco, en ce temps-là, c’était de la contre-culture ! Et de la vraie ! Car pour la culture classique, il y avait le collège… et son latin, la version tous les jours et le thème du mercredi. Virgile et ses Bucoliques, Horace et ses Odes, Salluste et sa Guerre de Jugurtha, César et sa Guerre des Gaules… Cicéron vitupérant contre Catilina et courant après ce truand de Verrès. Il y avait, qui déambulait sur la passerelle reliant les différents bâtiments, la cohorte en majesté des professeurs « importants » et respectés. Parfois adulés. Des personnalités. Des femmes exclusivement ! Avec elles, dès les bancs du collège, j’ai aimé le Cid et Horace, Cinna et Polyeucte. Les vers de Corneille me donnaient le frisson, même si leur sens m’échappait parfois ! Souvent ! Cette musique de l’alexandrin, ce carcan magnifique, le rythme mystérieux des longues tirades aux enjambements complexes, les combats ardus entre Horaces et Curiaces, les dilemmes entre gloire et amour, les litotes et les métaphores ! Tout cela m’exaltait, qui passait par la voix vibrante de mon professeur de 4e, à la fois terrrriblement crainte et tellement aimée ! J’aimais trembler en l’écoutant, j’aimais encore davantage trembler en récitant les vers que j’avais appris « pour elle » et découverts « par elle » ! « Avec elle », j’ai vogué en remontant le cours mystérieux du temps et voyagé dans l’espace conquérant du monde de la Renaissance. J’ai jonglé avec les « paroles gelées » de maître Alcofribas. Grâce à elle, grâce au maître François, j’ai planché et transpiré sur ma première dissertation, mon premier plan en trois parties, avec la consigne d’élucider cette phrase dont les mots dansaient et papillonnaient devant mes yeux. Sans parvenir à se faufiler dans mes neurones encore engourdis de fillette qui lit « les yeux assis dessus le livre » : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Quelle audacieuse modernité ! Bien avant que de m’y rendre, j’ai visité en nostalgie le Petit Liré et fréquenté les muses coquines de la Fontaine Bellerie. Avec Ronsard et Louise Labé, j’ai souffert les mille maux de l’amour bien avant que de les vivre ! Je me suis balancée au bout d’une corde avec le grand Villon. Et j’ai fréquenté les tavernes borgnes avec ce maraud de Clément ! Il m’a fallu « entrer en lycée » pour m’ennuyer copieusement avec Hervé Bazin. Heureusement, il y eut Racine… il y eut Phèdre pour me sauver d’un mortel assoupissement et me plonger avec délices dans l’enfer dévorant de la passion. Après… il y eut les autres, tous les autres, les modernes disait-on, mais les grands! Je me suis vengée de Bazin et de quelques insipides avec Mauriac et Montherlant, Cocteau et Gide. De Gide, à quinze ans, j’avais lu tous les livres. Ou presque. De Gide, nous dissertions, frères, sœurs et cousins. Pendant des heures entières sous la canicule du plein été corse, sur les rochers de la marine de Giottani, en contrebas de mon village, entre deux plongeons dans la mer azurée. Azur ! « Fuyant, les yeux fermés, je le sens qui regarde… ». De retour au lycée, nous attendions avec ferveur l’entrée solennelle de notre professeur de lettres, qui ne manquerait pas, un jour de somnolence, de nous tancer vertement en nous lançant que la culture manquait de bras ! Nous vivions encore, c’est vrai, les beaux temps bucoliques de l’agriculture. Avec ce maître-là, il en pleuvait des dissertations… qui nous occupaient des heures entières ! « Des heures entières sous les arbres »... de la cour à discuter, à échanger, à bâtir un plan, à le déconstruire. À réfléchir. Avec les moyens du bord ! De bien modestes moyens. Quelques bouquins échangés en douce avec nos rêves. Et des citations latines qu’en élèves consciencieux, nous enroulions et déroulions sur des morceaux de parchemins délavés. Au-dehors, la vie était morne et triste. Celle des adultes. Combien plus riche était la nôtre, celle que nous vivions, adolescents, en littérature. Je consacrais le temps béni des récréations à rédiger des lettres d’amour enflammées, « façon marquise vos beaux yeux... »… de Sévigné ou façon Rabutin, pour mes camarades de classe empêtrées dans leurs mots malhabiles. Mais mes plus belles inventions littéraires, je les rédigeais pendant les compositions de mathématiques. À partir de théorèmes appris par cœur et dont je me berçais en les récitant. Je me lançais ensuite, devant le tableau, dans des délires pataphysico-poétiques qui me valaient l’anathème de mon professeur désespéré. Et un examen de mathématiques à chaque rentrée ! Cela ne m’a jamais guérie ni de mon imaginaire... ni de la poétique ni de ses grandeurs !! Texte©angelepaoli
Rédigé le 16 décembre 2004 à 15:12 | Lien permanent
| Commentaires (2)
« Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. Pendant que des mortels la multitude vile, Loin d'eux. Vois se pencher les défuntes Années, Le Soleil moribond s'endormir sous une arche, Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Retour à l'index des auteurs
Rédigé le 11 décembre 2004 à 13:47 | Lien permanent
| Commentaires (0)
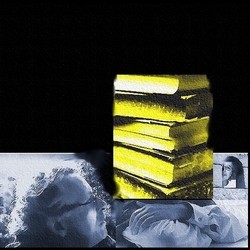

Bon anniversaire.
17 janvier 2005
17 janvier 1944/Naissance de Françoise Hardy
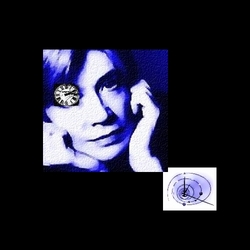
L’heure bleue. Portrait de Françoise Hardy
Image G.AdC
on l'appelle l'heure bleue
[…] c'est une heure incertaine, c'est une heure entre deux
où le ciel n'est pas gris même quand le ciel pleut
je n'aime pas bien le jour:
le jour s'évanouit peu à peu
la nuit attend son tour
cela s'appelle l'heure bleue
le jour t'avait pris
et tu te promènes
dans le soir de Paris
l'heure bleue te ramène
c'est l'heure de l'attente […] »16 janvier 2005
16 janvier 1884/Mort de Jules Supervielle

Pianoforte
Ph, G.AdC14 janvier 2005
14 janvier 1977/Mort d'Anaïs Nin

Portrait d'Anaïs Nin
Image, G.AdC
(octobre 1933)
Anaïs Nin, Journal, tome I, 1931-1934, Livre de Poche, page 408 . 13 janvier 2005
13 janvier 1941/Mort de James Joyce
Source : Brenda Maddox, Nora, Albin Michel, 1990, page 431.
“Wind whines and whines the shingle,
The crazy pierstakes groan;
A senile sea numbers each single
Slimesilvered stone.
From whining wind and colder
Grey sea I wrap him warm
And touch his trembling fineboned shoulder
And boyish arm.
Around us fear, descending
Darkness of fear above
And in my heart how deep unending
Ache of love !”
La jetée, ses pieux fous gémissent ;
Une mer sénile dénombre
Ses galets, de vase argentés.
Plus froide encor, je le défends
Et je sens trembler son épaule
Aux frêles os, son bras d’enfant.
La nuit de la peur qui descend
Et si profonde dans mon cœur
La douleur, sans fin, de l’amour ! »
page 50.
Retour à l' index des auteurs
10 janvier 2005
Michel Butor/Et omnia vanitas
Michel Butor, Vanité, Conversation dans les Alpes-Maritimes, Editions Balland, Collection Le Commerce des idées, 1980.
EXTRAIT
(p. 50)
Retour à l' index des auteurs Hiérophanie du sexe de la femme
- Celle par qui la ténèbre arrive.
- Mala Lucina;
- Noyau central
Retour à l' index des auteurs 07 janvier 2005
On me parlait
02 janvier 2005
Une silencieuse ordalie
01 janvier 2005
Michel Butor/Vergers d'enfance (1)
entre les doigts
les bulles du matin
nervures et rainures
la mésange sur un rameau
dans l'éventail des prunes
sur la joue de la pomme
le clavecin des grenouilles
au sein des figues »
30 décembre 2004
« Al di là delle nuvole »
Même chose que les pas de l’homme sur le sable, ce langage mélodique de notes suspendues, sinueux, composé de creux et de pleins, de talons évidés et d’orteils déliés, voués au silence et à l’effacement par le retour de la marée… Courtoisie du vent : il fait une pause et cesse de souffler le temps de la lecture et du déchiffrage. Puis il recommence à brouiller les superpositions, à entremêler les pistes. Il tricote de la profondeur. »
(p. 170)
28 décembre 2004
Jeanne Bresciani/« Avril brisé »
On devrait logiquement mourir de cette absence qui vous emporte aussi et pourtant l’on survit et l’on recommence… avec plus ou moins de bonheur, à vouloir faire coïncider les débris, les fragments, les restes d’un amour perdu avec quelque vestige leur ressemblant dans le regard d’un nouvel inconnu, tenaillé par l’idée que l’on se fait - fausse généralement - de la solitude. »
Les Vestiges de Janvier, « Les lettres de Nina » (p. 138).

Jeanne Bresciani se définit volontiers comme « un écrivain des figures de l’absence ». « Le vide de l’absence » et « la spirale du souvenir », qui en est une des figures élégiaques les plus abouties, semblent constituer l’envers piranésien ou le négatif (dans l’acception photographique du terme) d’une véritable quête ontologique de soi, en même temps que le tissu réticulaire de son espace romanesque.
A propos de cet ouvrage, lire aussi la très belle contribution de Sahkti sur Zazieweb : « Fouiller la mémoire des autres pour se trouver. »
Voir aussi ma contribution sur Deux, rue de la marine, de Jeanne et Hélène Bresciani.
Voir également le portrait de Jeanne Bresciani dans la galerie de Guidu.
Retour à l'index des auteurs
26 décembre 2004
Pablo Neruda/Femme-paysage
Je veux faire un long voyage.
Moi, plus petit qu’un insecte.
Je vais parmi ces collines,
elles sont couleur d’avoine
avec des traces légères
que je suis seul à connaître,
des centimètres roussis,
de blafardes perspectives
Jamais je n’en sortirai.
Ô quelle mousse géante !
Et un cratère, une rose
de feu mouillé de rosée !
en filant une spirale
ou dormant dans le voyage
et j’arrive à tes genoux,
à leur ronde dureté
pareille aux âpres sommets
d’un continent de clarté
Et vers les huit ouvertures
de tes doigts, fuseaux pointus,
tes doigts lents, péninsulaires,
et je tombe de leur haut
dans le vide du drap blanc
où je cherche, insecte aveugle
et affamé ton contour
de brûlante poterie ! »
quiero hacer un largo viaje.
son de color de avena,
tienen delgadas huellas
que sólo yo conozco,
centímetros quemados,
pálidas perspectivas.
No saldré nunca de ella.
Oh qué musgo gigante!
Y un cráter, una rosa
de fuego humedecido!
hilando una espiral
o durmiendo en el viaje
y llego a tus rodillas
de redonda dureza
como a las cimas duras
de un claro continente.
a las ochos aberturas
de tus dedos agudos,
lentos, peninsulares,
y de ellos al vacío
de la sábana blanca
caigo, buscando ciego
y hambriento tu contorno
de vasija quemante! »Claude Louis-Combet/Celle par qui la ténèbre arrive
Le texte, en six parties, s’organise selon un ordre chronologique qui surprend. Automne 1897/été 1905/1905-1909/été1909/ mars 1913/octobre-novembre 1914. Dix-sept ans de la vie de Gretl et Georg se déroulent ainsi, avec des ellipses temporelles et de soudains allongements. Dans une langue où fusionnent mysticisme et baroque, une langue à l’image des deux enfants.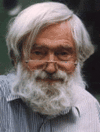 Claude Louis-Combet
Claude Louis-Combet
©Chez José Corti
(pp. 12-13-Incipit)
- Hiérophanie du sexe de la femme.
- Isula, Insula.
- Mala Lucina.
Retour à l'index des auteurs
Texte©angelepaoliAlain Duault/Le dos
Le sable des caresses attendues le frisson du réveil
Comme une vague ramène le matin sur la peau
On voudrait s'y étendre y mourir à son tour
Et la fine rainure qu'on suit avec le pouce
De la nuque aux reins comme un poème vertébré
Partage l'est du sommeil et l'ouest des plaisirs
Quand il est l'heure de lire le menu de la nuit avec
Les doigts »
Plage d'Albu
« Tant qu'il existera des fragments de beauté,
on pourra encore comprendre quelque chose
au monde. »
Guido Ceronetti
(in Alain Duault, Nudités, Gallimard).24 décembre 2004
Indices de présence
origine les mots à l’origine
origine de l’échange
mots des origines
la voix par-dessus les mots
quelle voix derrière les mots
mots privés d’échos
voix du premier échange
sa voix à elle
la mienne
quelles voix ce soir-là ?
sans voix pour dire : «à demain»
voix étranglée, la sienne pour répondre «a domani »
éclosion d’échos
déflagration de sens
tressage lacis réseau
vibrations résonances
enchâssement ailé
des mots en déraison
ondes silences échos
modulations
soupirs silences souffles
respirations
rires silences rythmes
ponctuation
affleurement de l’eau
oser le flux du nom
flâner entre voyelles
fermées puis ouvertes
à fleur de peau du nom
effleurement de femme
papier caché plié
pages pliures détachées
crayon couleur plume
écriture cryptée
graphisme déchiffré
temps suspendu attente
grain du nom égrené
épelé comme fruit qu’on pèle
pollen effleuré
à fleur de peau
soufflé insufflé nommé
oser l’écho du nomLe huis clos d’un scrutateur
En ce moment, je suis à trois mètres d’eux. Ils sont rentrés sans s’accorder un regard. Chacun se comporte comme si l’autre n’existait pas. Wallasky fait un feu de cheminée. Il a pris le risque de débrancher les bûches en plastique, c'est-à-dire d’affronter le tonnerre et la foudre. Les brandons s’envolent très au-dessus des flammes, avant de s’éteindre et de disparaître dans le conduit. Je suis tenté de lire dans les cendres un message qui me serait destiné. Je ne peux en détacher les yeux, fasciné, sans pouvoir interpréter le prétendu message autrement qu’en me racontant des histoires, évidemment tirées par les cheveux. Ce que je ne veux à aucun prix. Si j’ai un dessein, c’est de coller à ce que je vois, et de m’en tenir là…
[…] En l’observant, j’ai plus que jamais le sentiment d’un viol, d’un rapt. Et je pense à ce rapt que j’ai subi moi aussi dans l’enfance, à ce gâchis, à cette vie manquée qui m’a laissé au bord de la musique comme de toute chose. Pourtant, quand j’entends cet homme jouer, c’est sa grâce qui me subjugue. Je crois entendre les battements de son sang…"
(p. 145)
Texte©angelepaoli16 décembre 2004
Le rhinocéros n'est pas mort...
11 décembre 2004
Baudelaire/Recueillement
Tu réclamais le Soir; il descend; le voici:
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile,
Ma Douleur, donne-moi la main; viens par ici,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées;
Surgir du fond des eaux le Regret souriant;
Et, comme un long linceul traînant à l'Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche. »